
Crises économiques et comptabilité nationale
Y-a-t-il un lien entre crises économiques et comptabilité nationale ? Comment la comptabilité nationale s’adapte aux crise? Elle est née avec la crise de 1929. Les effets de la crise actuelle sont presque comparables à ceux des années Trente. Il n’empêche que la nature des deux événements est foncièrement différente. C’est un krach boursier à Wall Street qui a déclenché la Grande Dépression dans un monde encore fragilisé par la sortie de guerre. Ce qui arrive aujourd’hui a pour origine un choc exogène, sanitaire, qui survient dans un monde en croissance. Entre ces deux crises de même qu’après 1929 et en 2020, on peut trouver de nombreux exemples comme celle de 2009 de l’adaptation des comptes nationaux aux crises économiques.
Sans rentrer dans le détail des mécanismes de la crises des subprimes de 2007, l’incapacité de la comptabilité nationale à identifier les sous-ensembles de ménages fortement endettés ou soumis à d’autres contraintes financières a conduit aux efforts pour développer des données sur la distribution des revenus et de la consommation qui soient cohérentes avec les données plus agrégées des comptes nationaux. La Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social, présidée par J. Stiglitz, A. Sen et JP Fitoussi, a recommandé de donner plus d’importance à la distribution des revenus, la consommation et de la richesse, et l’OCDE a créé un groupe d’experts sur les disparités dans les comptes nationaux.
De plus il n’était été possible de trouver un indice des prix du logement directement à partir de la comptabilité nationale. En effet, si les réévaluations incluent l’impact de la variation du prix des logements anciens sur la valeur des actifs des ménages, elles n’incluent pas d’information sur le volume du stock de logements anciens. Il aurait été intéressant pour les utilisateurs qu’un tel indice des prix du logement soit inclus dans les tableaux standard des comptes nationaux.
En principe, les comptes nationaux devaient être en mesure de raconter des histoires similaires pour tous les pays (États-Unis, Irlande, Espagne)qui ont connu une bulle immobilière. En pratique, ils n’y avaient pas de bilans non financiers complets pour de nombreux pays.. En 2009, le FMI a publié un rapport sur les comptes nationaux dont voici la principale conclusion : »La crise présente des faiblesses dans la disponibilité de certaines bases de données économiques sectorielles et autres bases de données économiques financières ». Le rapport a recommandé « une stratégie visant à promouvoir l ‘élaboration et la diffusion comptes de patrimoine, des flux de fonds et, plus généralement, des données sectorielles.
Is there a link between economic crises and national accounting? How does national accounting adapt to crises? It was born with the 1929 crisis. The effects of the current crisis are almost comparable to those of the 1930s. However, the nature of the two events is fundamentally different. It was a stock market crash on Wall Street that triggered the Great Depression in a world still weakened by the end of the war. What is happening today is the result of an exogenous shock to health that is occurring in a growing world. Between these two crises, as well as after 1929 and in 2020, there are many examples like in 2009 of the adaptation of national accounts to economic crises.
Without going into the details of the 2007 subprime crisis, The inability of the national accounts to identify subsets of households that were highly leveraged or otherwise under financial duress has led toefforts to develop data on the distribution of income and of consumption that are consistent with the more aggregated national accounts data. The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, chaired by J. Stiglitz, A. Sen, and JP Fitoussi, recommended giving more prominence to the distribution of income,consumption, and wealth, and the OECD has formed an Expert Group nDisparities in National Accounts.
Moreover it was unfortunately not possible to find a housing price index directly from the national accounts tables. Indeed, while revaluations include the impact of the change in the price of old dwellings on the value of households assets, it does not include information on the volume of the stock of old dwellings. It would be interesting for national accounts users that such a housing price index is included in the standard national accounts tables.
In principle, the national accounts should be able to tell similar stories for all of the countries that experienced a real estate bubble. In practice there was lack of complete nonfinancial balance sheets for many countries. In 2009, a report of IMF staff concluded : “The crisis has weaknesses in the availability of some sectoral and other financial economic databases.” It recommended “a strategy to promote the compilation and dissemination of the [balance sheet approach], flow of funds, and sectoral data more generally.”
.
«L’histoire économique et politique des années 1880 à nos jours offre au moins trois (sinon quatre) exemples de telles configurations, associant une façon de penser la société, des façons d’agir sur elle et des statistiques adaptées à ces situations. La crise des années 1880 a suscité la grande statistique du travail et de l’emploi. Celle de 1929 a été à l’origine des politiques macroéconomiques keynésiennes et de la comptabilité nationale ». Alain Desrosières, Prouver et gouverner, Une analyse politique des statistiques publiques, 2014
« Il semble y avoir peu de doute qu’en 1929, l’économie était fondamentalement malsaine […] Beaucoup de choses allaient de travers : […] La mauvaise répartition des revenus […] La structure déficiente des sociétés. […] Un mauvais système bancaire […] L’état incertain de la balance commerciale […] L’insuffisance des connaissances économiques. » John Kenneth Galbraith, La crise économique de 1929, 1955
Sommaire
I – HISTOIRE DES CRISES ÉCONOMIQUES ET COMPTABILITÉ NATIONALE
II – FACTEURS ET CARACTÉRISTIQUES DES CRISES ÉCONOMIQUES
III – LA NAISSANCE DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE AVEC LA CRISE DE 1929
IV – COMPARAISONS DES CRISES DE 2007-2009 ET 2020
V – FLORAISON DE TRAVAUX APRÈS LA CRISE DE 2007-2009 ET LE SCN 2008
VI – LE RAPPORT STIGLITZ-SEN-FITOUSSI
VIII – L’ADAPTATION DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE À LA CRISE DE 2020
IX – CRISES ÉCONOMIQUES ET(/OU) CRISES ÉCOLOGIQUES : QUELLES RÉPONSES ?
X – COMMENT INTÉGRER L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE DANS LA COMPTABILITÉ NATIONALE ?
Introduction
° L’objet de cette page est multiple :
- rappeler l’histoire des crises économiques et les crises les plus importantes, les comparer,
- faire une synthèse des principaux facteurs et caractéristiques des crises économiques,
- faire une synthèse des travaux économiques et comptables suites aux crises économiques.
- envisager comment la comptabilité nationale s’adapte aux crises ? On en donne ici plusieurs exemples,
- enfin montrer que la dimension environnementale et humaine est importante dans les crises économiques récentes.
° On s’appuiera ainsi sur les travaux de J.K. Galbraith, A. Sauvy, et J.M. Keynes pour la crise de 1929, de J. Stiglitz, J. Gadrey et D. Blanchet mais aussi d’autres économistes plus classiques pour les crises de 2009, 2020 et 2022.
° On analyse ici les crises et les causes des crises de 1929, 1973, 2007, 2020 et 2022 dont les effets se manifestent parfois avec un ou deux ans de décalage sauf la crise de 2020. On se limite ici à certains aspects économiques et non à d’autres faits spécifiques à la France (crise contextuelle et climat politique incertain).
° Faute d’informations précises, on ne parlera pas non plus des conséquences sociologiques de la crise qui ont néanmoins un impact sur certains agrégats de la comptabilité nationale, tel le développement du télé-travail (caractéristique majeure de celle-ci), réunions en zoom, gestes-barrière dans les entreprises, etc… On note juste que le manque de contacts entre salariés et clientèle complique la qualité du travail : aller voir une personne dans son bureau pour lui demander un renseignement plutôt que d’envoyer un mail plusieurs fois par jour, faire une formation en présence des personnes plutôt qu’en zoom, y assister aussi. panne d’ordinateur ou d’imprimante à domicile, etc…). Certes des coûts sont réduits (par exemple contrats faits avec une part importante de télétravail dans les banques,,..), sans compter les économies sur les frais de bureaux (partage des équipements dans une grande salle ou frais d’entretien,…) ou celles sur les transports (domicile-travail, réunions à l’étranger remplacées par celles en zoom,…).
° Le télé-travail a bien évidement des effets sur la production et sur la croissance. La qualité du service s’améliore-t-elle avec le télé-travail ? Qu’en est-il de la productivité ? On n’en sait rien ou du moins la réponse semblerait dépendre des types de travaux. Il était déjà difficile de mesurer les évolutions en volume des activités de services (voir page Partage Volume Prix.). Bref il est possible que des coûts diminuent pour les entreprises (bureaux) et les salariés (transports) et que des gains de productivité s’améliorent dans certains métiers. Mais tout ceci reste à préciser.
° Un rappel des façons dont quelques crises plus ou moins anciennes ont été vécues, et de leurs conséquences sur la comptabilité nationale, peut être utile pour réfléchir à l’ampleur des transformations qui peuvent résulter des crises récentes de 2008 et 2020.
1 – Crises économiques et évolution de la pensée économique
° Les grandes crises sont bien sûr des moments où les statistiques sont intensément mobilisées pour exprimer la gravité de la situation. Mais elles sont aussi des moments de grands débats, lors desquels le rôle de l’État dans la régulation et le pilotage de l’économie est profondément repensé. À chacune de ces crises correspond l’émergence de façons nouvelles de quantifier le monde social. De nouveaux modèles d’action impliquent de nouvelles variables et de nouveaux systèmes d’observation.
° L’histoire économique et politique des années 1880 à nos jours offre au moins trois (sinon quatre) exemples de telles configurations, associant une façon de penser la société, des façons d’agir sur elle et des statistiques adaptées à ces situations. La crise des années 1880 a suscité la grande statistique du travail et de l’emploi. Celle de 1929 a été à l’origine des politiques macroéconomiques keynésiennes et de la comptabilité nationale. La crise des années 1970 a été pensée dans les catégories néolibérales de la microéconomie, induisant des réformes de l’État centrées notamment sur des indicateurs de performances. Elle a montré aussi que certaines variables de la comptabilité nationale devaient être mieux estimées, telles les variations de stock.
° Ce qui interpelle toutefois depuis la crise économique de 1973, c’est le rôle important pris par l’environnement et le bien-être humain comme si ces deux aspects s’imbriquaient avec les crises économiques de 1973, 2009 et 2020 et 2022.
° Mais alors qu’on serait en droit d’attendre des réponses économiques comme lors de la crise de 1929, de nombreux travaux insistent sur ces deux dimensions. Le rapport Meadows pointait dès les années 1970 la dépendance de notre système de production thermo-industriel à l’égard de son environnement et interrogeait la durabilité de ce modèle.
° Du coup il y a coexistence de deux réponses (discours) face à ces crises, parfois diamétralement opposées.
- Certains économistes pensent que les réponses sont surtout économiques (dette publique, grands équilibres financiers, bouclier budgétaire pour limiter la hausse des prix comme les carburants, etc…). En témoigne la volonté du gouvernement de faire passer sa loi sur les retraites. Ce sont les agrégats classiques comme le PIB, les finances publiques, … qui sont primordiaux à estimer.
- Tandis que pour d’autres, la question ne serait plus seulement économique mais écologique et sociale. Certains prônent une croissance plus qualitative, mieux répartie, voire même une décroissance. Il convient d’adapter la comptabilité nationale pour aider à sortir de la crise économique en y intégrant les enjeux de soutenabilité environnementale et humaine (voir page PIB et bien-être).
° À cet égard, l’année 2008 est exemplaire :
- C’est l’année de la plus grande crise économique depuis 1929,
- C’est l’année du SCN 2008, finalisé en 2009, qui développe beaucoup (trop ?) les aspects financiers et monétaires comme les finances publiques et les produits dérivés financiers, et très peu les questions humaines (revenus par catégories de ménages) et environnementales,
- C’est l’année de création de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi qui remet son rapport en 2009 au Président de la république sur la mesure de la performance économique et du progrès social, s’interrogeant sur le bien-fondé des outils de mesure des résultats économiques, notamment du PIB.
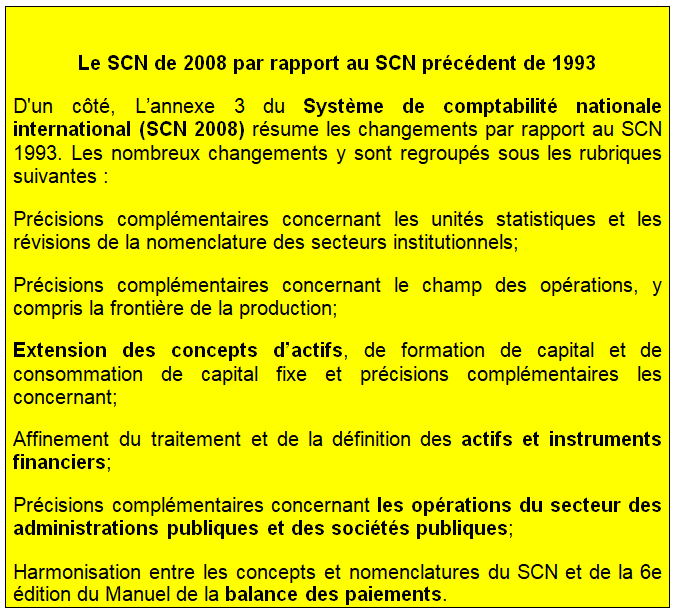
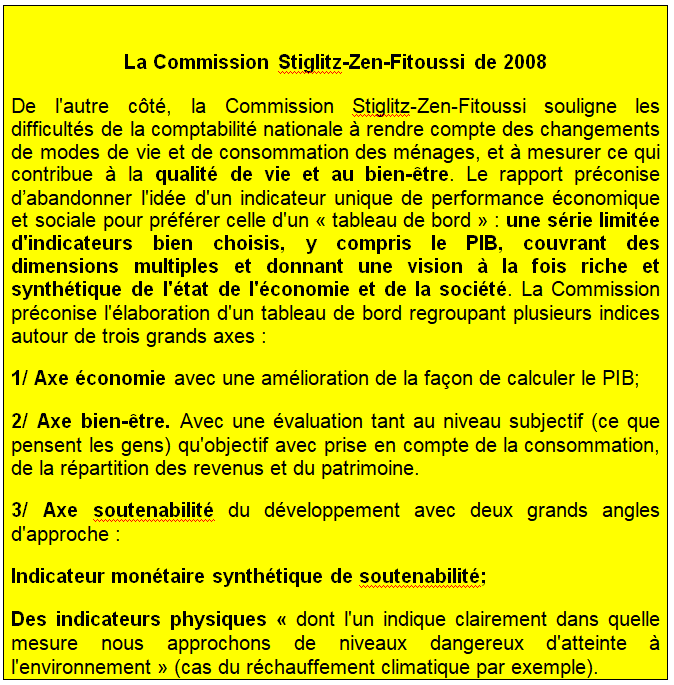
° Une décennie plus tard, les crises du Covid 19 et de l’énergie auraient trois caractéristiques : une perturbation des chaînes de valeur qui entraîne la pénurie de nombreux matériaux, une ingflation galopante des produits alimentaires, des matériaux et des produits énergétiques, et une dimension environnementale et humaine essentielle. Leur solution nécessiterait une coopération mondiale.
° Les exemples ne manquent pas sur de dernier point :
- Raréfaction des ressources naturelles (eau, gaz …) : La sécheresse entraîne la dégradation des sols donc la baisse de la production agricole dont les prix vont monter; les prix du gaz explosent en 2022,
- demande d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biogaz, géothermie,…) moins polluantes pour limiter les émissions de CO2,
- les intrants chimiques, pesticides et autres, ont des impacts négatifs sur la santé, sur la mise à mal des écosystèmes, et sur la disparition d’insectes pollinisateurs pourtant essentiels pour d’autres productions,
- l’absence d’eau empêche les centrales nucléaires de fonctionner,
- l’absence de neige ne permet pas aux stations d’ouvrir des pistes,
- l’exploitation intensive forestière peut favoriser le dérèglement climatique, voire le développement d’une pandémie,
- le réchauffement climatique devient l’un des principaux facteur de la montée des eaux et donc de l’exposition aux inondations des zones côtières,
- une volonté de productions plus propres (voitures électriques) mais qui se heurte aux impératifs économiques,
- les transports routiers et maritimes sont menacés, ainsi que les services les plus dépendants des transports, le tourisme international et le tourisme d’affaires fondés sur le transport aérien du fait de l’envolée du prix des carburants, des taxes à venir sur l’énergie, et de l’absence d’alternatives technologiques dans des délais prévisibles et à un niveau suffisant de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), etc….
2 – Adaptation des outils statistiques et comptables (et des politiques publiques) aux crises économiques
° Il est très instructif de comparer les crises entre elles, les politiques économiques qui tentent de les résorber notamment en matière de dépenses publiques depuis que Keynes a préconisé leur relance pour stimuler la demande effective et donc résorber le chômage. Il est aussi utile une foi de plus de faire des comparaisons internationales. Ainsi comme en 1929, la crise sanitaire a affecté toutes les économies en 2020 mais pas selon la même ampleur (voir page Reprise économique fragile).
° Il faut un certain temps d’adaptation des outils comptables et statistiques aux crises. Dans les années 1920, l’attitude la plus répandue chez les économistes est la vision « classique » mettant l’accent sur la relation offre-demande microéconomique sous-tendue par des hypothèses de rationalité. On croit que les développements économiques peuvent s’expliquer par une combinaison de théorie économique et de logique déductive. Les données statistiques à l’appui ne sont ni essentielles ni, dans la plupart des cas, disponibles. La métaphore de la « main invisible » d’Adam Smith prédomine. Certes, il existe des statistiques, notamment sur les différents types de production de biens. (tels les indices de production industriel aux États-Unis). Mais celles-ci sont dispersées, incomplètes, peu fiables, mal intégrées et loin d’être à jour.
° En 1929, il n’existe pas de méthode universelle permettant de définir et de mesurer le revenu national. Cette situation prévaut sans soulever de préoccupations notables tout au long des années 1920, période de prospérité. La comptabilité nationale, qui tient compte des structures économiques, n’apparaît qu’à la fin des années 30 voire au milieu des années 40. En 1954, J.K. Galbraith pointe du doigt les inégalités de revenu comme facteur important de la crise de 1929. Mais il faut presque attendre celle de 2009 pour que les premiers travaux comptables apparaissent sur cette question. En France, L’Insee a ainsi commencé à s’engager dans cette voie. Il a publié dès des données sur les inégalités. Il a présenté en 2010 une série d’analyses sur les très hauts revenus, les inégalités de patrimoine, le mal-logement.
° L’élaboration du SCN a tenté de s’adapter aux questions économiques importantes du moment. Ainsi lors d’une réunion tenue en avril 1939, le Comité d’experts statisticiens décide de mettre l’accent sur la mesure du revenu national, mais les travaux sont suspendus après le déclenchement de la guerre, plus tard cette année-là; ils seront seulement repris en 1945. L’évolution du SCN international de l’après-guerre est résumée au tableau suivant.
Historique des versions du Système de comptabilité nationale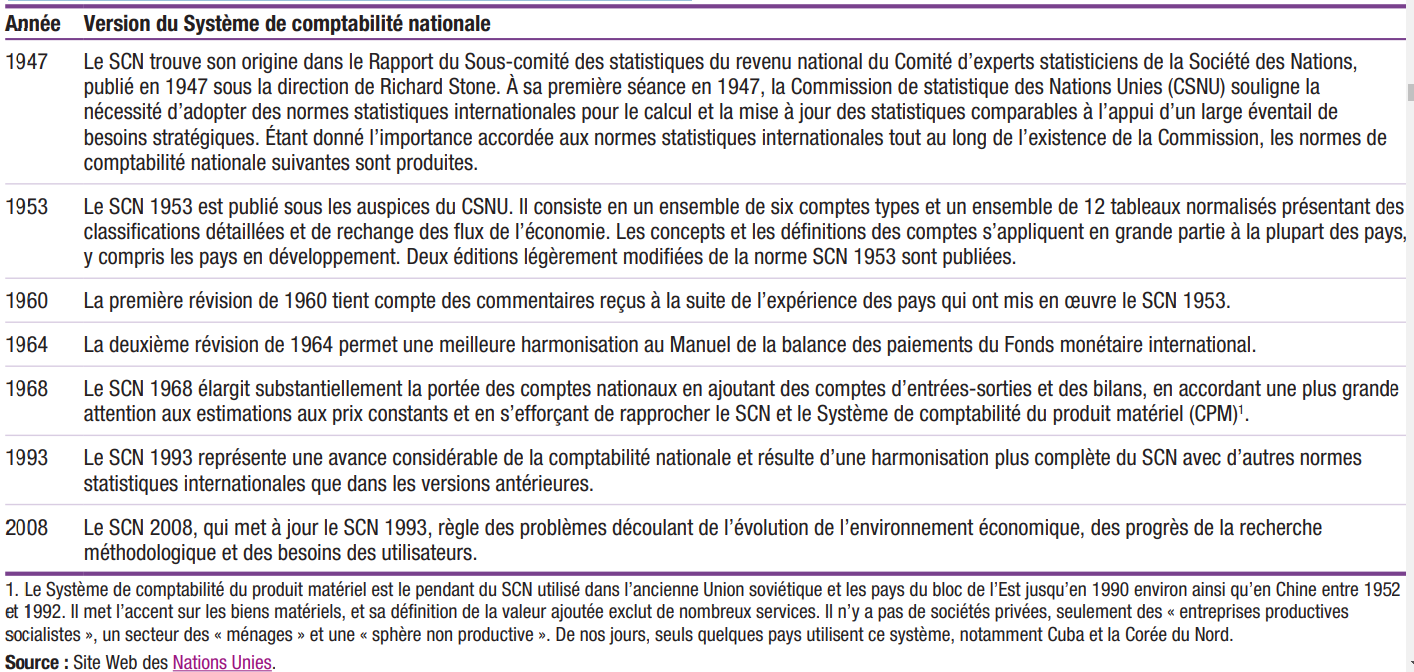
° S’agissant de la crise du Covid, les chiffres sont sortis en 2020 malgré la priorité de la mise en place de son dispositif de suivi hebdomadaire des décès [1] (les nombres entre crochet renvoient à la bibliographie en bas de page). La raison vraisemblable est que on est dans un cas de figure où la mission du PIB était la moins susceptible d’être mal comprise. Derrière son chiffre, il y a les revenus de la population, les risques de tomber au chômage ou de ne pas trouver d’emploi, les baisses de chiffres d’affaires et les risques de défaillance d’entreprises, les conséquences de tout cela pour les finances publiques. On peut donc dire que la comptabilité nationale s’est ici retrouvée pleinement dans son rôle, celui pour lequel elle a été conçue. Si ce que dit le PIB a échappé pour cette fois à bon nombre de ses critiques habituelles, c’est parce que tout le monde pouvait voir que, même transitoire, une baisse d’une telle ampleur allait forcément avoir une traduction dans les revenus et / ou ce qu’ils permettront d’acheter, selon ce qu’allait être l’évolution relative des grandeurs nominales et des prix.
° Les effets de la crise actuelle sont presque comparables à ceux caractéristiques du début des années Trente. Il n’empêche que la nature des deux événements est foncièrement différente. C’est un krach boursier à Wall Street fin octobre 1929 qui a déclenché la Grande Dépression dans un monde encore fragilisé par la sortie de guerre, et ce même si quelques indices de production commençaient à diminuer aux États-Unis dès le mois de juin 1929. Ce qui est arrivé en 2020 a eu pour origine un choc exogène, sanitaire.
° C’est le confinement, en France et dans les autres pays, qui a entraîné un choc d’offre très vite suivi par un choc de demande puisqu’il est devenu difficile, voire impossible, de consommer. Mais ce sont surtout les réponses à ces chocs qui se différencient complètement de celles qui ont suivi le jeudi 24 octobre 1929. Le contexte économique mondial n’avait aucun rapport avec celui d’aujourd’hui. La plupart des pays, dont la France, étaient revenus avec difficulté au système de l’étalon or, abandonné pendant la Première Guerre mondiale. Si bien que la Réserve fédérale américaine a augmenté son taux d’intérêt directeur juste après le krach dans l’espoir de sauvegarder sa réserve d’or.
° La Réserve fédérale américaine avait donné un tour de vis à sa politique monétaire pour éviter l’inflation, et n’avait pris aucune mesure pour sauver ses banques. Les États-Unis ont continué à diminuer leurs dépenses publiques jusqu’à l’instauration du New Deal en 1933. En Europe, les pays, après avoir abandonné l’étalon-or, à l’exception de la France qui a attendu le Front populaire pour le faire, se sont lancés dans des dévaluations compétitives stériles.
I – HISTOIRE DES CRISES ÉCONOMIQUES ET COMPTABILITÉ NATIONALE
Pour déterminer les réponses à apporter à une crise économique, il est utile de tirer des enseignements du passé. Mais la crise actuelle déclenchée par le Coronavirus (Covid-19) ne ressemble à aucune autre, ce qui complique la tâche des gouvernements et des banques centrales. Divers travaux ont analysé les crises économiques depuis la fin du XIX éme siècle.
Baisses du PIB dans les crises passées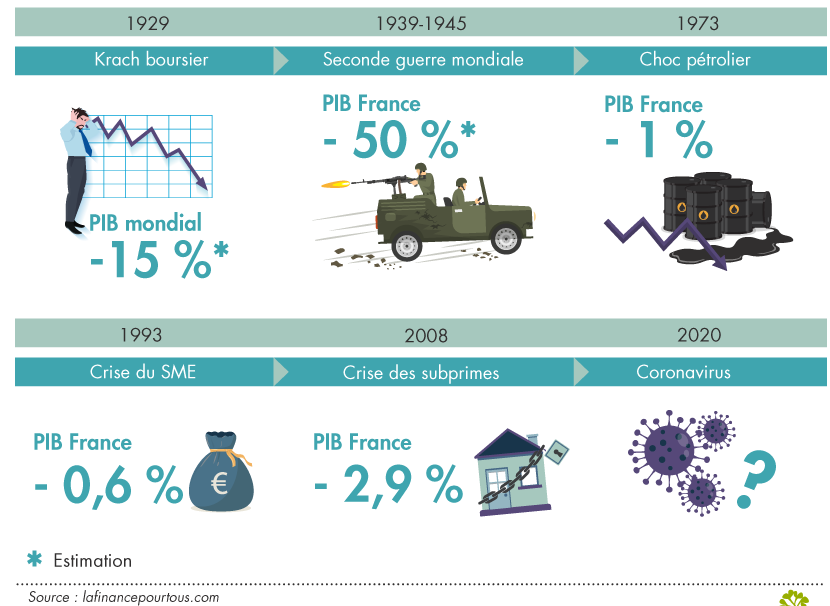
La première grande crise économique date de 1873 [2]. Mais à la différence de celles de 1873, 1929 et 2008, la plupart des crises financières récentes n’avaient pas une triple dimension à la fois financière, sociale et économique. Ainsi, la crise boursière de 1987 aurait eu une portée internationale mais sans impact économique majeur. De même, les crises financières qui ont secoué les pays émergents dans les années 1990 n’ont pas eu les répercussions sur l’économie mondiale que l’on pouvait craindre. Le « krach Internet » de 2000, s’il a mis un terme à l’épisode de « la nouvelle économie », ne s’est pas traduit par une crise économique durable.
En revanche, la crise de 2008, comme celles de 1873 et 2009, apparaît comme une des crises systémiques majeures qui ont entraîné une rupture dans le régime de croissance mondial dominant. La crise de 1873 est à l’origine d’une longue période (1873- 1896) de stagnation économique en Europe et aux États-Unis – qualifiée de première Grande Dépression – qui marqua la fin du XIXe siècle. Elle a ensuite été suivie par une phase de prospérité – les « Années folles » – associée à la première mondialisation financière. La crise de 1929 a occasionné une nouvelle rupture, encore plus profonde que la première Grande Dépression, qui a été marquée par des enchaînements déflationnistes brutaux, avec un effondrement généralisé de la production aux conséquences sociales dramatiques dans la quasi-totalité du monde industrialisé. Quant à la crise qui a débuté en 2007, elle a entraîné une chute brutale de la production à partir de 2009, avec des effets durables sur l’économie mondiale.
Ces trois grandes crises du capitalisme présentent de grandes différences, car l’environnement institutionnel, technologique et international a considérablement évolué de 1873 à 2007. Toutefois, au-delà du ralentissement économique durable qu’ils ont engendré, ces trois épisodes de forte instabilité du capitalisme ont d’importantes similitudes. Sept « marqueurs » caractérisent ces crises systémiques : (1) la prégnance du libéralisme économique ; (2) l’irruption de « pays neufs » ; (3) l’effondrement du système bancaire et financier ; (4) l’excès d’investissement et de production ; (5) un endettement excessif; (6) la montée des inégalités, et (7) le rôle des politiques économiques.
1/ La crise de 1929
Le krach boursier d’octobre 1929 a déclenché la première grande crise depuis le développement de l’économie capitaliste moderne au XIXème siècle. Elle a été causée par une bulle boursière et immobilière, alimentée par du crédit abondant, principalement aux États-Unis.
Quand les prix des actions et de l’immobilier se sont brutalement retournés, de nombreux spéculateurs endettés ont fait faillite. En conséquence, les banques ont à nouveau été en difficulté, et la crise s’est propagée à l’ensemble de l’économie et au reste du monde. Durant la crise de 1929, il n’y pas pas de prêteur en dernier ressort. La première faillite se produit en mai 1931 en Autriche avec l’effondrement du Kredit Andstalt de Vienne puis en Allemagne avec la faillite de la Nordwolle, une entreprise lainière, qui entraîne la chute de la Danatbank. On assiste alors et des retraits massif provoquant un début de panique; Les comptes de la Reichbank montrent que les dépôts ne couvrent plus que 40% de ses engagements. Quelques autres pays proposent de lui prêter de l’argent ; C’est aussi un peu la même situation en Grande-Bretagne où les banquiers étrangers ne lui prêtent guère d’argent du fait d’un déficit budgétaire important, alimenté par les allocations chômage. De plus, la réponse inadaptée du président Herbert Hoover, qui n’a pas soutenu l’économie via la dépense publique, a aggravé la crise.
Durant la Grande dépression des années 1930, le PIB mondial aurait baissé d’environ 15 %, et le PIB entre 1929 et 1932 des États-Unis d’environ 25 %. Ce n’est qu’en 1933 qu’il repart à la hausse aux États-Unis.
À la fin de l’été 1931, la crise « anglo-saxonne » parait terminée et semble suivre le scénario de 1921. Une reprise n’est pas encore perceptible, mais toutes les indices d’une stabilisation s’affichent. Les prix de détail ne baissent plus aux États-Unis, et les cours des matières premières ont cessé leur chute libre.
Cependant, après la nuit du 19 au 20 septembre 1931, la livre sterling est décrochée de l’or avec les trois conséquences relevées par Alfred Sauvy : Les conséquences de cette dévaluation ont une immense portée :
- Avec la répudiation des dettes interalliées et des réparations
- Elle enfonce l’économie mondiale dans une crise sans précédent d’où sortira la seconde guerre
- Elle place en porte à faux la France dont les dirigeants et l’opinion sont loin de comprendre la marche des évènements.
Tout se passe comme si la livre était restée la même et que les autres monnaies aient entrepris la folle gageure de se revaloriser d’un quart ou d’un tiers.
Le Royaume-Uni étant alors le pivot de toute l’économie mondiale, Londres est donc la place financière qui gouverne toute la finance, et tout le commerce international est libellé en livres. En automne 1931, la production industrielle a baissé de 17 %, les prix de gros de 28 %, les prix de détail de 8,5 %, la bourse de 51 % (avec un maximum de 60 %). « En France comme dans le monde 1931 est vraiment l’année noire ». Le chômage apparait, avec 190 000 demandeurs d’emploi. Le gouvernement du moment réagit par un plan de dépenses alimenté par des « crédits spéciaux » : la loi du 28 décembre 1931 prévoit 3 476 millions de nouvelles dépenses, qui sont financées par la même somme en obligations du trésor.
La France reste en bonne position par rapport au reste du monde ; à la fin de 1931, la baisse de la production industrielle sur la moyenne de 1929 est de 42 % en Allemagne, 37 % aux États-Unis, 33 % en Belgique, 27 % en Italie et 23 % en France.
En revanche, la dévaluation permet aux Britanniques de repartir d’un bon pied. La production industrielle est en hausse de 10 %, et le chômage baisse de 300 000 unités.
La perspective des élections générales de 1932 paralyse la vie politique en France et le budget de 1932 est largement déficitaire, ce qui n’est pas admissible pour l’opinion publique de l’époque. Le chômage explose en France en 1931 et 1932 et passe en moins de deux ans dans le secteur industriel de 2 % à plus de 15 %. Néanmoins, le taux de chômage reste moins élevé en 1932 que dans les pays les plus touchés, les États-Unis (36 %) et l’Allemagne (44 %). Les chiffres officiels du chômage sur l’ensemble de la population active au milieu des années 1930 donnent un taux de 7,5 %.
Il aura fallu un an en France pour digérer les conséquences de la dévaluation de la livre. En juin 1933, la production industrielle est à 91, contre 77 en juin 1932. La production d’acier est passée pendant la même période de 466 000 à 586 000 tonnes. L’indice du chômage, qui a culminé à 132 en août 1932, revient à 124.
La déclaration d’investiture de L. Blum aborde la question de la dévaluation : « Le pays n’a pas à attendre de nous ni à redouter de nous que nous couvrions un beau matin les murs des affiches blanches de la dévaluation. » Toutefois, le 26 septembre, la dévaluation est annoncée, comprise entre 25 et 35 %. Le bloc or suit. Le franc suisse est dévalué de 30 %, et les Pays-Bas dévaluent de 22 %. Partout, la dévaluation provoque une reprise rapide. La production industrielle remonte à 91 en décembre (+12 % en trois mois). L’ennui est que ces chiffres, fruit d’un calcul rétrospectif, ne sont pas connus des contemporains. Les prix sont en forte hausse. Selon Alfred Sauvy « de brillantes perspectives s’ouvrent pour l’industrie française maintenant qu’a sauté la chaîne d’or qui l’amarrait. »
La reprise de l’activité est forte et générale mais passe ainsi inaperçue. La durée de travail passe de 39,2 heures en octobre 1938 à 41,9 en juillet 1939. La production en France repart à la hausse en 1938. Cependant, la guerre éclate et bouleverse la situation
Au final, la crise de 1929-1938 n’a pas affecté les pays avec la même ampleur (deux graphiques suivants). Le PIB de la France et des États-Unis n’est guère plus élevé en 1939 qu’en 1929. Mais leurs deux profils d’évolution ne sont pas les mêmes.
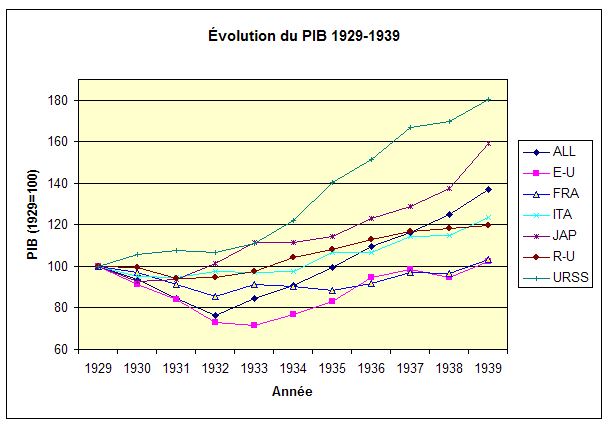
Évolution du revenu par tête (en $ en parité de pouvoir d’achat) de quelques pays entre 1925 et 1940
Source : Wikipédia; voir aussi La Crise économique de 1929, J.K. Galbraith, 1955; Histoire économique de la France entre les deux guerres, A. Sauvy
2/ La crise de 1968 et ses conséquences sur la Balance des Paiements (BdP)
Afin de répondre aux besoins du contrôle des changes mis en place en 1939 comme à ses obligations internationales du nouveau système monétaire international défini par les accords de Bretton Woods (1944) qui fixe notamment la parité des devises internationales avec l’or ou le dollar, la mission de production des statistiques de balance des paiements est confiée en 1945 à l’Office des changes, chargé de la conduite de la politique de change, puis en 1960 à la Banque de France [3]. Dès leur constitution, les statistiques de balance des paiements entretiennent ainsi un lien étroit avec le contrôle des changes dont elles semblent inséparables, tant du point de vue des méthodes que de la source des données. Les autorités françaises entendent orienter la reprise économique, en particulier les importations nécessaires pour la reconstruction de l’appareil productif. La balance des paiements devient alors l’outil central d’un dispositif visant à contrôler les entrées et sorties de capitaux liées au commerce international.
La source principale d’établissement de la balance des paiements provient en effet directement de l’activité de l’Office des Changes puis de la Banque de France, à savoir la collecte des transactions financières des « intermédiaires agréés » avec l’étranger. Ces derniers constituent les seules banques habilitées à effectuer des opérations en devises sur le marché des changes pour le compte de leur client. L’ « état des règlements », recension exhaustive des opérations des intermédiaires agréés, constitue ainsi la source première d’élaboration de la balance des paiements française dite « en règlements ». Ce schéma de production correspond à un modèle partagé par les banques centrales d’Europe continentale (Allemagne, Italie ou Pays-Bas). À l’inverse, selon une tradition anglo-saxonne, les instituts statistiques nationaux du Royaume-Uni et des États-Unis, et non les banques centrales, élaborent la balance des paiements à partir d’enquêtes réalisées auprès des entreprises non financières.
Si les règlements enregistrés sont ventilés selon la nature économique des opérations sous-jacentes (tableau suivant), le but premier demeure la conduite de la politique de change. L’objectif est de déterminer le besoin ou la capacité de financement de l’économie française vis-à-vis de l’étranger. Le titre « opérations de capitaux à court terme » correspond ainsi à la synthèse des entrées ou sorties de capitaux, issues des paiements courants et des opérations en capital de long terme (dans le tableau suivant, il s’agit du solde de 10 626 millions de Francs, provenant largement du secteur public). Dans ce cadre méthodologique, les statistiques de balance des paiements constituent le miroir des échanges financiers permis par la réglementation des changes et in fine la manifestation du respect des parités. La balance des paiements ainsi constituée « est destinée à expliquer et à justifier les variations des réserves de change ».
Présentation simplifiée de la balance des paiements : exemple de l’année 1968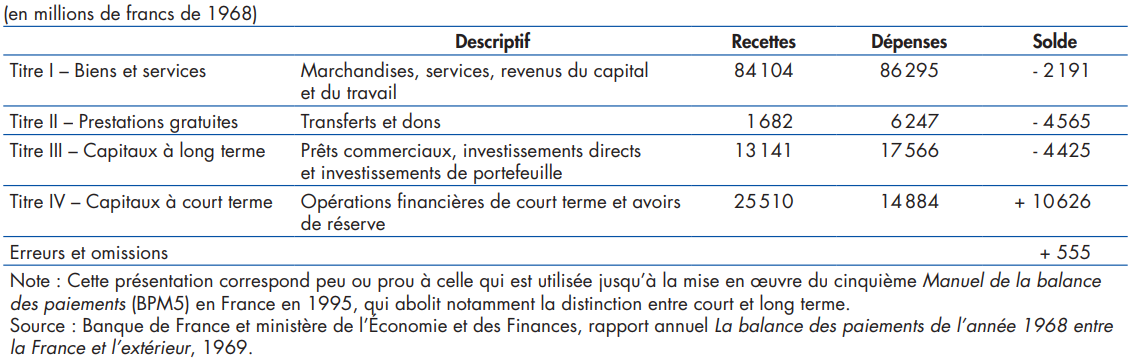
Cependant, très rapidement, les autorités économiques utilisent les statistiques de balance des paiements à d’autres fins que celles qui sont liées au contrôle des changes. En effet, la comptabilité nationale ne couvre pas les flux financiers en devises ni les flux de services et revenus avec l’étranger. Les statistiques de balance des paiements constituent alors la seule source d’information à ce sujet et deviennent de facto une source nécessaire et un complément de la comptabilité nationale pour les relations économiques extérieures. Les statistiques de balance des paiements constituent donc dès l’origine une somme d’informations économiques allant au delà de la seule synthèse des mouvements de capitaux. Toute la difficulté des choix statistiques de production de la balance des paiements réside dans la double nature de l’objet : un processus de production fondé sur les déclarations bancaires et centré sur l’objectif premier de statistiques de change, également appelé à produire une statistique servant à la politique économique générale du pays, sans qu’il ait été conçu à cette fin.
Fondée sur les données du contrôle des changes, la production statistique de balance des paiements fait face à une nouveauté radicale à l’occasion de la libération des changes entérinée par la loi du 28 décembre 1966. Toutefois, l’année 1967 constitue également une étape de la déstabilisation du système monétaire international tel qu’hérité de Bretton Woods. Les déficits courants continus des États-Unis déstabilisent les marchés des changes tout comme la crise de confiance de la livre sterling, qui aboutit à la dévaluation de 1968. La crise de confiance dans les grandes devises de réserve affecte ainsi les relations économiques dans leur entier, via le jeu des « termes de l’échange » et des mouvements de devises visant à échapper aux éventuelles pertes financières des exportateurs et importateurs. Dans le contexte de crise de confiance dans le dollar américain et la livre sterling, les règlements enregistrent ainsi en 1967 une accélération des paiements dans les devises menacées : + 38 % pour les États-Unis et + 29 % pour le Royaume-Uni par rapport à 1966. Ce mouvement correspond ainsi à un rapatriement avancé des recettes des exportateurs français depuis ces zones, alors que les exportations ne croissent en moyenne que de 13%. A l’inverse est observé un ralentissement des règlements d’importations en provenance des zones sterling et dollar.
En mai 1968, l’arrêt quasi-total de l’activité économique et les fortes augmentations de salaires résultant de la conclusion politique des événements sociaux conduisent à une vive augmentation de la production intérieure. Du fait du décalage dans la production, cela se traduit par une hausse des importations et un déséquilibre du commerce extérieur. Face à une telle situation, les autorités françaises réagissent afin de rétablir la confiance : le contrôle des changes est rétabli le fin mai 1968 avec des mesures de contingentement à l’importation et d’aide à l’exportation et les taux directeurs sont remontés par la Banque de France en juillet. Le léger rétablissement de la situation permet de libérer de nouveau les changes en septembre 1968, sans que cette mesure suffise à restaurer la confiance dans le franc alors que les spéculations sur la réévaluation du deutsche Mark sont fortes. Cette nouvelle crise monétaire internationale atteint son paroxysme à la fin de l’année, avec le rétablissement – définitif jusqu’aux années 1980 – du contrôle des changes fin novembre 1968.
« Les effets de la défiance à l’égard de la monnaie nationale sur les différents postes de la balance des paiements ont été extrêmement marqués ». Ainsi, on observe un décalage net entre les données douanières, qui enregistrent les mouvements de marchandises à la frontière, et les règlements de balance des paiements, résultant du « termaillage » ou jeu des termes de paiement. En effet, les exportateurs et importateurs tendent à adapter leur comportement selon les anticipations de change. En cas de menace de dévaluation de la devise nationale, les importateurs préfèrent accélérer leurs règlements, tandis qu’à l’inverse les exportateurs connaissent un tassement de leurs recettes, les entreprises étrangères adoptant une position attentiste. Lorsque les menaces s’accumulent sur le franc, au cours de l’année 1968 puis de l’année 1969 jusqu’à la dévaluation d’août, les règlements de balance des paiements témoignent ainsi d’une dégradation plus prononcée du solde des biens que les données douanières (graphique suivant). Dans les périodes de perte de confiance dans la devise française, l’accélération des règlements par les importateurs accentue la dégradation du solde, créant des décalages parfois importants entre les deux séries.
solde des biens douaniers et balance des paiements
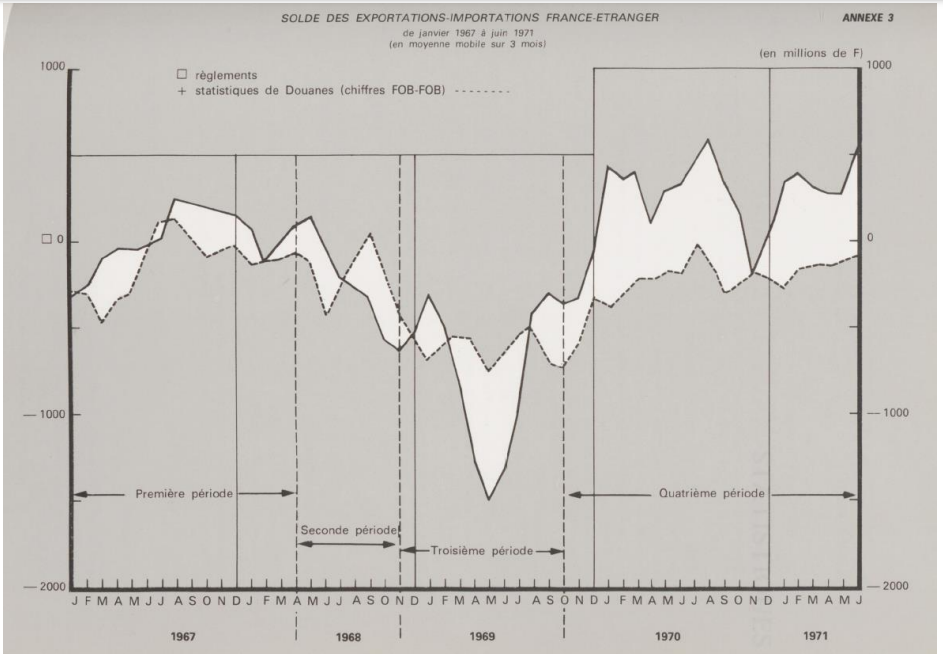 Source : « Influence des crises monétaires sur l’évolution de la balance des paiements de la France de 1967 à 1971 », bulletin de la Banque de France, 1972.
Source : « Influence des crises monétaires sur l’évolution de la balance des paiements de la France de 1967 à 1971 », bulletin de la Banque de France, 1972.
Ces accélérations ou retards de règlements par rapport aux opérations économiques « traduisent un réflexe de défense des agents économiques ; ceux qui détiennent des créances libellées en une monnaie menacée de dévaluation les convertissent le plus rapidement possible afin d’éviter une perte, alors que ceux qui doivent se libérer d’une dette attendent au contraire, pour acquérir les devises nécessaires, qu’elles se déprécient ». Si en 1967 le mouvement est plutôt favorable à la France, en 1968, afin de contrer les mouvements contre le franc, les autorités mettent en place des mesures visant à accélérer le rapatriement des recettes d’exportations en même temps qu’elles rétablissement le contrôle des changes le 29 mai 1968.
L’année 1968 révèle ainsi l’influence des sources financières sur les résultats de la balance des paiements. Si « la balance ainsi conçue donne une ventilation, d’une grande rigueur comptable, des mouvements de devises et de francs étrangers par nature d’opérations ou par catégorie d’opérateurs », une telle balance « en règlements » témoigne ainsi de ses limites pour une lecture économique de l’insertion de la France dans les flux mondiaux.
Dans ce contexte, la Banque de France expérimente une balance des paiements, non plus établie à partir des règlements bancaires, mais fondée sur les transactions, avec une première diffusion en 1972. Pour mesurer les échanges de biens, le nouveau modèle statistique consiste ainsi à partir des transactions enregistrées par les douanes à la place des règlements relevés dans les comptes bancaires. Les données douanières sont ensuite corrigées afin de correspondre aux définitions propres à la balance des paiements et pour prendre en compte l’écart entre règlements et paiements, dû notamment aux décalages de paiements (avances à la commande, crédits commerciaux, etc.). Elles sont complétées à partir de 1977 par un modèle économétrique dit ABS (« autres biens et services »).
Le modèle « en transactions » proposé par la Banque de France, diffusé de à partir de 1972, consiste à substituer aux données de règlements de marchandises les données douanières, tout en conservant, pour les autres rubriques, les résultats rapportés par les intermédiaires agréés. Un tel procédé statistique permet bien de répondre aux exigences du FMI d’enregistrer, autant que possible, les transactions effectuées entre une économie et l’étranger, tout en conservant l’exhaustivité propre à la source des règlements.
Les données de marchandises issues des douanes sont ensuite corrigées pour correspondre aux définitions de la balance des paiements (entre autres la fabisation voir page Correction CAF-FAB) et pour prendre en compte l’écart entre règlements et paiements (avances à la commande, crédits commerciaux, termaillage…). Sont en particulier identifiés les crédits commerciaux se rapportant aux biens et, dans une moindre mesure, à certaines exportations de services. À partir de 1977, un modèle économétrique dit « ABS » (pour « autres biens et services ») permet de ventiler directement, à l’aide d’un certain nombre d’informations financières fournies par les douanes, l’écart entre les statistiques douanières et l’état des règlements. Cet écart est ainsi réparti entre les paiements courants non comptabilisés dans les règlements du fait des pratiques commerciales (retards de paiement ou autres décalages non pris en compte par les douanes) d’une part, les capitaux de court terme correspondant à la politique de crédit à l’exportation ou à l’importation d’autre part, et, enfin, le résidu ou biais statistique du modèle (erreurs et omissions), incluant le termaillage, enregistré comme « autres crédits et termaillage ». Plutôt qu’une simple reprise des données douanières, ce qui ferait courir le risque de perdre une partie importante d’information économique, un modèle sophistiqué est ainsi mis en place pour conserver l’exhaustivité tout en distinguant plus clairement ce qui relève des paiements courants et des opérations de capitaux.
La publication concomitante de deux balances, une en règlements et une en transactions, à partir de 1972 permet de répondre au double enjeu de la balance des paiements, le contrôle des entrées et devises d’une part et une information économique plus générale d’autre part.
La libération des changes opérée à partir de 1967 rompt ainsi avec le contexte de l’après-guerre. Ce sont les mouvements massifs de capitaux survenus au cours de l’année 1968, initiés par les événements français et le contexte international mais permis par la libération antérieure des flux, qui remettent en cause la balance des paiements « en règlements ». Le jeu nouveau opéré par les acteurs du commerce international, qui tirent profit des différences de cours entre les devises, réduit en effet la qualité de l’information « de règlements » recueillie auprès des intermédiaires financiers, reflétant davantage la spéculation sur les devises que les échanges réels. À partir des années 1970, tirant les conséquences de ce « Mai 68 » des statistiques de balance des paiements, la Banque de France délivre ainsi, grâce à une nouvelle balance « en transactions », une information plus proche des flux économiques réels, nourrie de nouvelles méthodes notamment économétriques.
3/ Le choc pétrolier de 1973 et la mesure des variations de stocks
En 1973, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) coupe sa production en réponse au soutien américain à Israël lors de la Guerre du Kippour. Dans la foulée, le prix du pétrole brut est multiplié par quatre.
Ce choc pétrolier provoque une crise de l’offre (les coûts augmentent pour les entreprises productrices) et de la demande (les prix sont plus élevés pour les consommateurs). Cette crise conduit à une contraction du PIB de 1 % en France.
Contrairement aux attentes des conjoncturistes, la croissance de l’activité resta soutenue au cours du premier semestre 1974 (notamment grâce à l’investissement logement) et le chômage ne s’accrut pas [4]. Le maintien d’une croissance élevée (+ 2,3 % en glissement sur les six premiers mois) conjugué à l’accroissement de la facture énergétique entraînèrent alors un déficit extérieur important (1 % du PIB au premier trimestre et 2 % au deuxième) et une flambée des prix.
Cette évolution conjoncturelle apparemment favorable a, semble-t-il, suscité des doutes, parmi les responsables économiques, sur l’impact récessionniste du choc pétrolier. Aussi, pour ralentir la demande et l’inflation, ceux-ci mettent en place un plan de refroidissement de l’économie en juin 1974.
Ce plan utilise l’ensemble des instruments de la politique économique et vise la réduction de la demande, principalement celle des entreprises. Le poids de la fiscalité est accru par la modification de l’amortissement dégressif, et surtout par l’instauration de majorations exceptionnelles : majoration de l’impôt sur les sociétés (5,1 milliards), majoration de l’impôt sur le revenu partiellement remboursable (3,3 milliards). Le rythme d’engagement des dépenses publiques est ralenti. Le respect des normes de progression des encours de crédit est renforcé et la politique des prix est plus rigoureuse.
L’idée que le choc pétrolier aurait peu d’impact sur la croissance fut reprise dans les prévisions économiques associées au budget de 1975 élaborées au cours de l’été 1974. En effet celles-ci tablaient sur une croissance de 10 % des exportations, de 4 % des investissements et de 4,2 % du PIB marchand. Le vote d’un budget en équilibre pour 1975 confirme cette impression. Les dépenses y augmentaient moins que le PIB en valeur.
La politique de lutte contre la hausse des prix fut encore resserrée en septembre et en décembre 1974, avec la mise en place du prélèvement conjoncturel, qui avait pour objectif de stériliser les plus-values nées de l’inflation (loi du 30 décembre 1974).
Bien que les indicateurs conjoncturels dont on a disposé après la crise montrent que dès l’été 1974 la production industrielle commença à chuter fortement, il semble que l’entrée dans une récession sévère ait été encore mal perçue au cours de l’automne 1974. La longue grève des PTT en octobre a pu expliquer cette mauvaise perception du retournement conjoncturel. Quoiqu’il en soit la réorientation dans un sens plus expansionniste de la politique budgétaire ne se fera que progressivement durant les premiers mois de 1975, à un moment où le plan de refroidissement et la récession mondiale agissent fortement sur l’activité.
D’un point de vue conjoncturel, l’accroissement des investissements publics (État et grandes entreprises nationales) a été judicieux en 1975 dans la mesure où ils ont dus être exécutés rapidement. Mais les aides à l’investissement auraient eu des délais d’actions beaucoup plus lents (environ un an), de ce fait leur impact est souvent procyclique. Certes les commandes devaient être passées avant janvier 1976, mais leur réalisation s’est étalée tout au long de l’année à un moment où il aurait fallu répondre à la demande mondiale.
a) Les avancées de la Comptabilité Nationale suite à la crise de 1974 : de la mesure des variations de stocks ….
La récession de 1975 avait été suivie d’une forte reprise mondiale en 1976, d’où une relance des exportations (contribution à la croissance : + 2,1 points contre – 0,3 point en 1975). Les variations de stocks ont également accentué le cycle conjoncturel. Celles-ci avaient été accrues par des achats spéculatifs de matières premières à la fin de 1973 et au début de 1974. Au cours du second semestre de 1974 et des trois premiers trimestres de 1975 le mouvement s’est inversé du fait de la perception de la récession. C’est l’opposé qui est survenu dès le quatrième trimestre. C’est-à-dire sans prise en compte des mesures de relance. Comparaison des relances françaises de 1975 et 1981-1982 1975 avec le redémarrage de l’activité induit par la reprise mondiale et les mesures de relance. Au total les variations de stocks ont contribué pour 2,7 points à la récession de 1975) et pour 1,6 point à la reprise de 1976.
A-t-on bien mesuré la baisse très forte des variations de stock durant l’année 1974 ? II semble que la baisse des stocks de la fin de 1974 et du début de 1975 ait été sous-estimée dans les comptes nationaux définitifs. En effet, le recul de la production industrielle retenu dans les comptes est nettement inférieur à celui de l’indice mensuel de la production industrielle. Rappelons que les comptes pré-provisoires établis en mai 1976 à partir des comptes trimestriels (base 1962) donnaient une baisse de 3 % du PIB, les comptes provisoires (base 1971) publiés en septembre 1976 une baisse du PIB de 1,5% alors que les comptes définitifs (base 1971) donnent une stagnation du PIB en volume. On comprend pourquoi les comptables nationaux ont cherché à mieux mesurer les variations de stock par la suite .
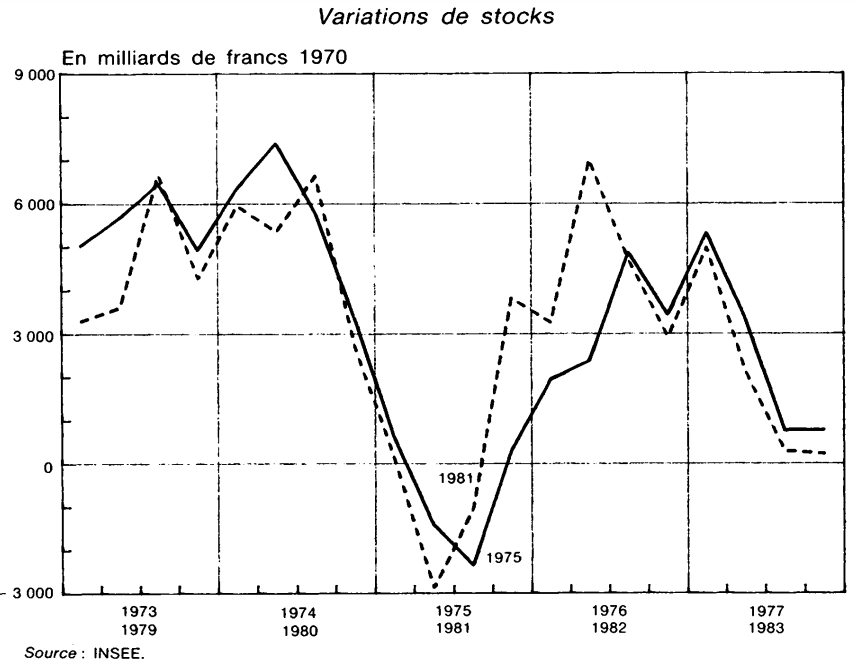
La politique économique de 1974 aurait ainsi joué un rôle plutôt procyclique. La politique restrictive a accompagné la récession mondiale. Les mesures de soutien ont été prises tardivement, et les aides fiscales à l’investissement ont agi avec retard. La mise en œuvre du plan de développement de l’économie française a correspondu au redémarrage du commerce mondial. Celui-ci a été favorisé par les politiques expansionnistes de l’ensemble de nos partenaires. Grâce à quoi la contrainte extérieure, sur laquelle bute toute politique de relance en France, a été allégée.
b) …. À une autre vision statistique et comptable qu celle issu de la théorie keynésienne
Au delà, la longue période de crise ouverte en 1975 par la brusque hausse du prix du pétrole a été vécue comme une complète remise en cause des modèles d’explication et d’action issus de la crise précédente : discrédit des politiques keynésiennes et de la modélisation macroéconométrique, critique du rôle de l’État, dérégulation, idéalisation des mécanismes marchands supposés efficients et autorégulés, financiarisation de l’économie, court-termisme des décisions au détriment des idées de prévision et de planification à long terme. Par ailleurs, la mise en place de l’Union économique et monétaire européenne et la création de l’euro confèrent une grande importance aux institutions de l’Union, et notamment à la Banque centrale européenne (BCE).
Ces évolutions marquent les productions des instituts de statistique publique, mais aussi, plus généralement, les usages des indicateurs quantitatifs, issus ou non de ces instituts. Ces usages sont inspirés des méthodes du new public management, diffusées en Grande-Bretagne dans les années 1980 et 1990. Cela est notamment le cas en France avec l’application, à partir de 2006, de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui s’appuie sur un grand nombre d’indicateurs de performances des administrations. Par ailleurs, la diffusion des techniques dites de benchmarking est caractéristique de la conception néolibérale de l’économie et du rôle de l’État, déjà bien anticipée par Michel Foucault. La méthode ouverte de coordination (MOC), utilisée par l’Union européenne pour orienter les politiques sociales, est un bon exemple de cette technique ; elle repose sur des palmarès des performances des États selon divers indicateurs quantitatifs.
4/ La crise du Système Monétaire Européen (SME) en 1993
En 1993, le PIB français se contracte de 0,6 % suite à la crise du SME. Cette crise résulte de la difficulté d’accorder les taux de change entre les pays européens avant la création de l’euro (la monnaie unique est d’ailleurs vue comme un moyen d’éviter ce type de crise).
Le mécanisme économique de cette crise est plus complexe que les précédentes. Pour simplifier, les pays européens s’engageaient à cette époque, à maintenir leurs taux de change fixes. Or, la réunification allemande entraîne une forte hausse de l’investissement pour équiper l’ex-Allemagne de l’est, plus pauvre que l’Allemagne de l’ouest. Cela conduit à une hausse des taux d’intérêt en Allemagne (plus de demande de capital conduit à une hausse de son prix, donc du taux d’intérêt), ce qui entraîne une appréciation du Deutsche mark (si les taux sont plus élevés en Allemagne, les investisseurs vont y placer leur argent, donc achètent du Deutsche mark, ce qui entraîne une augmentation de sa valeur).
Pour maintenir la parité avec le Deutsche mark, la Banque de France est contrainte d’augmenter les taux d’intérêt en France, ce qui conduit à une contraction de l’investissement et de la consommation.
Mais la grande affaire des années 80-90 est l’intégration monétaire européenne. Elle remet de nouveau en question l’établissement classique de la BDP. Elle pose toute une série de questions : Comment faire des statistiques nationales de balance des paiements dans le grand marché ? L’existence de balances des paiements « nationales » dans le grand marché est-elle alors compromise ? Quelle est l’approche monétaire de la balance des paiements ?
La constitution de la zone euro conduit à déplacer la dimension monétaire des balances des paiements du niveau national à l’échelon communautaire, tout en maintenant la lecture économique. L’ambitieux programme d’amélioration de la qualité statistique des balances des paiements nationales et de la Communauté, porté à la fois par la Commission européenne et par l’Eurosystème, confirme dès lors leur double nature, entre approche monétaire et diagnostic économique.
Il faut donc concilier divers objectifs : faire des statistiques au service de la nation. Mais aussi mesurer l’intégration nationale dans la Communauté européenne. Et donc trouver un équilibre de la production statistique, à la fois nationale et intégrée. Le schéma suivant montre l’importance de l’élaboration la BDP dans l’UE. En 1999, on élabore la première balance des paiements de l’UE et de la zone euro (schéma suivant).
On assiste alors à la disparition des sources historiques, à l’achèvement de l’héritage conceptuel fondé sur les entrées et sorties de devise, et à une redéfinition dans le champ régalien en même temps que l’intégration communautaire. Dès la fin des années 1980, les statisticiens de la balance des paiements de la Banque de France anticipent le profond renouvellement d’une de leurs sources traditionnelles, l’état des règlements. En effet, la fin du contrôle des changes, prévue pour le 1er juillet 1990 dans la Communauté économique européenne (CEE) mais anticipée à partir de 1987 en France, allait considérablement réduire la qualité de la source d’information que constituent les intermédiaires agréés, puisqu’ils ne sont plus le passage obligé pour effectuer des opérations avec l’étranger. La Banque de France, selon le principe de recherche d’information à la source, choisit de déployer son action auprès des entreprises mêmes selon les méthodes anglo-saxonnes. Toutes les entreprises dont les flux de règlements courants avec l’étranger atteignent un montant important, se voient attribuer la qualité de « déclarants directs généraux » (DDG). À partir de 1990, elles doivent ainsi déclarer leurs opérations directement à la Banque de France. Plus de 50% des informations collectées dans la balance des paiements proviennent des DDG en 1990, contre 10% en 1987.
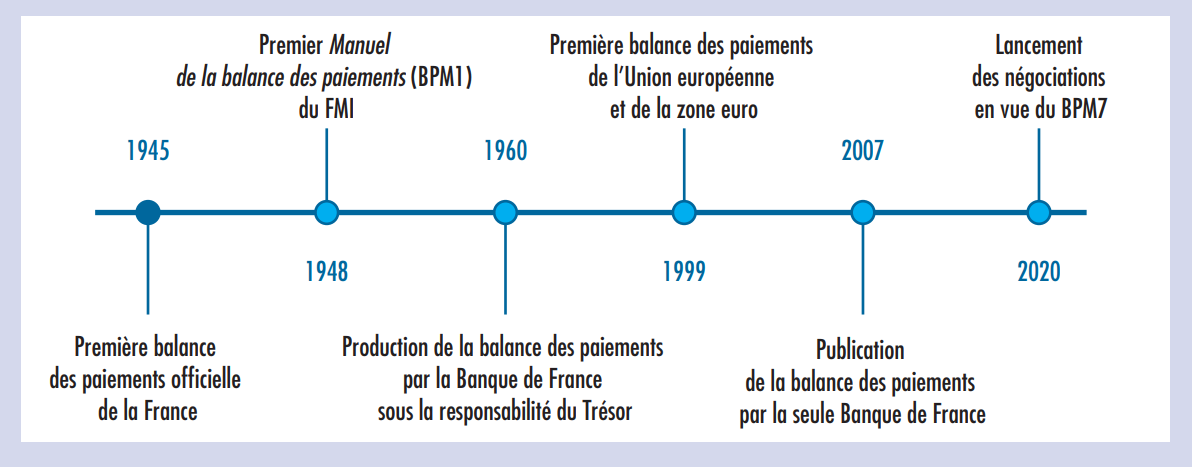
5/ La crise des subprimes en 2007
a) Une crise financière
La crise de 2007, dite des « subprimes » est assez similaire à celle de 1929. Elle est due à l’éclatement d’une bulle spéculative immobilière, qui a conduit à une crise bancaire, puis économique. Partie des États-Unis, elle s’est propagée au monde entier. En France, le PIB s’est contracté de 2,9 % en 2009, cette crise a donc été la plus violente depuis 1945.
Grâce à ces nouveaux instruments, les banques délaissent leurs activités traditionnelles de collecte des dépôts et d’octroi de prêts en faveur d’opérations plus rentables de trading, ou de « risk management ». Tout est fait pour fluidifier le transfert des risques qui, in fine, ont vocation à être disséminés auprès des épargnants. Cette dilution des risques crée un sentiment de fausse sécurité, qui incite les agents à la prise de nouveaux risques et à l’endettement. Un tel comportement a, naturellement, fortement contribué à la crise financière.
C’est la répétition de la crise de 1929 avec une durée plus longue avant la crise : 1980-2007 au lieu de 1920-1929. P. Jorion détaille tous les types d’emprunts aberrants proposés aux consommateurs : « interest only », où seuls les intérêts sont payés et le principal était remboursé à l’échéance, les ARM « adjusted rate mortgage », où les consommateurs paient un taux promotionnel pendant 2 ans, ou peuvent rembourser mensuellement moins que les intérêts dus, augmentant tous les mois le principal à régler à échéance ou les multiples mécanismes de refinancement permettant d’emprunter toujours plus.
L’ensemble de ces dispositifs ne pouvaient fonctionner que si le prix de l’immobilier poursuivait sa hausse. Mais les prix de l’immobilier avaient atteint un niveau aberrant. Un indicateur montrait dès 2006 qu’ils avaient atteint le double d’un niveau raisonnable par rapport aux revenus. Malheureusement, les mauvaises pratiques se sont multipliées pour attirer des ménages qui n’avaient pas normalement les moyens d’acheter un logement, avec les « prêts rapaces » aux taux dissuasifs. P. Krugman avance que «si le prix des résidences baissait de 20%, 13,7 millions de ménages se retrouveraient avec un prêt dont le montant est plus élevé que la valeur de leur logement. Le nombre se monterait à 20 millions si les prix devaient baisser de 30% ».
Pour P. Jorion, « la bulle de l’immobilier résidentiel » n’est qu’une des quatre raisons de la crise actuelle. Il y ajoute « un système financier en régime de bulle », « la titrisation des prêts hypothécaires » et « un ensemble de modèles financiers incorrects ». Il cite Keynes pour dénoncer la spéculation inhérente au marché : « quand la fructification du capital d’une nation se transforme en sous-produit de l’activité d’un casino, le travail est rarement bien fait ». Il a démontre comment les modèles financiers actuels sont complètement dépassés, reposant trop sur un passé normé.
Il reconnaît que certaines institutions finançaient leur prêt à long terme par des emprunts à court terme. Enfin, il souligne le rôle des nouvelles normes comptables, imposant de valoriser les actifs à la valeur du marché, même s’il y est favorable. Enfin, il montre bien comment le prix du risque immobilier était mal évalué car très variable.
Du coup, la financiarisation s’accompagne d’un renforcement des inégalités de revenus comme aux États-Unis (voir page Richesse et consommation). Les deux phénomènes ne sont pas seulement concomitants mais aussi liés entre eux. Le taux de marge s’est redressé dans tous les pays à partir de 1981. Tout l’accroissement des richesses aurait été accaparé par une petite minorité de la population. Des études économétriques suggèrent que la suraccumulation de crédit et l’expansion des marchés boursiers contribuent à l’accroissement des inégalités. L’analyse de micro-données de rémunération montrerait que cet effet tient pour bonne part aux surprimes de salaire dont les employés du secteur financier bénéficient. Cette analyse montre aussi qu’en finance comme ailleurs, les hommes perçoivent des rémunérations plus élevées que les femmes présentant des profils comparables.
Pour pallier la relative stabilité du pouvoir d’achat des salaires, les banques ont accordé beaucoup de crédits pour que les ménages achètent des biens immobiliers. Le mécanisme des « subprimes » est un peu plus compliqué : les banques ont revendu une partie de ces créances qui devenaient douteuses car elles savaient que les ménages ne pourraient rembourser. Ces créances ont été assimilées à des titres et achetées par exemple par des SICAV ou des fonds de pension.
b) … suivie d’une crise économique mais de courte durée
Le choix des périodes de référence est important. Si on compare d’abord la croissance du PIB en Europe et aux États-Unis, on constate tout d’abord que la « grande récession » de 2007-2009, provoquée initialement par la crise américaine des subprimes et la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, a eu approximativement la même ampleur en Europe et aux États-Unis [5]. Des deux côtés de l’Atlantique, le niveau d’activité économique chute d’environ 5% entre fin 2007 et début 2009, ce qui en fait la plus grave récession mondiale depuis la crise des années 1930.
La reprise commence courant 2009, et le niveau d’activité retrouve fin 2010-début 2011 quasiment le même niveau que celui de fin 2007. C’est alors que se produit en 2011-2013 une nouvelle rechute de l’activité en zone euro, alors que la reprise se poursuit tranquillement aux États-Unis (graphique suivant). La croissance finit par reprendre timidement au début de l’année 2013 en Europe, mais le mal est fait : à la fin de l’année 2015, le PIB de la zone euro n’a toujours pas dépassé son niveau de fin 2007, alors que les États-Unis ont connu une croissance cumulée de plus de 10% entre 2007 et 2015. Compte tenu de la croissance de la population, lente mais positive, notamment en France, le niveau de PIB par habitant en zone euro est à peine supérieure en 2016-2017 à ce qu’il était en 2007.
Les raisons de la rechute européenne de 2011-2013 seraient bien connues: alors que les États-Unis ont fait preuve d’une relative souplesse budgétaire afin de maintenir le cap sur la croissance, les pays de la zone euro ont tenté de réduire les déficits trop vite en 2011-2013, avec en particulier de trop lourdes augmentations d’impôt en France, ce qui a conduit à casser la reprise et à la montée du chômage, et pour finir la hausse des déficits et de l’endettement public que l’on prétendait vouloir réduire.
Pourquoi les Européens se sont-ils si mal coordonnés, transformant ainsi une crise venue du secteur financier privé américain en une crise européenne durable de la dette publique ? Sans doute parce que les institutions de la zone euro n’étaient pas conçues pour faire face à une telle tempête. Une monnaie unique avec 19 dettes publiques différentes, 19 taux d’intérêt sur lesquels les marchés peuvent librement spéculer, 19 impôts sur les sociétés en concurrence débridée les uns avec les autres, sans socle social et éducatif commun, cela ne semble pas fonctionner. Sans doute aussi surtout parce que la montée des égoïsmes nationaux a empêché les Européens d’adapter leurs institutions et leurs politiques. Concrètement, quand les marchés financiers ont commencé à spéculer sur la dette des pays d’Europe du Sud, à partir de 2010-2011, l’Allemagne et la France ont au contraire bénéficié de taux d’intérêt historiquement bas, et ne se pas préoccupés que le sud de la zone s’enfonçait dans la récession.
Niveau d’activité économique (PIB) volumes chaînés (2010), millions d’euros, base 100 en 2004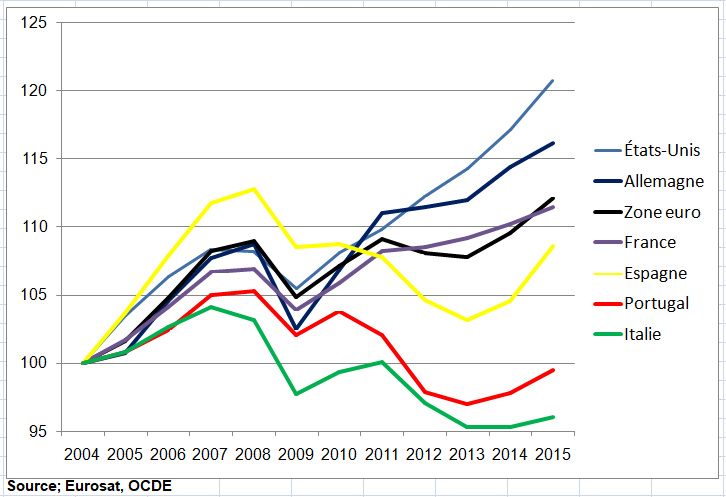
Dans l’UE-28, la reprise s’est traduite par une hausse de 2,1 % du PIB à prix constants en 2010, suivie d’une augmentation de 1,7 % en 2011 ; ensuite, le PIB a diminué de 0,5 % en 2012 et n’a plus évolué en 2013 avant une reprise de la croissance en 2014 (1,3 %). Dans la zone euro (ZE-19), les taux de croissance correspondants étaient les mêmes que ceux de l’UE-28 en 2010 et en 2011, tandis que la diminution a été plus forte en 2012 (-0, 8 %) et s’est poursuivie en 2013 (-0,4 %), avant une reprise de la croissance (0,9 %) en 2014, plus faible toutefois que celle enregistrée dans l’ensemble de l’UE-28. Aux États-Unis, la reprise a été légèrement plus forte que dans l’UE-28 en 2010 et comparable 2011. Si en 2012 la reprise s’est essoufflée dans l’UE-28, elle s’est maintenue aux États-Unis avec une croissance supérieure à 2,0 % au cours de la période 2012-2014.
Croissance du PIB réel, 2004–14, en % de variation en glissement annuel (source : Eurostat)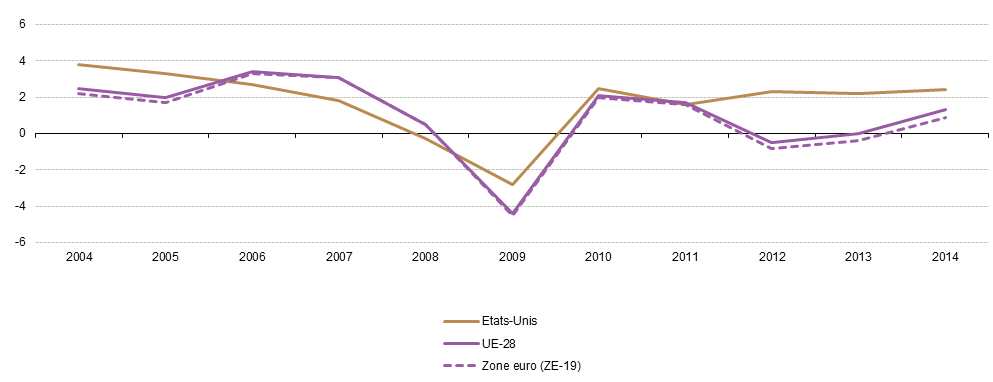
Au sein de l’UE, la croissance du PIB réel a varié d’un État membre de l’UE à l’autre et d’une année à l’autre. Après une contraction observée en 2009 dans tous les États membres de l’UE à l’exception de la Pologne, la croissance est réapparue dans 22 États membres en 2010 et elle a été au rendez-vous dans 24 États membres en 2011. Toutefois, en 2012, cette tendance s’est inversée, à peine moins de la moitié (13) des États membres ayant enregistré une croissance, tandis que ce nombre est passé à 17 en 2013 et à 23 en 2014 (sur les 27 États membres pour lesquels des données sont disponibles).
La crise économique et financière a aussi eu pour effet de ralentir la croissance globale des économies des États membres de l’UE au cours des dix dernières années. Les taux de croissance annuelle de l’UE-28 et de la zone euro (ZE-19) entre 2004 et 2014 ont atteint, respectivement, 0,9 % et 0,7 %. Les taux de croissance les plus élevés au cours de cette période ont été enregistrés en Pologne (taux de croissance moyen de 3,9 % par an) et en Slovaquie (3,8 % par an), suivis par la Roumanie (2,7 %), la Bulgarie, la Lettonie et Malte (toutes 2,5 %). À l’inverse, le PIB réel a globalement diminué entre 2004 et 2014 en Grèce, en Italie et au Portugal.
Dans l’UE, plusieurs activités ont particulièrement souffert de la crise économique et financière de 2007-2009 et de ses conséquences : l’industrie a subi la contraction plus forte, avec une baisse de la valeur ajoutée dans l’UE-28 de 12,6 % (en volume) entre 2007 et 2009 ; la production industrielle de l’UE-28 a encore diminué de 1,2 % entre 2011 et 2013. La construction a connu la contraction la plus longue et la plus importante, caractérisée par un recul de la production de 18,4 % entre 2007 et 2013, enregistré chaque année un nouveau recul : à ce titre, l’augmentation de 0,7 % enregistrée en 2014 pour la construction a marqué la première croissance annuelle du secteur en sept ans. Les services aux entreprises ainsi que le commerce, le transport, l’hébergement et les activités de restauration ont également enregistré des baisses relativement importantes de la valeur ajoutée en 2009, -7,1 % et -6,0 % respectivement. Ils ont enregistré deux nouveaux reculs, de moindre ampleur, dans la production en 2012 et 2013. % en 2010 de 4,2 % 2012. Des baisses moins importantes de la valeur ont été notamment observées pour d’autres activités au cours de la crise, en 2009, 2010 et 2013 pour ce qui est des activités financières et d’assurance et des arts, spectacles, activités récréatives et autres activités de services (graphique suivant)
Valeur ajoutée brute des activités tertiaires, UE-28, entre 2004 et 14 (2005 = 100) (Source : Eurostat)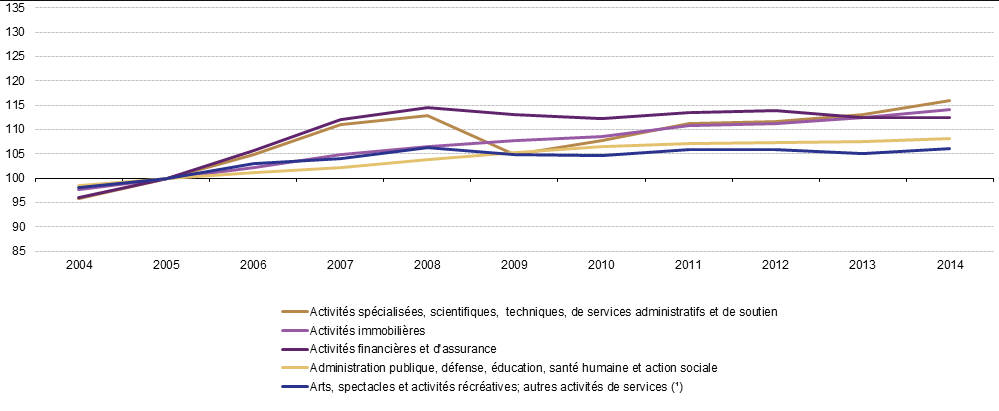
L’analyse de la productivité de la main d’œuvre par personne occupée au cours de la même période de dix ans (de 2004 à 2014) révèle une hausse (à prix courants) pour toutes les activités : les progressions se situent pour l ‘essentiel entre 16,9 %, pour le commerce, le transport, l’hébergement et les activités de restauration, et 30,9 %, pour l’industrie, tandis que seuls les chiffres liés à l’information et la communication et les services aux entreprises se trouvent en dessous de cette fourchette (3,0 % et 8,4 % respectivement).
Afin d’éliminer les effets de l’inflation, on peut également calculer la productivité de la main-d’œuvre par personne occupée à l’aide des chiffres de production en prix constants. Les données sur l’évolution de la productivité mesurée par la personne occupée ou par l’heure travaillée sont fournies dans le tableau suivant. Entre 2004 et 2014, la productivité de la main-d’œuvre par la personne occupée a augmenté en termes réels dans la quasi-totalité des États de l’UE, les seuls pays membres ayant enregistré un recul étant la Grèce, l’Italie et le Luxembourg (entre 2004 et 2012). Au cours de la période 2004-2014, la productivité de la main-d’œuvre par heure a travaillé dans tous les États membres de l’UE à l’exception de la Grèce et de l’Italie.
Productivité réelle de la main-d’œuvre, 2004–14 (2010 = 100) (Source : Eurostat)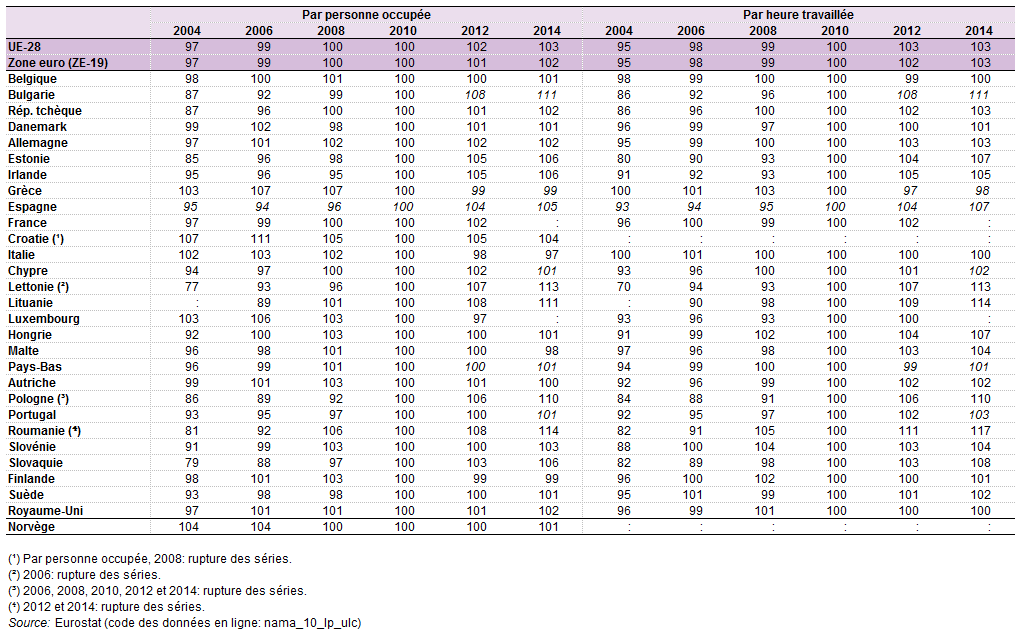
6/ Les États sont plus réactifs lors de la crise de 2020, tant sur le front monétaire que budgétaire, qu’ils ne l’étaient en 1929…
La crise sanitaire actuelle a déclenché une crise économique mondiale. L’impact exact de cette crise est encore difficile à quantifier, mais le choc a été extrêmement violent dans le monde entier, bien supérieur à la crise de 2008-2009.
Cette crise ne ressemble pas aux précédentes. Elle n’est pas causée par l’éclatement d’une bulle (la baisse des bourses est la conséquence et non la cause de la crise), ni par un problème d’ajustement des taux de change, ni par une envolée du prix du pétrole (celui-ci s’effondre), ni par des destructions massives causées par des bombardements. Le problème économique principal est le confinement de la population qui réduit la demande (les magasins non-essentiels sont fermés et les consommateurs confinés) et l’offre (beaucoup de travailleurs sont bloqués chez eux).
II – FACTEURS ET CARACTÉRISTIQUES DES CRISES ÉCONOMIQUES
La crise de 2008, comme celles de 1873 et 2009, apparaît comme une des crises systémiques majeures (triple dimension à la fois financière, sociale et économique) qui ont entraîné une rupture dans le régime de croissance mondial dominant . La crise de 1873 est à l’origine d’une longue période (1873- 1896) de stagnation économique en Europe et aux États-Unis – qualifiée de première Grande Dépression – qui marqua la fin du XIXe siècle. Elle a ensuite été suivie par une phase de prospérité – les « Années folles » – associée à la première mondialisation financière. La crise de 1929 a occasionné une nouvelle rupture, encore plus profonde que la première Grande Dépression, qui a été marquée par des enchaînements déflationnistes brutaux, avec un effondrement généralisé de la production aux conséquences sociales dramatiques dans la quasi-totalité du monde industrialisé.
Quant à la crise des subprimes qui a débuté en 2007, elle a entraîné une chute brutale de la production à partir de 2009, avec des effets durables sur l’économie mondiale. C’est dans un double contexte de mondialisation et de financiarisation de l’économie que survient cette crise. Or les évolutions qui en résultent, – mondialisation, spéculation financière, inégalités croissantes, surendettement des états – ne seraient pas vraiment estompées après 2009. Tandis que d’autres évolutions, elles aussi anciennes, se sont aggravées comme la dégradation de l’environnement et la question de la transition énergétique. De son coté le SCN 2008 et le SEC 2010, publiés en 2013, tout en renforçant les aspects financiers et monétaires, n’ont pas vraiment pu s’adapter à cette crise.
Ces trois grandes crises du capitalisme présentent de grandes différences, car l’environnement institutionnel, technologique et international a considérablement évolué de 1873 à 2007. Toutefois, au-delà du ralentissement économique durable qu’ils ont engendré, ces trois épisodes de forte instabilité du capitalisme ont d’importantes similitudes. Sept « marqueurs » caractérisent ces crises systémiques : (1) la prégnance du libéralisme économique ; (2) l’irruption de « pays neufs » ; (3) l’effondrement du système bancaire et financier ; (4) le surendettement des agents; (5) l’excès d’investissement et de production ; (6) la montée des inégalités, et (7) le rôle des politiques économiques.
1/ Le libéralisme économique et le laissez-faire
On constate que chacune des grandes crises est précédée d’une période de laisser-faire qui amène les gouvernements à sous-estimer les déséquilibres économiques et financiers engendrés par leurs politiques libérales. Les années qui précèdent la crise de 1873 correspondent à la première expérience de libéralisation des échanges commerciaux. Depuis le traité de libre-échange de 1860 entre le Royaume-Uni et la France, les pays industrialisés européens multipliaient les accords de libre-échange bilatéraux, tout en s’accordant la clause de la nation la plus favorisée, ce qui entraîna une libéralisation croissante des échanges. Ces politiques eurent pour effet d’accentuer les déséquilibres extérieurs des pays européens, à commencer par la France. La crise de 1873 a amené les gouvernements à prendre des mesures protectionnistes (tarifs Méline en France pour protéger les agriculteurs). Lorsque les effets dépressifs de la crise s’atténuent à la fin du XIXe siècle, les frontières s’ouvrent à nouveau, les échanges commerciaux et les flux financiers internationaux augmentent rapidement. Les gouvernements pratiquent le laisser-faire. Les mouvements de capitaux ne font l’objet d’aucun contrôle. C’est l’âge d’or de « la première mondialisation ». Interrompu en 1914, le processus de mondialisation fondé sur une « régulation concurrentielle » par le marché reprend dans l’entre-deux-guerres. Dans la seconde moitié des années 1920, les déséquilibres s’accumulent aux États-Unis, d’où partira la grande crise, sans que les gouvernements ne cherchent à intervenir.
La financiarisation de l’économie depuis les années 1980 s’est accompagnée d’un phénomène qui existait déjà du temps de Keynes mais qui a pris une ampleur telle qu’il modifie en profondeur le fonctionnement de l’économie, ce phénomène est la spéculation financière. La spéculation financière est devenue une activité économique à part entière qui entre en concurrence avec les activités productives car celles-ci sont généralement à la fois plus risquées et moins rémunératrices ; elle oriente les activités productives vers les industries du luxe, plus rentables car moins sensibles à l’effet prix ; elle maintiendrait les taux de profit et donc le coût du capital à des niveaux élevés. En effet, d’une part un coût du capital élevé étouffe l’investissement productif et donc la croissance, d’autre part il interdit le développement des techniques à haute intensité capitalistique, pourtant les plus productives, ce qui se traduit par un appauvrissement général. Au niveau international, il avantage les économies à faible intensité capitalistique et à bas coût du travail aux dépens des économies à haute intensité du travail et à salaires élevés.
.
2/ L’irruption de pays neufs
L’émergence de pays neufs semble être un autre trait caractéristique commun à ces trois grandes crises. Les années précédant 1873 voient, en effet, émerger des pays neufs, particulièrement dans le secteur agricole qui était alors stratégique. Les exportations agricoles en provenance du Canada, des États-Unis, de l’Argentine, de l’Australie et de la Russie (pays où la culture extensive prédomine et où par ailleurs le coût de main-d’œuvre est très bon marché) s’imposent au détriment des producteurs domestiques en France, en Allemagne et en Angleterre. La France, en particulier, voit sa production agricole durement atteinte, alors même que celle-ci représentait encore un pourcentage très important de son PIB.
Pendant la période qui précède 1929, les États-Unis, qui avaient calibré leur agriculture pour qu’elle subvienne massivement aux besoins du monde, sont à leur tour bousculés par un regain d’activité inattendu chez les vieux pays agricoles que sont redevenus après la guerre l’Allemagne et la France.
L’apparition de pays dits « émergents » en Asie et en Europe de l’Est, caractérise également les années précédant la crise de 2008. Ces pays adoptent un modèle de croissance tiré par l’exportation et mènent des politiques commerciales agressives, fondées sur les bas salaires et la sous-évaluation de leurs monnaies. Il en résulte une dégradation du commerce extérieur de la plupart des vieux pays industrialisés, à l’exception de l’Allemagne, avec des conséquences défavorables sur l’activité et l’emploi. Par suite de cette concurrence, ces vieux pays industrialisés se trouvent menacés collectivement d’une « récession par le commerce extérieur ».
La mondialisation a eu raison des politiques keynésiennes de relance par la demande dans la plupart des pays. En effet, la théorie keynésienne a été définie dans le cadre d’une économie fermée – ce qui ne lui enlève pas tout son intérêt car l’économie mondiale considérée comme un tout est une économie fermée – si bien qu’elle semble peu adaptée à une économie ouverte puisque, sous l’effet conjugué de la libéralisation des échanges et de la faiblesse de la croissance, ce sont les exportations – ou plus précisément l’excédent de la balance commerciale – qui viennent se substituer à l’investissement net comme principale composante de la demande primaire »
La mondialisation doit principalement son succès à la spécialisation qu’elle rend possible. Cette spécialisation est incontestablement une source d’efficacité mais elle présente une face négative, la dépendance qu’elle génère. Cette dépendance peut s’avérer désastreuse lorsque, pour une raison quelconque, un produit d’importance stratégique vient à manquer.
Pour un pays de taille moyenne, il semble cependant illusoire d’espérer se passer des importations, si bien qu’il est nécessaire de les financer par des exportations. De leur niveau dépendra très largement le revenu national, de telle sorte que le maintien de la compétitivité du pays face à ses concurrents sur les marchés mondiaux reste une question clé.
3/ L’effondrement du système bancaire et financier
Cette dimension des grandes crises du capitalisme est la plus connue. La Grande Dépression de 1873 débute le 9 mai à Vienne lorsque la bourse s’effondre. La crise se propage et affecte peu de temps après la Bourse de New York et les autres places européennes. Ces crises financières en chaîne sont déclenchées par la spéculation sur les chemins de fer et la sidérurgie, cœur de la révolution industrielle et technologique de la seconde moitié du XIXe siècle. On peut tracer un parallèle entre l’effondrement de la bourse de New York en septembre 2008 et les événements d’octobre 1929. Dans les deux crises, les krachs boursiers vont de pair avec la faillite de grandes banques aux États-Unis et en Europe. À chaque fois, la spéculation alimente des prises de risques excessives par les banques, dont l’interdépendance se traduit par une crise du système bancaire dans son ensemble. Des travaux récents ont montré que les crises financières prennent une dimension systémique à la suite d’une bulle spéculative lorsque l’effondrement des prix d’actifs déstabilise les banques – acteurs centraux du capitalisme – dont la défaillance se répercute immédiatement sur la sphère productive de l’économie. Les krachs de 1987 et de 2000 n’ont pas entraîné de crises systémiques, car ils ont été limités aux marchés boursiers et n’ont pas fragilisé les banques. La gravité des crises de 1929 et 2008 s’explique en partie par la gravité de la crise bancaire.
4/ L’excès d’investissement et la surproduction
Les crises les plus profondes se produisent lorsque l’investissement s’accélère au cours de plusieurs années consécutives jusqu’à ce que les capacités de production deviennent excessives par rapport à l’évolution de la demande globale finale. On trouve trace d’un tel facteur de crise durant les périodes qui précèdent 1873, 1929 et 2008.
Les historiens qui se sont penchés sur la crise de 1873 ont relevé une chute des dépenses d’investissement dans les années de crise. En particulier, la construction des chemins de fer, qui avait connu un essor remarquable dans les années 1840 à 1870, s’essouffle au début des années 1870 jusqu’en 1890.
Les années 1920 avaient également connu des dépenses d’investissement importantes. En France, ce mouvement correspond à la phase de reconstruction du pays, après la guerre. Dès que la crise boursière a éclaté, les entreprises ont réalisé qu’elles avaient collectivement trop investi au regard de la demande finale globale. Le recul brutal de leurs dépenses d’investissement contribua alors nettement à la chute de la production, de l’emploi et du revenu.
De même, la période qui précède la crise de 2008 s’est caractérisée par un fort accroissement des capacités productives dans l’économie mondiale, particulièrement dans les pays de la périphérie. Les firmes transnationales des pays du centre ont contribué à ce processus d’accumulation productive par leurs investissements directs, en particulier dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ce comportement révélait alors un optimisme excessif des entreprises concernant l’évolution de la demande qui leur serait ultérieurement adressée. La récession qui a suivi la crise financière a mis au grand jour l’excédent des capacités productives dans le monde, ce qui a contribué à aggraver les tensions dépressives à l’échelle internationale.
5/ Le surendettement
Dès la fin des années 1990, certains économistes notent que l’économie mondiale repose sur des niveaux jamais atteints de dettes, s’appuyant les unes sur les autres et créant une situation économique particulièrement instable qui pouvait déboucher sur une grave crise économique à l’aide d’un élément déclencheur. De manière classique, cet excédent mondial de liquidités, qui est la contrepartie de l’endettement généralisé, se porte sur l’immobilier et les matières premières, dont les prix augmentent fortement durant les années 2000, ce qui provoque une inflation mondiale à un niveau élevé.
Le mécanisme de la création de la dette, dettes privées comme dettes publiques, l’absence de séparation entre banques d’affaire et banques de dépôt ont été notés par de nombreux économistes. Le cas islandais, décrit comme un miracle peu de temps auparavant, se révélant typique d’un système où la politique d’endettement et le gonflement des bilans des principales banques locales durant les années 2000 atteint des niveaux dépassant plusieurs fois le PIB de l’Islande[. En 2008, les niveaux de la dette mondiale ont atteint des records. Certains ont accusé la décision d’Alan Greenspan, alors à la tête de la Fed de baisser les taux directeurs de la Fed à 1 % pendant un an. Cette politique aurait engendré un montant énorme de prêts qui aurait conduit à un boom insoutenable.
Les prêts hypothécaires américains auraient été, à l’été 2007, l’élément déclencheur de la crise financière qui a entraîné la crise économique de 2008-2010. En effet, les banques ont fait des prêts à des taux raisonnables à des acheteurs n’ayant pas nécessairement le salaire adéquat pour payer les taux d’intérêt. Donc, les acheteurs n’étant pas en mesure de payer leur hypothèque, des milliers de personnes se sont retrouvées en situation de faillite. L’origine en est marquée par un communiqué émis le 9 août 2007 par BNP Paribas. Il indiquait que la banque suspendait la cotation de trois de ses fonds du fait de « l’évaporation complète des liquidités » de certains segments de marchés américains. Ce qui pousse certains économistes à placer l’origine de la crise dans l’endettement des agents économiques américains. S’ils n’ont pas à eux seuls provoqué une crise d’une telle ampleur, les prêts hypothécaires à risque (subprime) et ensuite la fermeture de deux fonds de la banque Bear Stearns sont les éléments ayant déclenché le mouvement touchant tout le système financier déjà fragilisé. Les économistes rappellent néanmoins la différence d’échelle existant entre les risques liés aux subprimes qui ne dépassaient pas 600 milliards en 2007 et dont la moitié sera récupéré et les crédits sans flux d’amortissement qui étaient de 12 000 milliards de dollars à la même période. Les subprimes sont tout au plus l’amorce qui fait déclencher une crise de la dette.
6/ Les racines sociales des crises
Le déclenchement de la crise des subprimes aux États-Unis en 2007 vient de ce que le recours massif à l’endettement des ménages des classes sociales moyennes et inférieures, destiné à pallier la baisse du pouvoir d’achat de leurs revenus, a atteint ses limites. Il en est résulté un effondrement de la demande privée états-unienne, qui a entraîné un fort ralentissement des pays émergents, privés de leurs débouchés aux États-Unis. Ainsi, les racines de la crise ne peuvent être recherchées uniquement dans les sphères financière et productive, mais se trouvent aussi dans la distribution des revenus, qui s’est caractérisée par une montée des inégalités et une modification du partage de la valeur ajoutée au détriment des revenus du travail. Ce rôle des inégalités de revenus a été mis en avant par J.K. Galbraith à propos de la crise de 1929. Ce dernier étudie les crises de 1929 et de 2008 et montre l’importance des inégalités sociales dans les deux crises. Au cours des « Années folles », la consommation des ménages états-uniens des classes moyennes s’était fortement développée, notamment grâce au crédit. C’est ce qui a rendu ces derniers vulnérables au moment de la crise à partir de 1929.
La spéculation financière accélèrerait la concentration des richesses car, à ce jeu, le plus riche gagne ; La financiarisation de l’économie se traduit par une concentration croissante de la richesse. Celle-ci modifie sensiblement le fonctionnement de l’économie. En effet, la consommation des plus riches est relativement indépendante de leur revenu, si bien qu’elle constitue une demande primaire qui va stimuler la production et donc l’activité dans l’ensemble de l’économie. En retour, les ménages les plus riches reçoivent des revenus de la propriété et des profits tirés de la spéculation. Cette demande primaire des plus riches peut se substituer à l’investissement net, c’est-à-dire que si elle continuait à se développer, elle pourrait, à terme, maintenir l’activité en l’absence de croissance et poursuivre durablement le creusement des inégalités sociales. Ainsi, en favorisant la hausse des cours des actifs financiers et la baisse des salaires, la financiarisation de l’économie creuse, lentement, insidieusement, mais inexorablement, les inégalités sociales.
7/ Le rôle déterminant des politiques économiques
La profondeur et la durée des crises du capitalisme dépendent en grande partie des politiques menées par les autorités publiques. Il est établi que la gravité de la crise bancaire, avec la faillite d’un grand nombre de banques, est directement liée à l’absence d’intervention de la Fed en tant que prêteur en dernier ressort. Ce laisser-faire des autorités politiques et monétaires américaines est l’une des causes majeures de la profondeur de la crise de 1929. À l’occasion de la crise de 2008, les banquiers centraux – tirant les leçons de leur gestion catastrophique de la crise en 1929 – sont intervenus massivement et efficacement pour prêter en urgence aux banques commerciales en difficulté. Ce qui a évité un effondrement du système bancaire international. En revanche, on ne peut que constater la timidité des réformes financières et fiscales des gouvernements actuels, soumis aux injonctions des marchés et des lobbies financiers. Dans ces conditions, la poursuite de l’instabilité économique et financière n’est pas à exclure.
III – LA NAISSANCE DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE AVEC LA CRISE DE 1929
1/ La crise de 1929 est marquée par une chute du revenu national, la production, la consommation, etc…
En 1929, les marchés boursiers mondiaux s’effondrent, et la Grande Dépression commence. La demande finale chute et les taux de chômage atteignent des niveaux sans précédent.La situation économique désespérée est évidente aux yeux de tous, mais il est difficile d’en cerner les causes sous-jacentes.
a) Les premiers agrégats macro-économiques
Dans cet environnement, les années trente à quarante du 20ᵉ siècle représentent une période très féconde d’accumulation de travaux d’estimation du revenu national de premières extensions de ceux-ci à des agrégats de la dépense finale – consommation et formation de capital –, ou encore un début de réflexion sur le recours éventuel à une approche comptable, sans oublier les recherches d’isolées comme C. Clark en Angleterre [7]. Celui-ci a tenté d’identifier les tendances de la production, de la distribution et du revenu au sein de l’économie britannique […]. C. Clark croyait qu’une fois l’économie répartie en ses opérations constituantes, elle pourrait être reconstruite dans son ensemble de manière à montrer l’apport respectif de chaque activité. On attribue généralement à C. Clark l’adoption du terme “produit national brut” pour désigner le chiffre représentant la valeur de tous les biens et services produits au sein d’une économie au cours d’une période donnée. Enfin c’est lui qui développe la typologie des 3 secteurs primaire, secondaire et tertiaire si utile pour définir par exemple des politiques agricoles et industrielles aux États-Unis (voir ci-dessous).
Aux États-Unis, S. Kuznets, un autre théoricien de premier plan, défend des idées à peu près semblables. Il participe activement aux études du National Bureau of Economic Research (NBER) sur les comptes et la mesure du revenu national américain. Mais les chiffres du PIB avant 1945 ne sont donc que des estimations calculées rétrospectivement. En 1934, une évaluation du revenu national des États-Unis pour la période 1929-1932 a été donnée ; en outre, il a été prolongé jusqu’en 1919-1938, puis jusqu’en 1869. Bien que Kuznets n’ait pas été le premier économiste à essayer cela, son travail était si complet et méticuleux qu’il a établi la norme dans le domaine. Il a ainsi aussi inventé la notion de produit intérieur brut (PIB) et ses travaux se ’sont généralisés après la seconde guerre mondiale.
Dans le même temps, J. M. Keynes développe une hypothèse révolutionnaire concernant la macroéconomie. Publié en 1936, son livre, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, présente une théorie macroéconomique qui justifie les politiques interventionnistes des administrations publiques visant à contrer le cycle des affaires. Cependant, l’application de ces idées à ce moment-là est grandement entravée par le manque de données statistiques sur la macroéconomie. Cependant la crise de 1929 a provoqué un intense effort de réflexion. La théorie présentée par Keynes va fournir une base conceptuelle à la mesure d’ensemble des notions de revenu, de dépense et d’épargne et à leurs interrelations. La théorie keynésienne est née avec la crise de 1929. Keynes met au point les grands agrégats économiques : la consommation et l’épargne des ménages, l’investissement des entreprises, celui des Administrations Publiques,…. C’est le premier exemple des conséquences de la crise économique sur la comptabilité nationale, en l’occurrence son apparition.
La demande des ménages correspond à leur consommation. Celle-ci génère une production qui elle-même génère des revenus pour les entreprises, ces revenus sont distribués aux ménages. Le problème est que, du fait de leur désir d’accumulation, les ménages n’utilisent qu’une partie de leur revenu pour consommer. La demande des ménages est donc toujours inférieure à la production qu’elle génère, si bien qu’elle ne suffit pas à maintenir l’activité. Pour initier et développer la production, une autre demande, que l’on peut qualifier de primaire, est nécessaire. Dans une économie en croissance, c’est l’investissement net des entreprises qui joue le rôle de demande primaire. Keynes a le mérite de suggérer ainsi l’idée d’un mécanisme générale, particulièrement sur les relations entre l’épargne et l’investissement.
En l’absence de croissance, l’investissement net s’annule, il n’y a plus de demande primaire, la demande des ménages ne peut suffire à maintenir l’activité, c’est la crise. Le blocage de l’accumulation provoque donc l’effondrement de la demande. La conséquence en est qu’une économie ne peut rester en régime stationnaire sans intervention extérieure, soit elle est en croissance, soit elle est en dépression. Pour remédier à cet inconvénient, les politiques dites keynésiennes consistent à compenser l’insuffisance de la demande des entreprises par la demande de l’État.
L’État exerce une action positive sur la demande par ses dépenses, une action négative par ses impôts. Son impact réel sur la demande provient donc du déficit public, c’est lui qui va jouer le rôle de demande primaire lorsque l’investissement des entreprises est défaillant. Les politiques keynésiennes consistent à compenser l’insuffisance de la demande des entreprises par la demande de l’État.
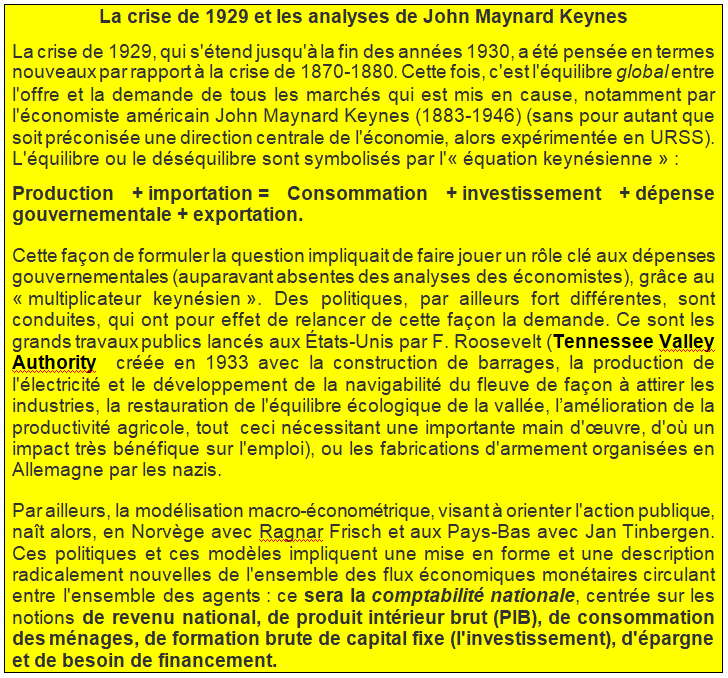
b) Le New-Deal
Aux États-Unis, les économistes du « brain trust » de Franklin Roosevelt observent dès 1932 la conjonction d’une surproduction des entreprises et d’une sous-consommation des ménages. Ils ne connaissent pas encore vraiment les théorises des économistes. Tout au plus Rexford G. Tugwell est un spécialiste des questions agricoles. Mais c’est surtout Adolph A. Berle qui apporte au brain trust sa connaissance des mécanismes du crédit, du système industriel, et ses idées de la place du gouvernement dans la vie économique en publiant The Modern Corpoaration and Private Property, qui analyse les liens entre le crédit et le monde des affaires.
La crise frappe particulièrement le monde paysan (crise de mévente) et le monde ouvrier (chômage). Le New Deal implique des politiques fédérales de régulation des marchés agricoles et de soutien aux chômeurs, notamment par des emplois publics. F. Roosevelt développe plus ou moins ses objectifs et ses remèdes lors de la campagne présidentielle de 1932.
Mais après son élection, quand il reçoit J.M. Keynes en 1935 (dont il ne comprend pas bien les théories), il a diminué les dépenses publiques de manière à rétablir l’équilibre budgétaire, ne faisant surtout que des réformes structurelles dans les 100 jours suivant son élection : Ce premier New Deal comprend un grand nombre de mesures en faveur de la monnaie et du système bancaire en général, de l’agriculture – Agricultural Adjustment Act (AAA) -, de l’industrie –National Industrial Recovery Act (NIRA) – et de la lutte contre le chômage. De nombreux programmes visant à créer des emplois furent ainsi lancés dès 1933, et les réformes s’enchaînèrent très rapidement. Mais ce n’est que dans un second temps que le New Deal vit l’apparition des premières formes d’État-providence aux États-Unis, telle la création de la sécurité sociale (assurances vieillesse, santé, chômage) et la donc la forte relance des dépenses publiques (bref des mesures keynésiennes).
Les statistiques de l’agriculture et de l’emploi sont alors complètement transformées par la méthode des enquêtes par sondages aléatoires. Des chômeurs sont même recrutés pour effectuer sur tout le territoire ces nouvelles enquêtes, qui seront développées en Europe après la guerre. Dans ce contexte de profond changement de l’action publique, des enquêtes statistiques qui semblent porter, au fil du temps, sur des sujets apparemment identiques, changent en fait de contenu et de signification. Ainsi, les enquêtes antérieures sur les budgets ouvriers, qui ne concernaient que des familles de milieux populaires, deviennent, à partir des années 1950, les « enquêtes de consommation des ménages ». Elles portent désormais sur toutes les classes de la société et visent notamment à quantifier la variable « consommation » de l’équation keynésienne. Elles servent aussi à déterminer les coefficients de pondération des biens de consommation entrant dans le calcul de l’indice des prix, qui lui aussi concerne dorénavant les dépenses de toute la population et non plus seulement celles des seuls ouvriers.
c) Les nouveautés statistiques et les premières applications de politique économique dans les décennies suivantes
Par ailleurs, l’État-providence, tout juste esquissé à la suite de la crise de la fin du xix e siècle, se développe largement et prend un nouveau sens dans le contexte keynésien. En effet, les protections apportées par les assurances chômage, les allocations familiales, les retraites et même l’assurance-maladie contribuent à amortir les baisses de revenus et de consommation entraînées mécaniquement par les crises économiques. Ainsi, les crises de 1975, 1993 et 2001 ont eu des effets beaucoup moins dramatiques que celle de 1929. Il en a été de même en 2008-2009.
Caractéristique de l’importance fortement croissante accordée à ces notions depuis la grande crise de 1929, on commence vers la fin de la décennie à se préoccuper de la normalisation internationale des statistiques du revenu national. Celles-ci sont un des trois domaines, avec les statistiques bancaires et celles de la balance des paiements, pour lesquels le comité des experts statisticiens de la Société des Nations lance un tel processus en avril 1939 (étouffé dans l’œuf du fait de l’éclatement des hostilités).
C’est la période de la seconde guerre mondiale qui va finalement accélérer l’accouchement de la comptabilité nationale en tant que telle et son utilisation spectaculaire dans les politiques économiques et financières au service, vu les circonstances, des politiques tout court.
Les années 1940 à 1943 sont de plusieurs points de vue remarquables. La comptabilité nationale va prendre forme de manière étroitement liée à des utilisations d’analyse et de préparation de politiques globales. Les travaux des années trente avaient été largement consécutifs au choc de la Grande crise et à l’ébranlement économique et social qu’elle avait provoqué. Pour beaucoup elle mettait en jeu le système économique dominant, mais pas la survie des nations démocratiques elles-mêmes. Les estimations du revenu national développées alors se situaient donc largement dans le prolongement méthodologique des travaux antérieurs. Ainsi l’agrégat calculé était-il le revenu national entendu comme « net au coût des facteurs ». En quelques années, ces deux caractéristiques vont se trouver mises en question et les agrégats de production et de dépense vont être mis sur le même plan que l’agrégat de revenu lui-même, avant un peu plus tard de le supplanter pour une longue période dans les comptes nationaux naissants.
La période des années 1950 à 1980 a vu le développement de vastes systèmes d’enquêtes sociales et économiques, orientées en partie, mais non uniquement, par les besoins de la comptabilité nationale, créée en France par Claude Gruson. Un autre grand thème de cette période est la lutte contre les inégalités sociales, non seulement de consommation, mais aussi d’accès à l’école, à la santé, à la culture. Ces inégalités sont pensées en termes de groupes sociaux, à travers la grille des « catégories socioprofessionnelles », alors largement utilisée par la statistique publique, par la recherche universitaire et par les instituts de sondages commerciaux. Du côté des méthodologies, la macroéconométrie, introduite en France par Edmond Malinvaud (directeur de l’Insee de 1974 à 1987), est mise en œuvre dans des modèles d’inspiration plus ou moins keynésienne, jusqu’aux années 1980, avant que n’intervienne la « théorie des anticipations rationnelles », qui discréditera pour un temps les politiques keynésiennes.
2/ L’analyse de J.K. Galbraith sur la crise de 1929
Par la suite des économistes ont analysé la crise de 1929. Selon Galbraith, cinq faiblesses de l’économie américaine semblent avoir eu un effet particulièrement direct sur la chute de la production durant la décennie 1930-1940.
a) Une mauvaise répartition des revenus.
Il semble certain que les 5% de la population ayant les revenus les plus élevés en 1929 représentaient à peu près le tiers de tous les revenus distribués, La proportion de revenus personnels perçus sous forme d’intérêts, dividendes et loyers était à peu près le double de celle des années qui suivirent la seconde guerre mondiale. Cette répartition très inégale signifiait que l’économie dépendait d’un haut niveau d’investissement ou d’un haut niveau de consommation de produits de luxe. Les riches ne pouvant acheter de grandes quantité de pains ne peuvent dépenser leur argent qu’en produits d’investissement (nouveaux équipements ou nouveaux projets). Mais ces dépenses sont soumises à des influences plus erratiques et à des fluctuations plus grandes que les dépenses pour le pain ou le loyer chez un ouvrier. Ce niveau élevé de ces dépenses de luxes et d’investissement devait être particulièrement sensible aux nouvelles accablantes de la Bourse en 1929. Selon Galbraith, les taux d’accroissement annuel pour les biens de consommation durables, tels que les voitures, maisons, équipements domestique et similaires, représentant généralement de la catégorie des gens allant de l’aisance jusqu’à la richesse, était de 5,9%.
b) La structure déficiente de sociétés.
Dans les années 20, on assiste à une marée montante de fraudes dans les sociétés. Leur faiblesse la plus importante était inhérente à la nouvelle structure des holdings et des sociétés d’investissement. Les holdings dominaient de larges secteurs dans les services publics, les chemins de fer,… . Ici comme pour les les sociétés d’investissement, il y avait le risque constant du retour en flamme du système du levier (rendement économique ou dividendes – intérêt) jouant en sens inverse. En particulier, les dividendes des compagnies d’exploitation payaient l’intérêt sur les obligations des holdings en croissance. L’interruption des dividendes signifiait : défaut de paiement sur les obligations, faillite et effondrement de toute la structure. Dans ces conditions, la tentation était grande les investissement en matière d’équipement afin de continuer à payer des dividendes. Or ce sont biens d’équipement qui connaissent la plus forte croissance avant 1929 (+6,4% par an contre +28% pour les biens de consommation). Cela ajouta aux pressions déflationnistes. Ces dernières limitèrent les gains des sociétés. Progressivement, les revenus furent affectés au paiement des dettes. Emprunter pour investir devint impossible.
c) Un mauvais système bancaire
Le système bancaire possédait une faiblesse inhérente dans le grand nombre d’unités indépendantes. Quand une banque coulait, les biens des autres étaient gelés tandis que les déposants voyaient un avertissement à aller retirer leur argent. Ainsi une faillite en entraînait d’autres et celles-ci s’étendaient en chaînes. Dans les six premiers mois de 1929, 346 banques firent faillite. Quand les revenus, l’emploi et les valeurs baissèrent à la suite de la crise, les faillites bancaires allaient devenir épidémiques. Partout, les gens riches et pauvres se rendirent compte du désastre grâce à la force persuasive de la nouvelle leur apprenant que leurs économies avaient été liquidés.
d) Une balance commerciale américaine fragile (exportations déclinantes, dépendant d’économies extérieures elles-mêmes fragiles et endettées),
Les pays étrangers ne peuvent couvrir leur balance commerciale négative avec les États-Unis par des versements en or, du moins par pour longtemps. Cela signifie qu’ils devaient , soit augmenter leurs exportations vers les États-Unis, soit réduire leurs importations, soit ne pas rembourser leurs emprunts passés. Le gouvernement américain agit rapidement pour éliminer la première solution – que les comptes soient équilibrés par des importations plus importantes – en augmentant sérieusement les tarifs douaniers. Par conséquent, les dettes y compris celles de guerre, ne furent pas réglées et il y une brusque chute des exportations américaines. la réduction ne fut pas énorme au regard de la production américaine, mais ellr contribua aux difficultés générales et fut particulièrement sensible aux agriculteurs.
e) L’insuffisance des connaissances économiques et les mauvaises décisions de l’administration américaine, insistant sur l’équilibre budgétaire et rejetant toute politique constructive, qu’elle soit fiscale ou monétaire
Probablement influencé par les idées de Keynes, le Président Hoover réduisit les impôts. Il demanda aux entreprises de maintenir leurs investissements ainsi que leur salaires afin de favoriser les dépenses. Mais les réductions d’impôts furent négligeables. Les dépenses d’investissement et les salaires ne furent pas réduits jusqu’à ce que les circonstances aient entraîné elles mêmes leur réduction. Par la suite l’orthodoxie triompha, à savoir un budget équilibré. Cela signifiait qu’il ne pourrait augmentation des dépenses de l’État pour développer le pouvoir d’achat et soulager la misère. Les principes d’équilibre budgétaire ne pouvaient tenir au milieu de des complexités des années Trente. le chômage massif avait modifié les règles; mais presque personne n’essaya de repenser le, problème à fond et d’une manière totalement nouvelle.
À coté se trouvait l’épouvantail de quitter l’talon-or et plus inquiétant de risquer l’inflation. En 1931 et 1932, le risque d’inflation était quasi nul. Pourtant il aurait fallu injecter de la masse monétaire pour relancer l’économie. Mais les conseillers n’en analysaient pas cependant le danger (de la déflation). La peur de’ l’inflation renforça l’exigence d’un budget équilibré et limita les efforts pour diminuer les taux d’intérêt. La dévaluation du dollar fut, évidement, écarté. Malgré les limites de la politique monétaire en période de crise, peu d’économistes souhaitaient utiliser cette arme fragile. Le rejet d’une politique fiscale (impôts et dépenses) et d’une politique monétaire équivalait au refus de toute politique économique constructive. Les conséquences en furent profondes.
3/ L’analyse d’A. Sauvy de la crise de 1929
En 1929, la Comptabilité Nationale n’existe pas. En France, A. Sauvy écrit un livre « Histoire économique de la France entre les deux guerres « Ce livre aurait pu s’intituler « Une histoire de l’ignorance économique», car c’est bien l’ignorance qui est ici en cause et qui constitue la thèse centrale de l’ouvrage.
Pour prendre l’exacte mesure des erreurs économiques commises, il faut en effet garder à l’esprit l’état d’ignorance économique qui règne à l’époque. L’inflation, la flexibilité des devises, les problèmes commerciaux autant de phénomènes auxquels nous nous sommes habitués depuis lors, sont à la fois inédits dans les années 20 et longtemps délibérément délaissés. D’une manière générale, tout ce qui se rattache à l’économie monétaire est mal connu et considéré avec méfiance. Les français feront une tardive et douloureuse expérience de ces premiers bouleversements monétaires. Il leur faudra un long apprentissage pour s’y adapter.
Une bonne partie du livre est consacrée à l’état et aux moyens de la connaissance économique. Le dogme libéral est a priori hostile à la moindre intervention de l’État. Une telle attitude de méfiance explique le rudiment des techniques d’observations et de prévisions. Ce manque de bases économiques est donc patent à tous les niveaux : cette lacune est manifeste dans l’opinion publique et les mentalités, elle est relayée par les hommes politiques, encouragée par l’inexistence d’observatoires économiques.
Dans les années 20, on ne voit pas la moindre ébauche de comptabilité nationale. Les comptes budgétaires et les échanges extérieurs restent les éléments essentiels de la politique économique. La notion de comptabilité nationale et même de comptes économiques est si peu présente à l’esprit que les bilans établis après la première guerre mondiale pour mesurer les pertes de guerre recèlent de nombreuses erreurs. Ici ou là sont entrepris des comptes comme sur l’année 1924 mais sans l’essai sera sans lendemain entre les deux guerres. Les questions de production tiennent encore peu de place dans les préoccupations. L’optique « marche des affaires » (mesure de l’indice des valeurs boursières) l’emportait sur l’optique production. Survient la crise de 1929. Non seulement les pronostics restent résolument optimistes dans les quelques modèles de prévision en place aux États-Unis mis avant la crise, mais la baisse de la production restera longtemps contestée, par amour propre ou manque de franchise.
En France, la statistique générale se bornait à publier quelques indices de séries chronologiques corrigé des variation saisonnières, notamment l’indice de la production industrielle. Mais dans les milieux patronaux et libéraux, la seule idée d’observation économique impliquait des interventions, jugées, dans le principe même indésirables. Du coté des syndicats ou des partis avancés, ne se manifestait pas un désir net d’éclairer convenablement les actions à entreprendre.
Le revenu national ne fait l’objet d’aucun calcul officiel et le concept lui même est peu répandu. La seule tentative est le calcul annuel des revenus privés publiée chaque année dans la Revue d’économie politique. Le total correspond à peu près à la notion de revenu des ménages mais en raison de l’insuffisance des données de base et des erreurs de méthode, les résultats obtenus sont sensiblement inférieurs à la réalité. les mouvements dans le temps n’étant pas non plus fidèles à la réalité. C’est en Australie qu’a eu lieu la première tentative pour bien distinguer la production de richesse et celle de revenus distribués ou gagnés. La balance des comptes n’est pas davantage prise en considération que le revenu national. L’idée de lier revenu national, balance des comptes, budget en un tableau unique n’est pas encore mûre.
De même l’absence de comptes de la nation, même sous une forme rudimentaire, et la nette insuffisante diffusion des statistiques existantes, ont pour résultats, en France, des erreurs considérables de politique économique, erreurs que l’on doit attribuer à la contradiction entre les objectifs poursuivis et les moyens employés et à la non connaissance des données élémentaires sur lesquelles doit s’appuyer la politique envisagée. La France s’enfonce ainsi en 1934 et 1935 dans l’aventure, sans issue, de la déflation. Lorsque sera créé en 1938 l’institut de conjoncture, il est déjà trop tard.
IV – COMPARAISON DES CRISES DE 2007-2009 ET 2020
Il est très instructif de comparer les crises entre elles et d’un pays à l’autre.
1/ La baisse de l’activité en 2008-2009 et 2020
L’année 2020 fut celle d’un choc inédit pour l’économie mondiale comme pour l’économie française. Aucune zone du monde n’a été épargnée et la récession se mesure en plusieurs points de PIB dans la plupart des pays jusqu’à dépasser 10 points de PIB pour certains.
La France ne fait pas exception et affiche une des pertes d’activité les plus fortes des pays développés. La récession en France est certes plus modérée qu’en Espagne ou au Royaume-Uni mais similaire à celles en Italie, au Portugal ou en Autriche. Elle est pire que celle en Allemagne ou aux États-Unis et au Canada.
Le choc d’activité entraîné par les confinements au printemps et à l’automne 2020 est sans équivalent sur la période de l’après-guerre. L’économie française a déjà connu des crises économiques dans le passé (choc pétrolier, crise du SME, crise des subprimes…) mais aucune n’avait eu des conséquences aussi fortes en termes de PIB. Ainsi, la récession de 2020 apparaît presque trois fois plus profonde que celle des subprimes, qui était déjà un événement exceptionnel dans la trajectoire de l’économie française.
Cependant, si la récession de 2020 se singularise par sa soudaineté et son amplitude, elle se distinguerait aussi de celle des subprimes par le profil de récupération attendu (graphique suivant). Le rattrapage, partiel, des pertes du deuxième trimestre 2020 a été d’autant plus spectaculaire au troisième trimestre 2020 que le choc précédent avait été violent, ce qui démontre la capacité de rebond de l’économie. La récession est commandée par les mesures de confinement et les revenus sont globalement maintenus grâce aux politiques économiques (mesures sociales). Lorsque l’on arrête les mesures de confinement, l’activité rebondit, ce qui fait une différence de nature importante entre cette récession et les précédentes, liées à des enchaînements économiques plus profonds et persistants. Selon les prévisions de l’OFCE, en cas de dés-épargne partielle en 2022, l’économie française devrait récupérer son niveau de PIB par habitant d’avant-crise au premier trimestre 2022, soit deux ans après le déclenchement de la crise, et même finir l’année 2022 un peu au-dessus de 2 % du niveau d’avant-crise. La crise des subprimes a été bien moins brutale, mais le processus de récupération a été plus lent, et au bout de trois années, le PIB par habitant était encore inférieur de 2 % à son niveau d’avant-crise.
Il reste que l’on ne sait pas exactement quels seront les impacts des nouveaux variants dans les mois à venir et quelles seront les mesures des pouvoirs publics ? Quels seront aussi les comportements des consommateurs : puiseront- ils dans leur épargne? Il subsiste donc beaucoup d’incertitude sur l’avenir. Rien n’est écrit d’avance.
PIB français par habitant (indice 100 au 1er trimestre 2008 et au 4e trimestre 2019)
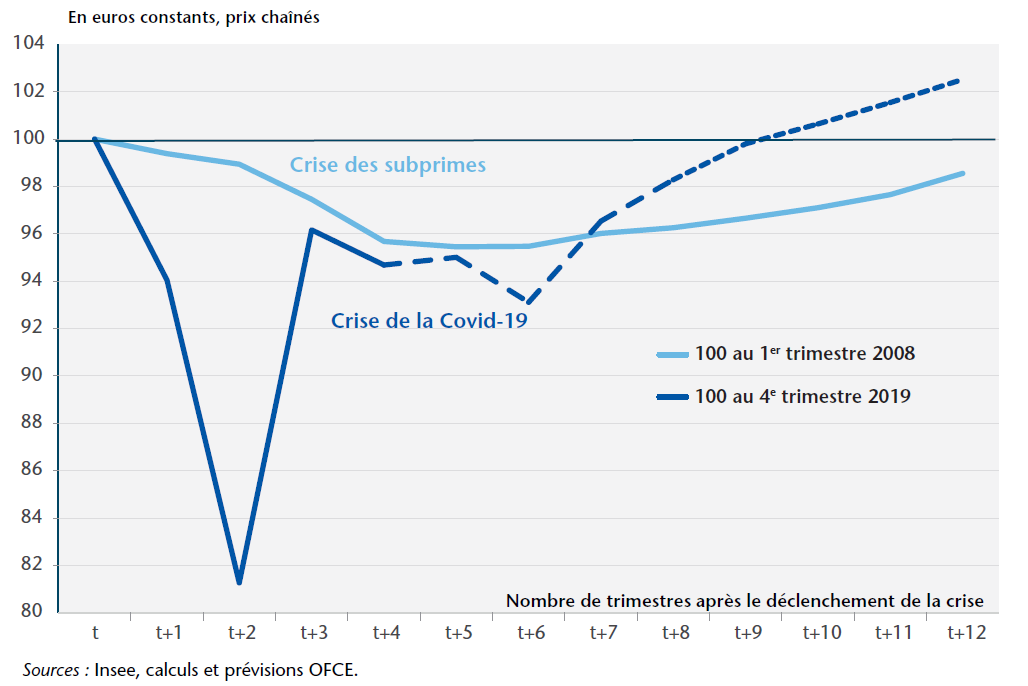
Autre différence notable avec la crise de 2020, la chute de la valeur ajoutée en 2020 se distingue nettement de celle survenue lors de la crise financière de 2008 s’agissant de la production des branches et des déterminants de la demande.
Lors de la crise financière de 2008, la baisse de l’activité était surtout due à l’industrie (du côté de l’offre) et à l’investissement (du côté de la demande).
La consommation privée avait, au contraire de la crise sanitaire de 2020, été peu ou pas affectée (graphique suivant), notamment en France, alors que l’investissement était le principal poste contribuant à la baisse de la demande. De même, en 2008, l’industrie avait été le principal secteur affecté, et ce dans des proportions plus importantes qu’en 2020, alors que le commerce, le transport ou encore l’hébergement et la restauration n’avaient été que peu concernés, contrairement à 2020.
Les mesures de restrictions sont globalement corrélées à l’activité économique en 2020, à des degrés variables selon les pays. En Europe, où ont été instaurés des confinements successifs dans la plupart des pays, l’activité économique a été particulièrement affectée : baisse de 6,6 % du PIB de la zone euro en 2020. La chute du PIB a été comparable en France (- 7,9 %) et en Italie (- 8,9 %), plus lourde en Espagne (- 10,8 %) et au Royaume-Uni (- 9,8 %), mais moindre en Allemagne (- 5,1 %). À l’inverse, la Chine a renoué avec la croissance économique dès le deuxième trimestre, permettant une hausse du PIB sur l’ensemble de l’année (+ 2,3 %), nettement inférieure toutefois à sa croissance habituelle. De façon intermédiaire, aux États-Unis, au Brésil et au Japon, le repli du PIB a été moins important qu’en Europe (respectivement – 3,5 %, – 4,1 % et – 4,8 %).
Évolution du PIB et de la valeur ajoutée brute totale en 2008
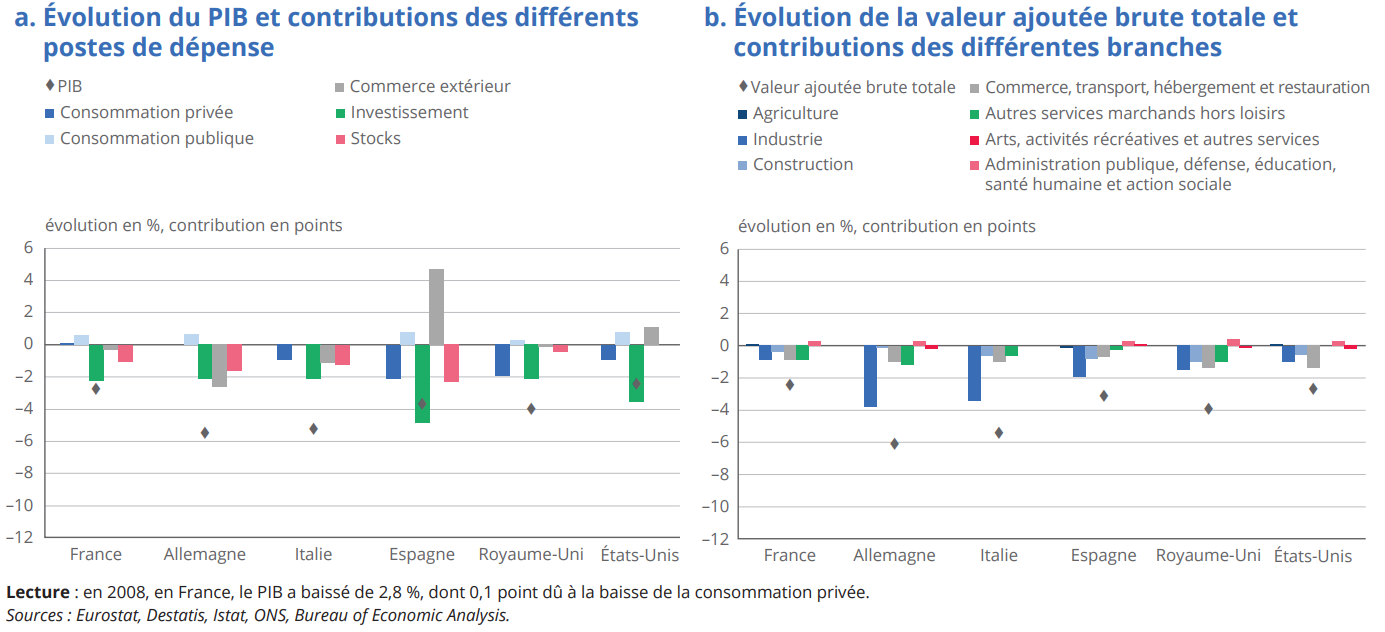
Évolution du PIB et de la valeur ajoutée brute totale en 2020
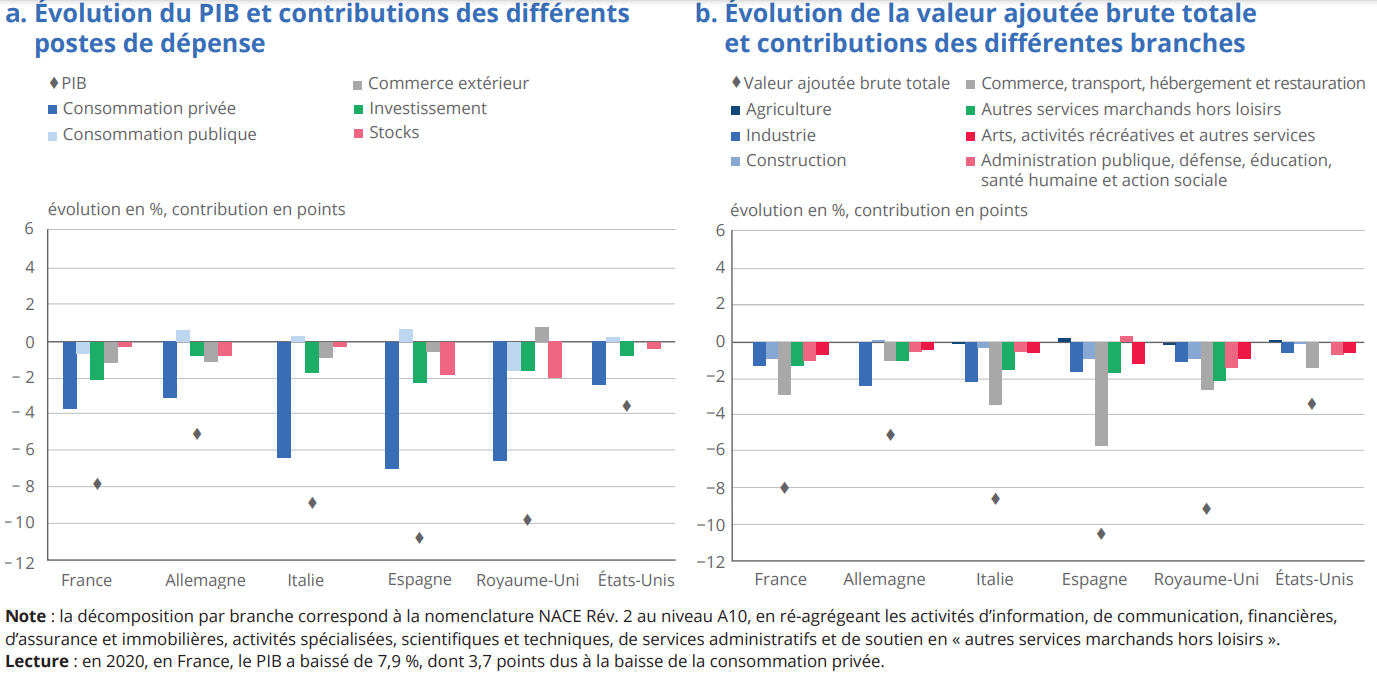
Sources : Eurostat, Destatis, Istat, ONS, BEA
2/ Évolutions des revenus et de la capacité de financement des secteurs institutionnels
En France en 2020, le creusement du déficit public a été ainsi plus fort qu’en 2009 et accompagné d’une détérioration du déficit extérieur. Ainsi, le besoin de financement de la Nation (ménages, entreprises et administrations) s’est élargi en 2020, à la différence de 2009, avec un creusement du besoin de financement des sociétés financières et non financières, et surtout des administrations publiques.
Capacités (ou besoin) de financement par secteur en France (en points de PIB) 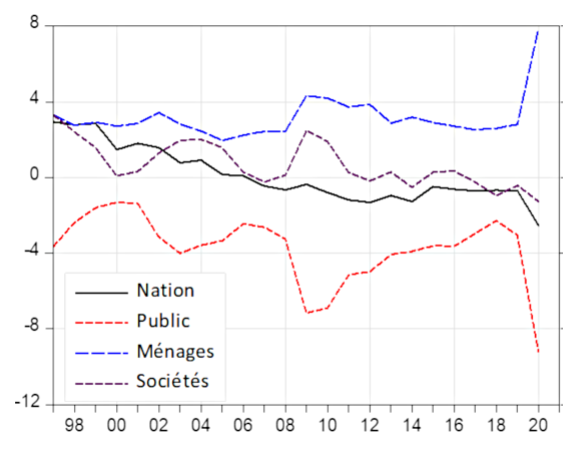
Source : Insee comptabilité nationale annuelle https://www.insee.fr/fr/statistiques/5354786
Le revenu national a diminué en 2020 de plus de 150 Mds € en 2020, tandis que la consommation et l’investissement (tous secteurs institutionnels confondus) ont respectivement baissé d’environ 70 et 45 Mds € ; quant au déficit extérieur, il a progressé d’environ 40 Mds €. Comme les dépenses en 2020 ont moins diminué que les revenus, il y a eu endettement extérieur.
Les variations des revenus observées en 2009 et 2020 ont été assez différentes. Dans les deux cas, c’est le revenu des administrations publiques qui a le plus nettement reculé (respectivement de 53 et 111 Mds €). Le revenu des sociétés avait peu diminué en 2009 (7 Mds €) mais il a baissé de manière plus conséquente (59 Mds €) en 2020. Enfin, le revenu des ménages, qui avait presque stagné en 2009, a légèrement progressé en 2020 (variations respectivement de 2 et 15 Mds €).
Il est intéressant de noter qu’il y a eu des divergences dans l’évolution du revenu agrégé des ménages en 2020 au sein des principaux pays de la zone euro (tableau suivant). En effet, le revenu nominal des ménages a légèrement augmenté en France et en Allemagne, alors qu’il a reculé en Italie et en Espagne dans un contexte où la contraction du revenu national a été plus importante. Cette préservation du revenu des ménages en France a pour contrepartie une dégradation non seulement du déficit public (comme dans les autres économies européennes) mais aussi du revenu des sociétés. S’accompagnant d’un investissement assez fort compte tenu des déterminants habituels, le creusement du besoin de financement des sociétés, qui s’ajoute à celui des administrations publiques, aboutit à une dégradation du solde extérieur.
Évolution des revenus disponibles bruts nominaux en 2020 (%)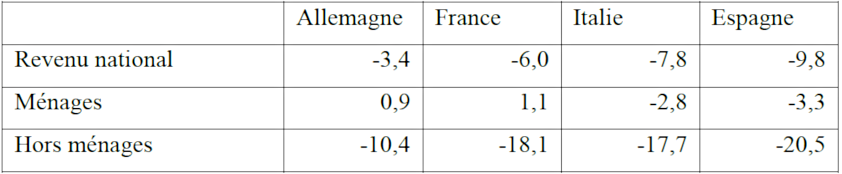
V – FLORAISON DE TRAVAUX APRÈS LA CRISE DE 2007-2009 et le SCN 2008
Les indicateurs conjoncturels mensuels et trimestriels (production, prix, emploi, commerce extérieur) sont réclamés dans des délais de plus en plus courts par la BCE, pour orienter une politique des taux directeurs hantée avant tout par la crainte de l’inflation. En France, l’Insee sous la direction de P. Champsaur décide rendre cohérenst les comptes annuels et trimestriels durant les années90. Du coup, la publication de ces indicateurs devient un événement médiatique, attirant commentaires et controverses sur l’efficacité des politiques, et même sur d’éventuelles manipulations des chiffres et de leurs interprétations, notamment dans le cas du chômage. Cette polarisation sur les indicateurs conjoncturels va rendre d’autant plus surprenant et dramatique le retournement brutal de l’automne 2008, qui n’avait pas été mieux prévu que celui de 1929.
En 2000-2002, l’Union européenne avait pris la décision stratégique d’adopter les normes comptables internationales IFRS ( » international financial reporting standards « , » normes internationales d’information financière « ), mises au point par une organisation privée ayant un champ d’action mondial mais pas de légitimité institutionnelle. Par cette décision, l’Union européenne a lancé une expérience à l’échelle de la planète, dont les conséquences se déploient à très grande vitesse et dont le résultat sera porteur d’enseignements pour d’autres segments du secteur financier, et même au-delà. Cette expérience est unique par la manière dont elle combine trois éléments clés : une dimension mondiale, une gouvernance entièrement privée, et un impact économique significatif. D’où la nécessité de s’intéresser de près aux conditions de sa réussite ou de son échec.
Aussi une explication avancée (après coup) de cet aveuglement est l’absence de prise en compte des transformations des outils financiers (produits dérivés, titrisation) dans les analyses antérieures, centrées sur les variables économiques. Du point de vue des indicateurs quantitatifs, une conséquence, peu perçue mais grave, de la financiarisation a été notamment la modification des normes comptables européennes. Celle-ci vise désormais à valoriser les actifs du bilan à leur « valeur de marché » (c’est-à-dire de revente éventuelle), ou fair value, et non plus à leur coût d’origine. Cette façon de faire intéresse les investisseurs, les actionnaires et les spéculateurs, mais elle tend à rendre volatils les bilans des entreprises, et par là amplifie les variations des statistiques financières, ce qui aggrave la crise.
Les cours boursiers reflètent des phénomènes moutonniers instantanés. Ils sont, au moins à court terme, relativement déconnectés des évolutions économiques réelles. Ils fascinent les investisseurs financiers, mais ne font pas partie des modèles purement économiques. Mieux, l’indicateur le plus à même de refléter et même d’anticiper la gravité des crises financières, le « taux des prêts interbancaires » (le Libor), qui a atteint des sommets dès la fin de 2007, est peu connu et commenté par les médias, à la différence du CAC 40 ou du Dow Jones, affichés en continu par les chaînes d’information télévisées. Ce taux Libor augmente quand les banques ne se font plus confiance entre elles et refusent de se prêter de l’argent.
Les normes comptables internationales, également appelées normes IFRS, pour International Financial Reporting Standards, et les normes américaines (US-GAAP), ont été accusées par certains d’être à l’origine de la crise financière, et par d’autres, d’avoir permis de la révéler à temps : le concept de juste-valeur (ou Fair Value), utilisé pour la valorisation des instruments financier a fait l’objet de nombreux débats, à tel point que c’est avec une rapidité sans précédent que les deux organismes normalisateurs (IASB et FASB) ont proposé un assouplissement de la norme avant de se diriger vers un projet de modification.
1/ De la crise financière à la crise écologique
Mais la brutale irruption des phénomènes financiers est sans doute un des faits les plus marquants de la crise économique actuelle, mais ce n’est pas le seul. Sa survenue vient s’ajouter à celle, plus ancienne mais de plus en plus inquiétante, de la crise écologique et à l’angoisse du réchauffement climatique. Cette menace a relancé les critiques, déjà anciennes, des indicateurs économiques issus de la comptabilité nationale.
La crise de 2007-2008 met ainsi en avant le besoin d’entreprendre de nombreux travaux et études de comptabilité nationale sur la financiarisation ou sur les inégalités, sur le bien-être des ménages et surtout sur la dette publique qui croît de plus en plus en % du PIB. Plusieurs travaux comptables sont entrepris progressivement avant ou après la crise de 2008. Ils ont amené les organismes internationaux et les INS à renforcer leurs mesure sur ces 3 thèmes :
– Calcul de la consommation des ménages par catégories de revenus; définition un concept de pauvreté qui n’est pas seulement monétaire : accès aux soins, éloignement des services publics, pouvoir d achat différent selon les lieux d habitation (voir page Richesse et consommation).
– Mesure de la dette publique et développement des comptes des administrations publiques avec l’existence en 2012 comme aujourd’hui d’une Direction « Statistiques des finances des administrations publiques (GFS) et qualité » au sein d’Eurostat à coté de celle des « Comptes nationaux, statistiques des prix et indicateurs clés ». appelée aujourd’hui Direction « Statistiques macroéconomiques » qui comprend plusieurs unités sur les comptes nationaux (voir page Dette publique).
– Évaluation du bien-être en parallèle du PIB (voir page PIB et bien-être), développement des travaux et des mesures du bien-être des ménages et plus généralement et plus généralement de remise en question du PIB comme indicateur de bien-être. Faute de mieux (meilleures prises en comptes des évolutions de l’environnement dans le cadre central de la comptabilité nationale, comptes par catégories de revenus,…), on s’est orienté vers des études ponctuelles ou des la mesure d’agrégats inédits comme le PIB «ressenti».
1/ la mesure des inégalités
De nombreux travaux comptables se sont développés sur les inégalités de revenus à partir de la crise de 2009 même si la montée des inégalités est antérieure à la crise 2009. La part du revenu reçue par les 5 % les plus riches des ménages américains est passée de 24 % en 1920 à 34 % en 1928, d’une part, de 22 % en 1983 à 34 % en 2007, d’autre part. Pendant ces deux périodes, le ratio dette/revenu a vivement progressé. Il a presque doublé de 1920 à 1932 et de 1983 à 2007.
Pourquoi ces travaux comptables en période de crise sont importants en économie ? Parce que la propension moyenne à consommer varie selon le revenu mais surtout parce que les riches ne consomment pas les mêmes biens que les pauvres comme on vient de le voir. Les dépenses des premiers peuvent fluctuer plus que celles des seconds. Un monde plus égalitaire peut donc limiter les effets d’une crise économique.
Dans la période allant de 1983 à 2007, la différence entre la consommation des riches et celle des pauvres et de la classe moyenne a moins augmenté que la différence entre les revenus de ces deux groupes. Pour le second, le seul moyen de maintenir une consommation élevée avec un revenu stagnant a été d’emprunter. La hausse du ratio dette/revenu a donc été concentrée dans les ménages pauvres et de la classe moyenne. En 1983, le ratio atteignait 80 % pour les 5 % supérieurs et 60 % pour les autres 95 % de la population. Vingt-cinq ans après, c’était l’inverse : 65 % pour les 5 % supérieurs, 140 % pour les 95 % restants. Les pauvres et la classe moyenne ont cherché à faire progresser leur niveau de vie en empruntant. Parallèlement, les riches ont accumulé des actifs représentatifs de prêts aux pauvres et à la classe moyenne.
L’endettement accru du groupe à revenu inférieur a des conséquences sur la taille du secteur financier et sa vulnérabilité aux crises. De 1981 à 2007, le ratio crédit privé/PIB a plus que doublé, passant de 90 % à 210 %. La montée de l’endettement a rendu l’économie plus vulnérable à une crise financière.
La récession de 2008-2009 résulterait principalement d’enchaînements financiers, la crise des subprimes d’abord, puis le jeu d’effets de levier suffisamment puissants pour transformer des défauts localisés dans un marché particulier aux États-Unis, portant sur des montants limités – quelques centaines de milliards de dollars –, en une crise capable de détruire des institutions centenaires de Wall Street et de plonger l’économie mondiale dans la pire récession de l’après-guerre. Des déséquilibres des marchés de biens et de services en ont résulté, mais il serait erroné de les considérer comme ayant été à l’origine de la crise. Dès lors, c’est bien par leurs effets induits sur les comportements d’endettement que les inégalités de revenus ont favorisé l’apparition de la crise et non par leurs conséquences directes sur la formation de la demande. Ces effets induits concernent aussi bien le marché américain des subprimes que le gonflement des capacités et des besoins de financement de certains acteurs dans l’ensemble du monde.
2/ Le lien entre crise financière et crise de la dette publique.
Face à la crise financière de 2008 et au risque d’effondrement économique, de vastes plans de soutien budgétaires publics ont été mis en place dans la plupart des États du monde.
Ils contenaient en général un volet de soutien public au système bancaire et financier et un volet de soutien de la demande privée défaillante (du fait notamment des restrictions du crédit bancaire et des efforts prioritaires de désendettement des ménages et des entreprises).
Les déficits des États ont en conséquence considérablement augmenté.
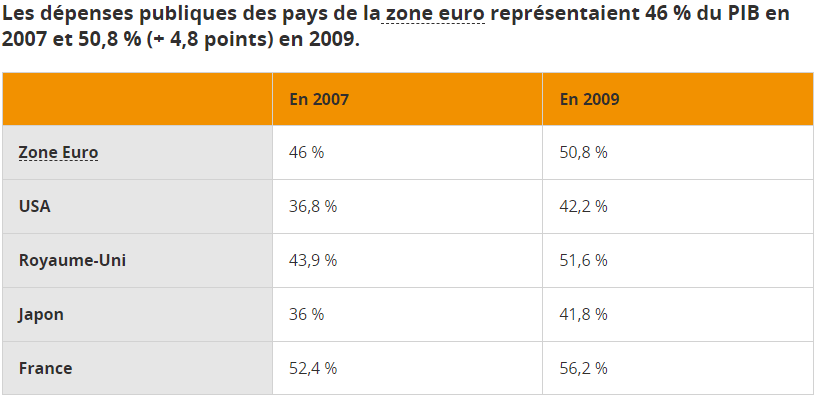
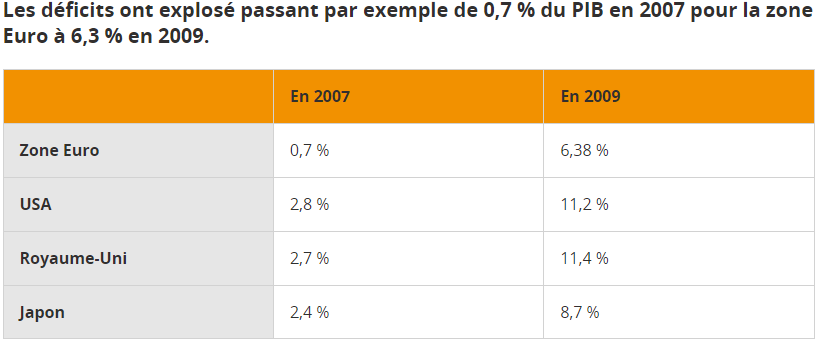
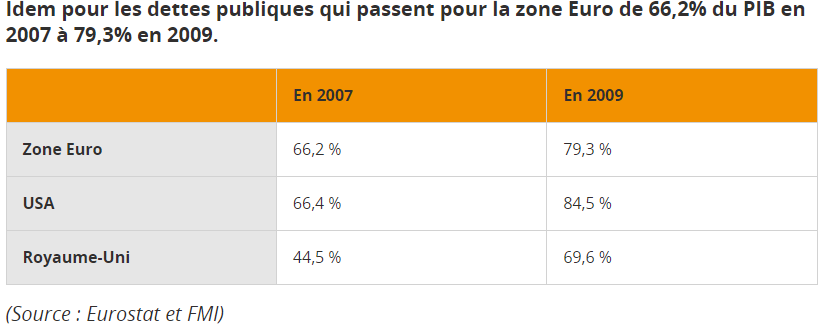
3/ Le PIB «ressenti»
On présente déjà cette notion dans la page PIB et bien-être. L’idée est qu’une même croissance du revenu n’améliore pas la vie de tous de la même manière. Les économistes ont longtemps postulé une « utilité » marginale du revenu décroissante, c’est-à-dire que cette amélioration s’atténuait à mesure que l’on s’élevait dans l’échelle des revenus. Ce mécanisme est devenu aujourd’hui l’objet de travaux empiriques rendus possible par l’essor d’enquêtes mesurant le bien-être lui-même. Ainsi depuis 2010, l’Insee, dans l’enquête sur les Statistiques sur les ressources et les statistiques sur les conditions de vie des ménages (SRCV) , demande aux répondants de donner une note de 0 à 10 à la satisfaction dans la vie qu’ils mènent. Les notes de satisfaction croissent avec le revenu, mais en effet de moins en moins à mesure que l’on s’élève dans l’échelle des revenus [8] .
Satisfaction dans la vie par centile de niveau de vie (France, moyenne 2010-2019)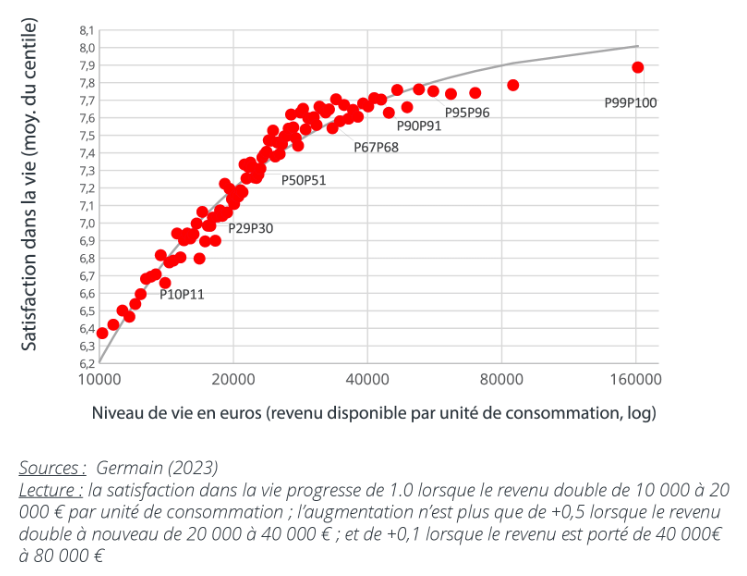
La satisfaction dans la vie dépend bien évidemment d’autres facteurs comme l’âge, la santé, les relations sociales, l’environnement du logement, mis en lumière par les publications annuelles de l’Insee. Par ailleurs, les techniques statistiques permettent de séparer l’effet de ces facteurs, que l’on peut qualifier de bien-être non-monétaire, de l’effet du seul revenu. Dès lors que l’on dispose de la relation entre revenu et bien-être monétaire, on est en situation de mesurer la contribution de la croissance à la satisfaction moyenne nationale.
L’indicateur proposé, qualifié de « PIB ressenti », mesure en moyenne nationale et en équivalent monétaire, la contribution des revenus à la satisfaction dans la vie. La terminologie est utilisée par analogie avec la température ressentie des météorologues. De même que la température ressentie par le corps peut être plus haute (humidité) ou plus basse (vent) que la température de l’air, le PIB ressenti peut différer du PIB selon la façon dont il est distribué entre les ménages, et selon l’impact plus ou moins important sur la satisfaction dans la vie des individus des revenus qui évoluent à la hausse ou à la baisse. Mais on imagine la grande difficulté sous-jacente, à savoir la mesure de l’évolution des inégaliés de revenus, très complexes à quantifier comme le soulignent les conclusions opposées de plusieurs études sur celles des États-Unis.
L’analyse en PIB ressenti apporterait-elle un éclairage nouveau sur les évolutions économiques de l’Europe et des États-Unis au cours des quarante dernières années ? En bien-être monétaire, les ralentissements économiques ont duré beaucoup plus longtemps que mesurés par le PIB : en France, en 2019, soit 11 ans après le ralentissement de 2008, le revenu national ressenti retrouvait tout juste son niveau d’avant la crise, et n’y était pas encore revenu aux États-Unis (graphique suivant). Jusqu’à quel point ces évolutions sont exactes?
PIB et PIB ressenti après la grande crise économique mondiale de 2007-2008 (États-Unis et France)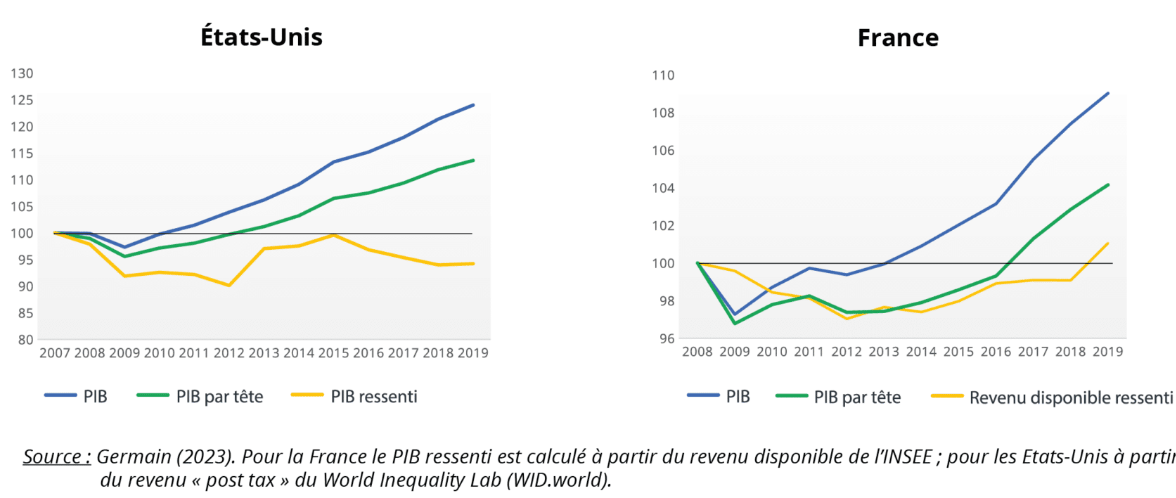
VI – LE RAPPORT STIGLITZ-SEN-FITOUSSI
L’année 2009 est ainsi celle de la publication du rapport de la Commission « Stiglitz-Sen-Fitoussi » (Commission dans la suite du texte) [8]. Cette commission a été chargée en 2008 par le gouvernement français de faire des propositions visant à compléter les comptes nationaux par des évaluations des éléments sociaux et écologiques qui apparaissent désormais cruciaux. Elle a rendu son rapport en septembre 2010. Celui-ci propose le calcul d’un certain nombre de nouveaux indicateurs de bien-être. Par ailleurs, des chercheurs et des militants, regroupés en France en un Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR), tentent de susciter un large débat à ce sujet dans la société. Y-a-t-il une relation antre la crise de subprimes et la rédaction de ce rapport ? Oui dans la mesure où celui-ci met en avant le bien être des ménages à travers les inégalités et en remettant le ainsi les ménages au centre des préoccupations de la Comptabilité nationale.
Il convient de faire le meilleur usage des indicateurs que produit la comptabilité nationale. Le PIB n’est que l’un d’entre eux. Il a été conçu pour le suivi conjoncturel de l’activité économique, et il n’est pas le mieux placé pour approcher la notion de bien-être de la population. D’autres indicateurs monétaires issus de la comptabilité nationale peuvent lui être préférés.
De nombreux aspects du bien-être restent difficiles ou impossibles à mesurer en unités monétaires et une place importante doit être faite à des indicateurs plus qualitatifs. Parmi ces indicateurs non monétaires, certains restent de type objectif – par exemple l’espérance de vie–, mais le rapport préconise aussi qu’une place soit faite à des indicateurs subjectifs (voir page PIB et bien-être).
La mesure du bien-être courant et de sa soutenabilité sont deux questions qui doivent être clairement distinguées. Avec la soutenabilité, il s’agit de savoir si nous léguons aux générations suivantes suffisamment de ressources pour leur assurer un niveau de bien-être au moins équivalent au nôtre. Cette question a elle-même plusieurs dimensions : la Commission a notamment proposé de distinguer la soutenabilité économique, qui reste appréhendable à l’aide d’indicateurs monétaires, et la soutenabilité environnementale, qui est mieux traitée par une batterie d’indicateurs physiques.
Quel que soit le domaine couvert, les indicateurs agrégés ne permettent pas de capter la disparité des situations individuelles, qui peut fortement affecter le bien-être ressenti. La commission invite à les compléter, autant que possible, par des indicateurs de dispersion. Par exemple l’inflation n’est pas ressentie de la même manière par les personnes les plus modestes et celles à revenu aisé.
Ainsi, la conjonction de ces deux crises, écologique et financière, a été à l’origine d’une toute nouvelle configuration de la production et des usages des indicateurs statistiques. Des premiers exemples ont été fournis par l’importance prise par les travaux du Groupe international d’évaluation du climat (GIEC, en anglais : IPCC) et par les indicateurs d’émission de CO2, de hausse des températures moyennes, de montée des océans, ou encore de l’empreinte écologique. De nouveau les crises sont, tout à la fois, représentées par des indicateurs statistiques et à l’origine de vastes recompositions du paysage de ces indicateurs, comme l’ont montré les épisodes des années 1880, 1930, 1970 et 2000.
Il ressort que le paysage comptable et statistique a évolué mais très progressivement par ce que les citoyens du monde et leurs gouvernements ont décidé en dernier ressort ont choisi de privilégier, parmi les aspects les plus graves de ces crises et parmi les moyens d’agir sur elles comme par exemple le marché du carbone, ainsi que les effets possibles d’une éventuelle taxe carbone, pouvant constituer des indicateurs combinant les dimensions des deux crises.
Il reste que le PIB est loin d’être abandonné et que le cadre central de la comptabilité nationale semble incapable d’intégrer l’environnement, notamment les dommages liés à ses dégradations, même si quelques avancées devraient être faites dans le Système des Comptes Nationaux de l’ONU (SCN 2024) sur les coûts d’épuisements des ressources naturelles (voir page Compte Environnement).
1/ Les limites du PIB
En pleine crise, ces économistes pointent les limites criantes du PIB : connues de longue date (Rapport Meadows du Club de Rome en 1972), elles impliqueraient des innovations pour rendre mieux compte des « performances économiques » et du « progrès social ». L’ensemble des systèmes de comptabilité nationale mis en place après la Deuxième Guerre mondiale doit ainsi être repensé. La totalité des institutions statistiques publiques est appelée à mettre en œuvre à relativement brève échéance des changements notables dans l’architecture intellectuelle sur laquelle ils ont été construits, dans leurs dispositifs d’enquête et leurs instruments de mesure et autres indicateurs.
a) Soucis d’interprétation du PIB
Bâtie après la guerre, confronté à de nombreux problèmes (ou « anomalies »), la comptabilité nationale devrait ainsi tendre à se développer et s’enrichir toujours plus pour intégrer la réponse à ces problèmes, fût-ce au prix d’une perte en simplicité sinon en cohérence. Sans renoncer totalement à l’usage du PIB, le rapport prône par exemple un usage accru des revenus et de la consommation réels des ménages, éléments déjà présents dans la comptabilité nationale, mais encore mal mesurés (avec des observations incohérentes). Insistant à plusieurs reprises sur le principe d’équivalence (un service identique pour un ménage ne doit par exemple pas être comptabilisé différemment selon le statut juridique, public ou privé, de son producteur), le rapport en appelle à une meilleure mesure des services non marchands (notamment ceux de santé ou d’éducation) dont les ménages retirent un bien-être pour l’instant largement ignoré. Dans le même esprit, il s’agit de développer les comptes de patrimoine à tous les niveaux, et de soumettre les bilans ainsi construits à des « tests de résistance » fondés sur diverses hypothèses de valorisation, « là où il n’existe pas de prix du marché ou lorsque ces prix sont soumis à des fluctuations erratiques ou à des bulles spéculatives ». Les difficultés de la mesure monétaire du patrimoine, dans un sens étendu, ouvrent donc un immense chantier pour les comptables nationaux.
Conçu à l’origine pour instrumenter les politiques keynésiennes, le PIB est perçu aujourd’hui, à tort ou à raison, comme un indicateur (monétaire) de bien-être, sinon de bonheur. Cela lui vaut maintes critiques : il ne reflète ni les inégalités sociales, ni les activités non monétaires (travail des femmes, travail bénévole), ni surtout les dégradations de la nature entraînées par les activités humaines, symbolisées aujourd’hui par les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ces critiques sont à l’origine de nombreuses propositions de « nouveaux indicateurs de richesse ». Le plus célèbre d’entre eux est l’indice de développement humain (IDH), popularisé par A. Sen (voir page PIB et bien-être). Sa formule, très élémentaire, est une moyenne entre la longévité humaine, le niveau d’éducation et le niveau de vie. Malgré son caractère fruste, cet indicateur a connu un grand succès.
Les questions de mesure et d’évaluation de la soutenabilité ont été au cœur des préoccupations de la Commission et deux de ses recommandations portaient précisément sur les indicateurs de soutenabilité. Les auteurs estiment trop ambitieuse la recherche d’un chiffre unique qui pourrait jouer pour la soutenabilité le rôle que le PIB a joué pendant longtemps pour la mesure de la performance économique. Selon eux, mesurer la soutenabilité à l’aide d’un seul indice n’est possible que sous deux hypothèses fortes : que les évolutions éco-environnementales futures puissent être parfaitement prédites, et que l’on sache parfaitement de quelle manière ces évolutions affecteront le bien-être. Ces deux hypothèses n’étant pas réunies, ils plaident pour une approche pragmatique avec une évaluation de la soutenabilité via un tableau de bord combinant un indicateur monétaire, qui renseignerait sur la soutenabilité économique, le PIB, et un ensemble restreint d’indicateurs physiques consacrés aux questions environnementales.
Le niveau de PIB par tête américain ressort ainsi comme le plus élevé sur l’ensemble de la période. L’écart avec les autres grands pays est relativement stable entre 1970 et 1990, après quoi il tend à se creuser. Le cas du PIB par tête Irlandais est très différent : largement inférieur à celui des six autres pays en début de période, il s’en rapproche à partir du milieu des années 90, le rattrape à la fin des années 1990 – exception faite des États-Unis –, puis le distance dans les années 2000. En pratique, le PIB est le plus souvent utilisé en évolution pour mesurer la croissance de l’activité économique, mais sa pertinence comme mesure du niveau de vie est depuis longtemps discutée. Même si ces limites sont bien connues, on peut revenir sur les plus importantes d’entre elles (voir page PIB et bien-être).
b) Qu’est ce que le PIB ne mesure pas ou pas bien ?
Tout d’abord, le mode de calcul du PIB est surtout approprié pour les biens et services marchands valorisables à leur prix de marché. Il faut alors faire la part entre l’évolution des prix qui résulte de la seule inflation et celle qui traduit une montée en qualité et donc une possible augmentation du bien-être. Le problème se pose notamment pour les biens dont la nature évolue rapidement, tels que les biens de haute technologie. Il se pose aussi de manière particulièrement marquée pour les services : la règle généralement adoptée par les statisticiens consiste à retenir le volume de ventes comme mesure des volumes des services commerciaux. Or, par construction, cette méthode ne peut rendre compte de tous les aspects liés à la qualité du service (comme l’accessibilité du magasin ou le niveau des prestations fournies par le personnel), qui peut évoluer dans le temps ou différer d’un magasin à un autre.
Dans le cas des services publics tels que la santé et l’éducation, la difficulté est encore plus grande car ils sont fournis à titre gratuit. Ils n’ont donc aucun prix qui puisse servir à les valoriser. Pour remédier à ce manque, les comptables nationaux retiennent en niveau l’approche dite par les inputs ou les intrants. La valeur de la production de ces services est supposée égale au coût des facteurs utilisés pour les produire. En volume, et notamment lorsqu’on veut appréhender le service rendu en évolution, la méthode des inputs est peu satisfaisante car elle ignore notamment les gains de productivité et les améliorations du service proposé.
L’approche fondée sur des mesures directes de l’output est donc préférable dans l’absolu, mais elle pose de nombreux problèmes techniques et se heurte au manque de données. Or, bien mesurer la valeur de ces services non marchands est particulièrement important dans une optique de comparaison internationale. Par exemple, si un pays a opté pour une fourniture publique de la majeure partie de ses soins de santé et si ces services sont sous-valorisés par la méthode d’imputation qu’on a retenue, il apparaîtra moins riche qu’un pays dans lesquels les mêmes services sont assurés par le marché et valorisés au prix de ce marché. Il s’agira là d’un pur artefact, si l’on n’est pas capable de corriger les données d’un niveau de prix relatif du service rendu. La commission insiste à cet égard sur la nécessité de viser un principe d’invariance : la mesure du niveau de vie doit rester la même lorsque la fourniture d’un service bascule du secteur public au secteur privé ou inversement, du moins tant que ce basculement se fait à qualité constante. C’est à cette condition que des comparaisons entre pays ayant des « dispositions institutionnelles » différentes peuvent être possibles.
Une autre limite du PIB est qu’il valorise positivement un certain nombre de dépenses qui ne contribuent pas directement au bien-être. Les dépenses de sécurité sont un exemple de ces dépenses dites défensives. Ces dépenses ne devraient pas être comptées comme dépenses de consommation génératrices de bien-être : il est plus légitime de les traiter comme investissements ou produits intermédiaires. Une des solutions proposées par le rapport pour gérer ce problème est de soustraire au moins les dépenses défensives incombant à l’État, telles que les dépenses consacrées aux prisons. Néanmoins, ceci ne résout pas le problème des dépenses défensives à la charge des ménages, telles que les frais de déplacement domicile-travail.
Le PIB ignore enfin les activités domestiques, qu’il s’agisse de production ou de loisir. Or les deux sont génératrices de bien-être, soit à travers les biens et services qui sont ainsi auto-consommés, soit directement dans le cas du loisir. La commission estime la production domestique à 35 % du PIB dans le cas de la France, mais les comptables nationaux ne disposent pas toujours de données suffisamment précises pour tenir compte de cette production dans leurs agrégats. Les estimations sur la production domestique sont encore fragiles car elles s’appuient sur des données d’utilisation du temps des ménages. Les données actuellement disponibles souffrent encore d’imprécision et d’absence de consensus sur la méthodologie à retenir. Ces données sur l’emploi du temps des ménages sont indispensables pour saisir l’importance de la production domestique. Elles permettraient d’étudier l’évolution des tâches domestiques dans le temps mais également les différences entre les pays. À cet égard, le rapport considère que la production de données solides et harmonisées sur l’emploi du temps est une des priorités et insiste sur le fait que leur « rentabilité pour les analyses sur la qualité de la vie est potentiellement considérable ». Ce sont les mêmes données qui doivent pouvoir être mobilisées pour estimer le temps et la qualité des loisirs.
Toutes ces questions sont complexes. La commission invite ces derniers à poursuivre les efforts pour y répondre, sans ignorer qu’il y a un grand nombre d’entre elles sur lesquelles il sera toujours impossible de converger de manière totalement satisfaisante. Par exemple, toutes les questions auxquelles on répond par des méthodes d’imputation sont fragiles, car elles comportent une part plus ou moins importante de convention. Le rapport prend acte qu’il est difficile de résoudre le dilemme qui en découle entre exhaustivité et intelligibilité. A cet effet, il préconise de présenter un certain nombre de comptes satellites mais de maintenir une distinction claire entre ces comptes et les comptes essentiels.
Ceci ayant été posé, on peut trouver au sein du cadre central de la comptabilité nationale plusieurs indicateurs moins connus que le PIB mais qui permettent déjà de mieux s’approcher de la notion de bien-être des ménages. La commission préconise de leur donner une plus forte visibilité.
2/ Passer du brut au net, de la production au revenu
Passer du brut au net, de la production au revenu : peu de changements sauf pour les pays avec des investissements étrangers directs élevés Un premier indicateur alternatif au PIB est le produit intérieur net (PIN). Il est en principe toujours préférable de raisonner en net plutôt qu’en brut, les mesures nettes prenant en compte la dépréciation du capital. L’estimation de cette dépréciation est néanmoins un exercice périlleux, et c’est la raison pour laquelle le PIB reste privilégié par rapport au PIN. Il faut préciser que la dépréciation du capital considérée ici est celle du seul capital fixe produit. Pour être plus complet, il faudrait en outre comptabiliser la dépréciation de toutes les formes de capital, notamment celles de l’environnement et des ressources naturelles. Toutefois, ceci renvoie plutôt à la question générale de la soutenabilité, que le rapport préconise de traiter à part de la mesure du bien-être courant. Sur les sept pays que nous étudions, le passage du PIB au PIN a surtout pour effet de modifier les ordres de grandeur, dans une proportion à peu près équivalente pour les différents pays.
Du point de vue du bien-être économique, il semble par ailleurs plus judicieux de s’intéresser au revenu plutôt qu’au produit. Le PIB reflète plus le versant « offre » de l’économie. C’est une mesure de l’activité productive sur le territoire du pays considéré et c’est à ce titre qu’il est privilégié dans le suivi de la conjoncture économique. Mais une partie de cette activité sert à rémunérer des capitaux étrangers et, à l’inverse, une partie des ressources des résidents découle de revenus de placements à l’étranger. C’est la raison qui pousse à préconiser l’approche par le revenu plutôt que l’approche par le produit intérieur (recommandation n° 1). Contrairement au PIB ou au PIN, le revenu disponible national net (RDNN) prend en compte les flux de revenus entre pays, y compris les flux de transferts tels que les impôts ou contributions versés à des non-résidents ou reçus par les résidents en provenance du reste du monde.
Que donne ce passage du PIB au RDNN ? L’évolution du ratio entre les deux indicateurs est très variable entre les sept pays(graphique suivant). Aux États-Unis et en France, ce ratio varie peu sur l’ensemble de la période : après une légère diminution au début des années 1970, il se stabilise autour de 87 %. La part du revenu disponible national net dans le PIB décroît en Italie et au Japon mais dans une moindre mesure. Elle baisse en Allemagne au moment de la réunification, puis se redresse à partir des années 2000.
Revenu disponible national net en pourcentage du PIB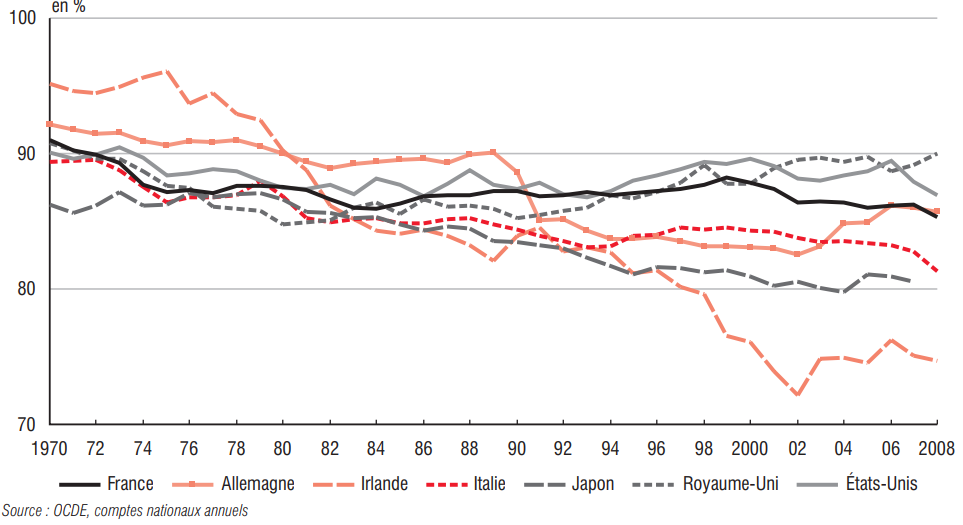
3/ Passer du revenu de l’ensemble de la nation à celui des ménages réduit l’écart entre la France et les États-Unis
À l’intérieur de ce RDNN, il est ensuite possible de se focaliser sur la part qui concerne effectivement les ménages. C’est en effet une autre recommandation de la commission que de ne pas se concentrer sur l’ensemble de la nation et de mettre l’accent sur les ménages (recommandation n° 2). Le PIB, le PIN ou le RDNN donnent une vision d’ensemble de la performance des économies. En revanche, lorsque l’on s’intéresse à l’évolution du niveau de vie des citoyens, il est plus juste de s’intéresser au revenu et à la consommation des seuls ménages. On peut tenter de le faire avec une approche désagrégée reflétant la dispersion des situations individuelles (encadré 2), comme y invite la recommandation n° 4 du rapport.
Le concept utilisé n’est pas le revenu disponible net de ces ménages. Il s’agit d’un revenu ajusté, que les comptables nationaux définissent comme le revenu disponible augmenté des transferts sociaux en nature, c’est-à-dire augmenté des biens et services bénéficiant aux ménages tout en étant financés (et dans certains cas produits) par les administrations publiques. Ces transferts sociaux comprennent notamment les remboursement de soins de ville, les services hospitaliers et les services d’éducation, ou encore les allocations logement, qui tous correspondent à autant de ressources supplémentaires pour les ménages. La mesure du revenu disponible ne les inclut pas et donne une vision imparfaite du « vrai » revenu des ménages, violant le principe d’invariabilité mentionné plus haut. Le revenu disponible ajusté permet de mieux le respecter : le caractère socialisé ou non du financement d’une activité n’influence pas la valeur du revenu ajusté des ménages.
Au sens de ce revenu disponible net ajusté, les ménages américains continuent d’avoir le niveau de vie le plus élevé sur l’ensemble de la période (graphique suivant). L’écart relativement stable durant les années 1990 avec les autres pays se creuse même à partir de la fin des années 1990. En revanche, il y a des changements sensibles dans la position des autres pays. Durant les années 2000, les ménages français et britanniques disposent à peu près du même revenu disponible net ajusté. Alors que les revenus des ménages allemands, italiens et français étaient comparables dans le courant des années 1990, le revenu des ménages allemands et italiens croît plus lentement que celui des français en fin de période.
Niveaux de revenu disponible net ajusté des ménages en dollars de 2000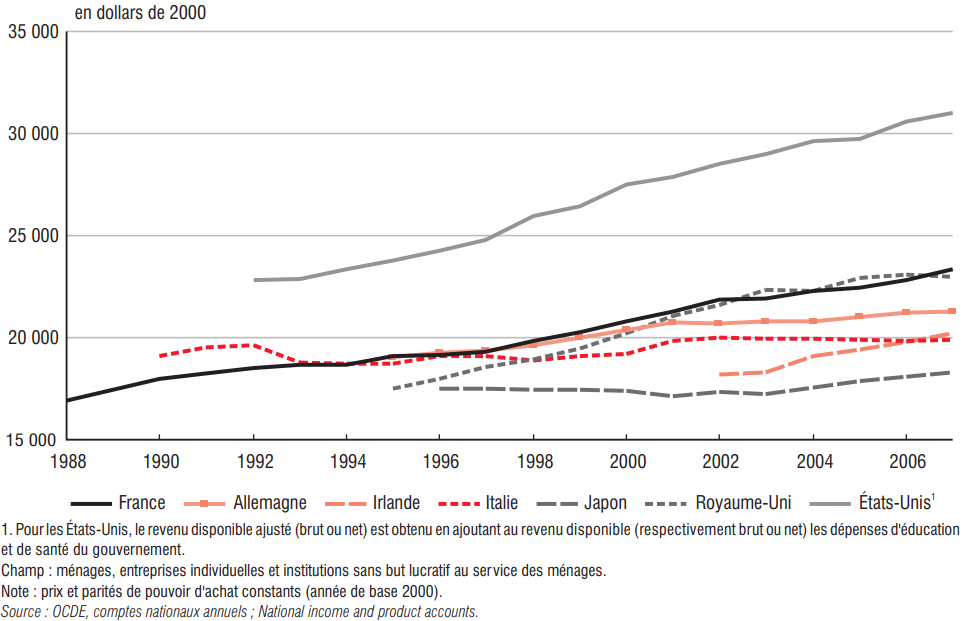
Pour compléter l’information donnée par le revenu ajusté, la commission recommande enfin de mobiliser également des informations relatives à la consommation et à la richesse des ménages (recommandation n° 3). Les trois informations sont effectivement complémentaires : la consommation courante donne une information sur le niveau de bien-être courant, mais sans présager s’il est soutenable ou non ; le patrimoine détermine les possibilités de consommation futures ; le revenu net, s’il est bien calculé, correspond au maximum de consommation qui serait atteignable pour la période courante sans baisse du patrimoine. La différence entre revenu net et consommation représente en effet le taux d’épargne nette. Tant que la consommation est en deçà du revenu net, l’épargne est positive, le patrimoine s’accroît et le niveau de consommation courant devrait en principe pouvoir être au moins maintenu dans le futur. Dans le cas inverse, l’épargne est négative, la richesse décroît et les perspectives de consommation future se détériorent. L’articulation de tous ces concepts renvoie ainsi à la question de la soutenabilité du niveau de vie, également traitée par le troisième sous-groupe de la commission, dans une perspective patrimoniale élargie sur laquelle on reviendra plus loin.
À ce stade, même en se restreignant à une vision financière usuelle du patrimoine, il est difficile de donner des éléments comparables sur les patrimoines des ménages. Bien que des éléments existent déjà dans les comptes nationaux, le rapport estime que ces informations sont à compléter. En revanche, les comptes nationaux offrent plusieurs agrégats relatifs à la consommation, notamment les concepts de dépenses de consommation finale et de consommation effective. La distinction entre ces deux notions est la même que celle entre revenu disponible et revenu disponible ajusté. La consommation finale effective comprend l’ensemble des biens et des services utilisés ou consommés effectivement, quelle que soit la façon dont ils sont financés. Ainsi la consommation effective des ménages se compose à la fois des dépenses de consommation finale des ménages et des transferts sociaux en nature
Au total, on peut récapituler la comparaison de ces quatre approches du niveau de vie monétaire pour l’année 2007 en examinant la position de chaque pays par rapport aux États-Unis, qui restent en tête dans les quatre cas de figure (graphique suivant). C’est pour l’Irlande que les modifications sont les plus sensibles, non seulement en raison du passage de la production au revenu national, mais aussi sous l’effet du passage à la perspective « ménages ». Le décrochement est également important pour le Japon. Il est plus faible pour les autres pays. Dans le cas de la France, ce qui est gagné en considérant le revenu disponible ajusté est reperdu en passant à la consommation finale effective, mais c’est la conséquence d’un taux d’épargne des ménages plus important. On peut donc débattre de savoir si c’est l’indice d’un moindre niveau de vie ou non : encore une fois, la comparaison revenu/épargne renvoie plutôt à la question des perspectives de niveau de vie futur, donc à la thématique de la soutenabilité. Néanmoins, l’épargne des ménages n’en est qu’un aspect et cette question nécessite un point de vue plus large.
Situations relatives des pays par rapport aux États-Unis en 2007, selon quatre approches du niveau de vie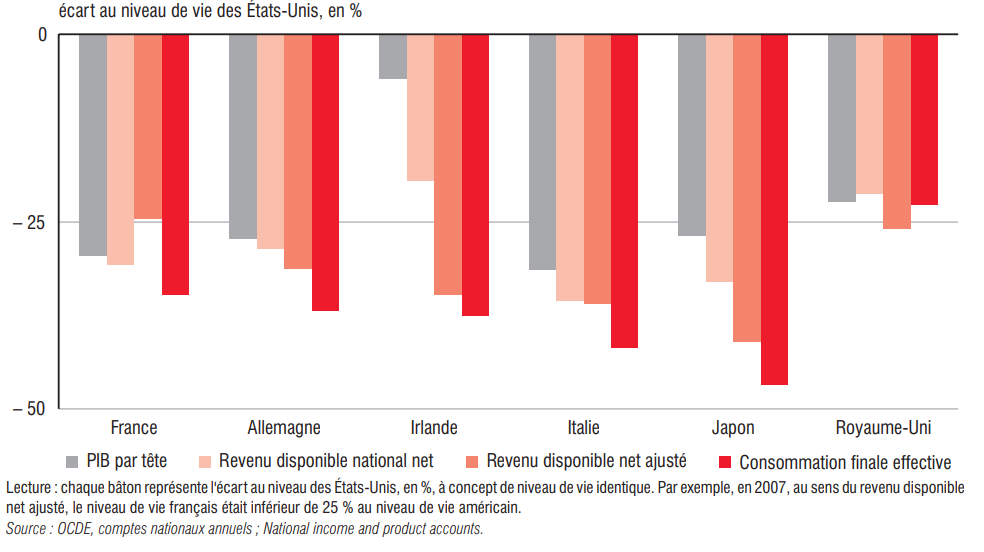
4/ Les recommandations de la Commission
Elles ne se réduisent pas la comptabilité nationale à des questions économiques. On en cite ici la plupart.
Recommandation n° 1 : dans l’évaluation du bien-être matériel, se référer aux revenus et à la consommation, plutôt qu’à la production.
Si les données sur le sujet ne sont pas toutes accessibles, c’est surtout l’habitude dominante qui consiste à mettre en avant le seul PIB qui devrait être profondément mise en cause, dans le débat politique (« la croissance » comme objectif ultime de la politique économique des États), les médias (« l’économie américaine est sortie de la récession au troisième trimestre »)… Il s’agit là d’un changement potentiellement important, mais peu d’acteurs ont commencé à passer à l’acte.
Recommandation n° 2 : mettre l’accent sur la perspective des ménages
Comment ne pas considérer, en effet, que les performances économiques doivent d’abord être mesurées pour les ménages ? Là encore, la disponibilité des données, leur publication par les instituts de statistique ne sont pas suffisants pour que changent les pratiques : encore faudrait-il un effort réel pour déplacer le regard du niveau des performances nationales vers celui des ménages, y compris en matière d’analyse de conjoncture.
Recommandation n° 3 : prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation
Le rapport développe des analyses sur la nécessité de bien mesurer le patrimoine et de l’intégrer dans l’appréhension du bien-être, mais il laisse dubitatif sur la possibilité de le faire correctement dans le contexte d’un capitalisme financier mondialisé où se succèdent les bulles spéculatives et les variations erratiques de prix ; par ailleurs, l’évaluation monétaire est très mal adaptée, quoi qu’en disent les auteurs, au capital humain, au capital social, au patrimoine environnemental.
Recommandation n° 4 : Accorder davantage d’importance à la répartition des revenus, de la consommation et des richesses
On retrouve au premier plan la thématique des inégalités qui avait structuré les débats socioéconomiques des années 1960-1970 ; les inégalités peuvent être mesurées de multiples manières (rapports entre quantiles, indice de Gini, comparaison de catégories socioprofessionnelles, etc.). Cette perspective avait été largement abandonnée par la statistique officielle durant la période néolibérale (1980-2007). Reste à déterminer comment, par exemple diffuser des indicateurs de dispersion et d’inégalités qui soient à la fois simples à présenter et relativement unifiés. Le rapport ne donne aucune indication en ce sens.
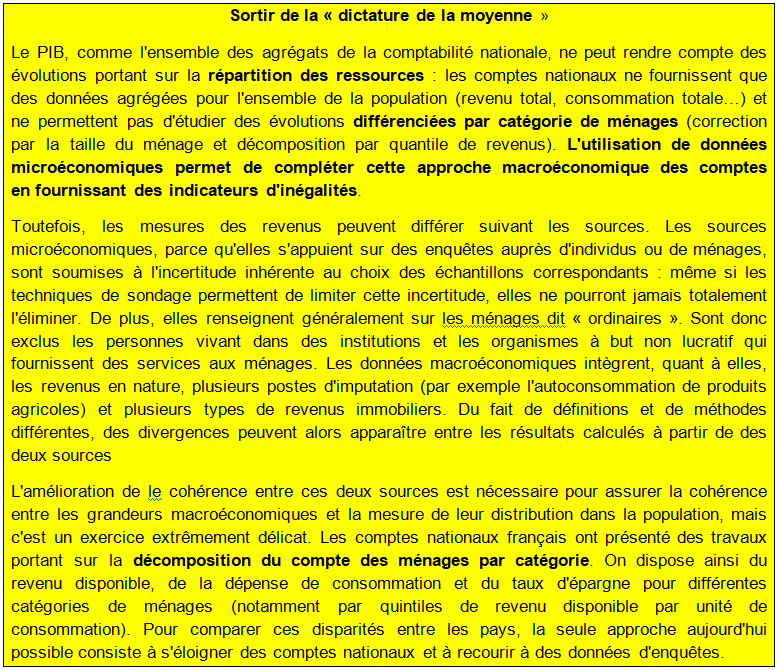
Recommandation n° 5 : élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes
La nécessité de prendre en compte les activités domestiques non marchandes dans la mesure des revenus est reprise dans le rapport. Celui-ci en appelle aussi à la prise en compte du temps de loisir dans l’estimation du bien-être. Le temps disponible (et passé « agréablement ») est une unité au moins aussi importante que l’unité monétaire pour la mesure du bien-être des individus ou des ménages, mais le rapport ne pousse pas le raisonnement jusqu’à l’idée de promouvoir systématiquement des indicateurs non monétaires (bâtis par exemple à partir de l’unité temporelle) ; il se contente d’invoquer la « valorisation des loisirs » (chiffrage monétaire dont on peut craindre qu’il ne soit très artificiel…) et la proportion du temps vécu de façon positive ou négative (dont la mesure est pour l’instant impossible).
Recommandation n° 6 : la qualité de la vie dépend des conditions objectives dans lesquelles se trouvent les personnes et de leurs « capabilités » (capacités dynamiques).
Il conviendrait d’améliorer les mesures chiffrées de la santé, de l’éducation, des activités personnelles et des conditions environnementales. En outre, un effort particulier devra porter sur la conception et l’application d’outils solides et fiables de mesure des relations sociales, de la participation à la vie politique, de l’insécurité, ensemble d’éléments dont on peut montrer qu’il est un bon prédicteur de la satisfaction que les gens tirent de leur vie.
Recommandation n° 7 : les indicateurs de la qualité de la vie devraient, dans toutes les dimensions qu’ils recouvrent, fournir une évaluation exhaustive et globale des inégalités.
Là encore, cette recommandation supposerait un changement de regard assez radical, que les organismes statistiques ne peuvent seuls opérer, quand bien même ils s’y engageraient, ce qui n’est pas acquis, loin s’en faut. En particulier, les inégalités de conditions et d’expériences du travail sont peu évoquées dans le rapport, alors qu’elles conditionnent de multiples aspects de la santé.
Recommandation n° 10 : les mesures du bien-être, tant objectif que subjectif, fournissent des informations essentielles sur la qualité de la vie. Les instituts de statistiques devraient intégrer à leurs enquêtes des questions visant à connaître l’évaluation que chacun fait de sa vie, de ses expériences et priorités.
Le rapport suggère l’intégration de questions d’attitude à des questionnaires qui, jusque-là, les laissaient presque totalement aux instituts de sondage (avec de petits échantillons). Comme l’a montré l’enquête sur le « bonheur au travail », l’exploitation de certaines questions d’attitude peut cependant susciter des interprétations intéressantes. Il est vrai que, comme nous l’avons déjà noté, l’expérience au travail est largement laissée de côté dans le rapport.
Recommandation n° 11 : l’évaluation de la soutenabilité nécessite un ensemble d’indicateurs bien défini. Un indice monétaire de soutenabilité a sa place dans un tel tableau de bord ; toutefois, en l’état actuel des connaissances, il devrait demeurer principalement axé sur les aspects économiques de la soutenabilité.
Là encore, la volonté de mesurer en unité monétaire (« valoriser » ou « monétariser ») les dégâts environnementaux est restée prédominante, même si elle a été contenue dans le rapport final. Le rapport ouvre des voies à la recherche qu’il prend la précaution de ne pas présenter comme des « solutions » universelles, mais ce sont celles qui seront très certainement retenues en priorité par les économistes et statisticiens dominants. L’exemple de l’épargne nette ajustée (ENA), qui est valorisée dans le rapport, montre pourtant que ces travaux ne produisent pas d’indicateurs dénués de nombreuses limites : construit à partir de soustractions à l’épargne brute, cet indicateur semble très artificiel.
Recommandation n° 12 : les aspects environnementaux de la soutenabilité méritent un suivi séparé reposant sur une batterie d’indicateurs physiques. Il est nécessaire, en particulier, que l’un d’eux indique clairement dans quelle mesure nous approchons de niveaux dangereux d’atteinte à l’environnement (du fait, par exemple, du changement climatique ou de l’épuisement des ressources halieutiques).
Cette recommandation de l’ordre de l’évidence implique un travail de recherche qui doit avant tout concerner les experts environnementaux et non les seuls économistes. On peut cependant douter que le constat de niveaux dangereux d’atteinte à l’environnement (comme dans le cas du réchauffement climatique) suffise à créer des réactions politiques à la hauteur de l’enjeu, compte tenu de la pression des forces industrielles et des divers intérêts au statu quo. Le sommet de Copenhague va prochainement illustrer le décalage entre la mise en scène des constats d’alerte et la lenteur, voire les contradictions, de l’action publique.
5/ Les conséquences du rapport sur les travaux de l’Insee
Une multitude de travaux ont été publiés par l’Insee de 2010 à 2020 et présentés selon les trois principaux axes définis par le rapport. Mais, la majorité de ces travaux existaient déjà avant mais ne pouvaient pas être mis sur le devant de la scène. Ils n’étaient pas considérés comme légitimes.
Les développements autour du premier axe, (amélioration de la façon de calculer le PIB) ont été les plus nombreux et sont présentés de manière à satisfaire la recommandation de la Commission de prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation.
D’autres développements importants concerneraient l’évaluation de la qualité de la vie (axe bien-être) pour satisfaire à la recommandation de considérer aussi « des questions visant à connaître l’évaluation que chacun fait de sa vie, de ses expériences et priorités ». On a aussi vu plus haut les évaluations du PIB «ressenti».
Enfin, l’estimation des dimensions et variations du «développement durable et de l’environnement » serait l’objet de 25 % des travaux énumérés par l’Insee. Parmi ceux-ci, une importante partie concerne des mesures physiques, ce qui répond bien à la recommandation de la Commission précisant que « les aspects environnementaux de la soutenabilité méritent un suivi séparé reposant sur une batterie d’indicateurs physiques sélectionnés avec soin », (dont l’un indique clairement dans quelle mesure nous approchons de niveaux dangereux d’atteinte à l’environnement, par exemple pour le réchauffement climatique). Pour l’épargne nette ajustée (ENA), indicateur monétaire synthétique de soutenabilité, l’Insee fait remarquer que « la difficulté à trouver un consensus sur la mesure de la soutenabilité […] plaide en faveur d’une approche éclectique combinant l’ENA et un ensemble d’indicateurs complémentaires focalisés sur les aspects environnementaux ».
VII – LA CRISE DE 2020
Une étude de l’Insee a analysé les caractéristiques de la crise de 2020. Dans la zone euro, le PIB a diminué de 6,6 % sous l’effet de la pandémie mondiale de Covid-19. Toutes les branches ont contribué à la chute de la valeur ajoutée totale. Cependant, celles du commerce, du transport et de l’hébergement et restauration ont été particulièrement affectées. La chute de la consommation privée, en particulier dans les services, est une conséquence directe de la crise sanitaire et des mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation de la pandémie. En France, le PIB a diminué de 7,9 %. Les branches les plus touchées par les effets de la pandémie et les restrictions sanitaires expliquent directement la moitié de la perte globale d’activité, soit 5 points de PIB, et, au total avec les effets indirects en cascade, 6 points de PIB. Du côté des entreprises, grâce au soutien public, l’épargne des sociétés non financières a moins diminué que leur valeur ajoutée. Au total, l’investissement des entreprises a diminué d’environ 9 %, alors que, selon l’évolution de ses déterminants usuels, il aurait pu baisser de l’ordre du double.
1/ L’économie française en 2020 : une année de bouleversements dans la structure de la production
La production est en net recul (− 8,3 %, après + 2,1 %). La baisse est particulièrement marquée dans la production manufacturière (− 12,7 %), en particulier dans les branches des matériels de transport (− 28,1 %). La production des raffineries chute également (− 27,7 % en volume), en raison de la baisse des consommations de carburants et des fermetures de raffineries. Le repli est également marqué dans les biens d’équipement (− 11,4 %). En revanche, il est plus modéré dans le secteur agroalimentaire (− 2,6 %). Dans l’agriculture, la production baisse aussi (− 2,3 %) ; les récoltes de 2020 ont pâti de conditions météorologiques défavorables. La production dans la construction a, pour sa part, été notamment affectée au premier confinement, et diminue de 13,0 % sur l’ensemble de l’année.
La production se dégrade nettement dans les services (− 7,6 %). Si les services immobiliers (− 1,0 %) et les services financiers (− 2,5 %) se contractent peu, les autres services marchands reculent fortement (− 9,4 % dont -23,3% pour les services aux ménages et -34,8% dans les hôtels et restaurants !). Les services principalement non marchands englobant la santé et l’éducation se replient plus modérément (− 3,3 %).
Évolution de la production par branche en volume aux prix de l’année précédente, en %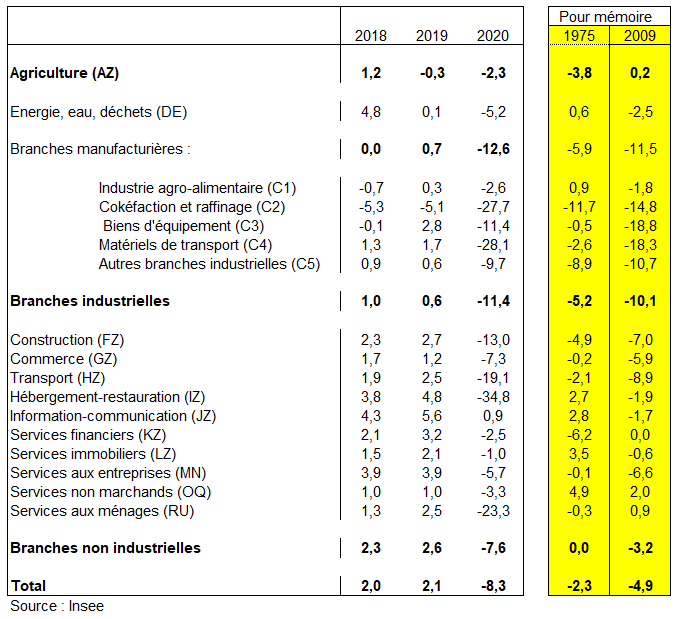
La crise sanitaire de 2020 et les mesures de restrictions ont constitué un choc généralisé de grande ampleur, avec des spécificités sectorielles marquées [6]. Les activités agricoles ou agroalimentaires ont peu reculé. À l’opposé, notamment du fait des fermetures administratives, des secteurs tels que l’hébergement-restauration ont été particulièrement affectés. L’activité a fortement baissé dans l’industrie (automobile et aéronautique), tout comme dans les services de transport. Les effets directs de la crise sanitaire, comme les fermetures administratives, les confinements des travailleurs, les impossibilités de travailler pour garde d’enfants ou encore les problèmes d’approvisionnement, ont fortement limité la production de plusieurs secteurs.
Certaines branches ont été plus particulièrement soumises à des contraintes aiguës sur leur capacité de production, principalement dans l’industrie (équipement électronique, informatique, machines, matériels de transport, produits industriels), la construction, les transports, l’hébergement-restauration et les autres activités de services.
Ces branches qui ont été les plus contraintes méthode représentent un cinquième de la valeur ajoutée totale. Les chocs affectant la production de ces branches réduisent la valeur ajoutée de l’ensemble des branches de façon directe et indirecte. Les effets directs correspondent simplement au recul de la production observée dans ces branches. Les effets indirects proviennent de ce que les contraintes constatées sur ces branches peuvent peser sur les autres en raison de leurs interactions (voir page TES Symétrique). Elles affectent l’ensemble de l’économie via le réseau de production. En effet, puisque ces branches fonctionnent en deçà de leurs capacités, elles adressent une demande plus faible que d’habitude en produits intermédiaires aux autres branches (tableau suivant). Par exemple la branche de l’hébergement-restauration a réduit ses consommations intermédiaires (CI) de produits alimentaires de 34 % en 2020 par rapport à 2019. Par suite, même les branches non touchées directement par les chocs considérés fonctionnent en deçà de leurs capacités et demandent à leur tour moins de produits intermédiaires aux autres branches.
Au total, les branches les plus touchées par les restrictions sanitaires expliquent de façon directe un peu plus de la moitié de la perte globale d’activité, soit 5 points de PIB. Si l’on y ajoute les effets indirects induits en cascade sur les autres branches, l’effet de ces principaux chocs de production atteint 6 points de PIB. Ainsi, dans la branche agriculture, sylviculture et pêche, où l’effet direct est nul, l’effet indirect explique toute la baisse de la valeur ajoutée : – 3,0 %. Les autres effets (restrictions sur les autres secteurs privés et les services publics hors santé, effets de demande étrangère et d’anticipations des agents représentent, par solde, entre 3 et 4 points de l’écart entre l’évolution observée du PIB et sa tendance de moyen terme. Ainsi, par exemple, la branche cokéfaction et raffinage n’a pas subi majoritairement de contraintes de production liées à la crise sanitaire mais sa valeur ajoutée a diminué de près de 20 %. Cette baisse s’explique, d’une part, par celle de la demande des ménages, qui ont beaucoup moins utilisé leurs véhicules en 2020 et donc moins consommé de carburant, d’autre part, par des difficultés de production qui ne semblent pas liées à la crise sanitaire (un des sites a très peu produit en 2020 à cause de nombreux incidents techniques et un autre a été affecté par des grèves du personnel).
La baisse d’activité des branches de l’économie les plus affectées par la crise sanitaire et les mesures de restrictions se répercutent sur les branches qui leur sont fortement liées, que ce soit en amont ou en aval du processus de production. Les flux entre branches, figurant dans le tableau des entrées intermédiaires suivant, retracent ces répercussions en cascade . Le réseau de production a été fortement modifié en 2020 : les variations en volume des CI, bien plus fortes que d’habitude, reflètent avant tout les évolutions de la production propres à chaque branche, marquées par de nettes différences : ainsi les branches de la cokéfaction et raffinage, de l’hébergement-restauration et des matériels de transport ont consommé beaucoup moins d’intrants, tandis que les branches de l’information-communication, des administrations publiques et des activités immobilières ont stabilisé globalement leurs achats. Des modifications de structure ont cependant eu lieu. Ainsi, par exemple, dans les administrations publiques, les CI, portées par les services de santé, ont augmenté en autres produits industriels (+ 5 %), en masques notamment. Même les branches dont l’activité a relativement bien résisté ont malgré tout réduit leur consommation de certains produits : les activités juridiques et comptables, dont l’ensemble des CI n’a baissé en volume que de 5 %, ont restreint leur consommation intermédiaire d’hébergement-restauration de 41 %. Dans le tableau suivant, les cases grisées correspondent à des CI inférieures à 3 milliards d’euros en moyenne en 2019 et 2020.
Principales évolutions des consommations intermédiaires entre 2019 et 2020 en % ; source: Insee, comptes nationaux, TES 2019 semi-définitif et 2020 provisoire en valeur

2/ Baisse de l’épargne des entreprises, malgré les mesures de soutien
La chute de la valeur ajoutée des sociétés non financières a été d’une ampleur inédite en 2020 : – 8,3 % (en valeur), soit une diminution de 105,7 milliards d’euros (Md€) par rapport à 2019.
Globalement, les mesures de soutien ont permis d’atténuer la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) des sociétés non financières. Le dispositif de chômage partiel a diminué les charges salariales tout en maintenant les salariés dans l’emploi : les salariés ayant une perte de salaire, en raison de la réduction de leur temps de travail, sont indemnisés par l’employeur. En contrepartie, celui-ci perçoit une allocation d’activité partielle cofinancée par l’État et l’Unédic). Le fonds de solidarité en a soutenu les revenus des petites et moyennes entreprises. Les exonérations de cotisations sociales ciblées sur les secteurs les plus touchés ont donné un peu d’air. Malgré tout, l’EBE des sociétés non financières s’est fortement contracté (- 12,5 %, soit – 53,0 Md€) ; le taux de marge a ainsi reculé de 1,5 point (graphique suivant). Toutefois, en tenant compte de la sortie du dispositif du CICE, qui aurait de toute façon conduit à une diminution du taux de marge (- 1,6 point), celui-ci serait quasi stable (+ 0,1 point hors CICE).
Avec le recul de l’activité, les entreprises ont moins versé de dividendes. La baisse de l’impôt sur les sociétés a joué son rôle stabilisateur, si bien que leur épargne a diminué (- 43,3 Md€). en 2020. Elle diminue de 14,4 % avec une contribution de 17,7 points de l’excédent brut d’exploitation (EBE) (graphique suivant). Le besoin de financement des sociétés financières s’est aussi creusé significativement (de 9,0 Md€), malgré les mesures de soutien au revenu et la baisse des investissements des entreprises. Ceux-ci se sont sensiblement repliés en 2020 (- 9,6 %). Pour autant, ils ont évolué plus favorablement qu’attendu selon l’évolution de ses déterminants usuels. En général, l’évolution de l’investissement des entreprises s’explique principalement par la variation de la valeur ajoutée, bon indicateur de la demande anticipée. Ainsi, l’investissement s’est réduit en 2020 dans une ampleur comparable à celle du PIB, contrairement à ce qui avait été observé durant la crise de 2008.
Cette analyse ne prend pas pleinement en considération l’hétérogénéité des entreprises. Celles-ci n’ont pas toutes connu la même évolution. L’analyse des données individuelles fait ressortir à la fois l’ampleur du choc, en particulier dans certains secteurs très affectés, mais aussi la variété des trajectoires d’entreprises, certaines étant parvenues à limiter la baisse de leur activité.
Épargne des sociétés non financières, source: Insee, comptes nationaux,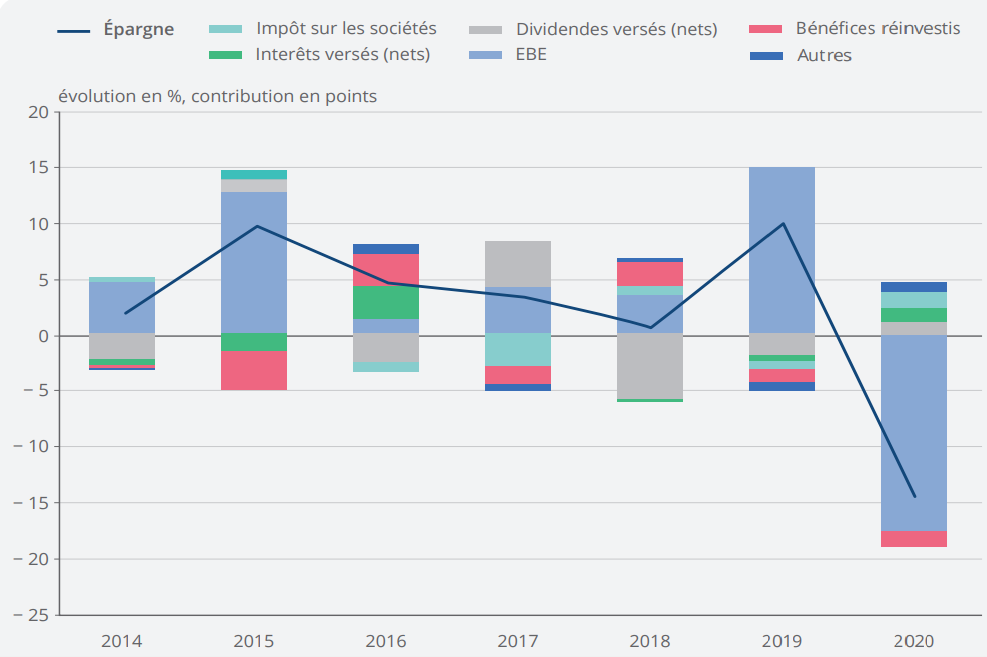
3/ Le pouvoir d’achat des ménages globalement préservé
Malgré la baisse d’activité, le revenu disponible des ménages a progressé de 1,0 % en valeur Cette divergence atypique s’explique essentiellement par les mesures de soutien au revenu. En effet, les revenus d’activité des ménages, c’est-à-dire les salaires et les revenus des indépendants (avant les aides du fonds de solidarité), ont chuté de 4,8 %, soit une baisse de 44,8 Md€ par rapport à 2019, de même que les revenus du patrimoine, en particulier les dividendes (- 8,2 Md€). Ce recul des revenus, lié à la baisse de l’activité (le PIB en valeur a diminué de 5,5 %), a toutefois été compensé par la forte progression des prestations sociales et les subventions du fonds de solidarité, ainsi que par la diminution des impôts directs. Les prestations sociales en espèces ont fortement progressé (+ 9,5 %, après + 2,9 %) sous l’effet des mesures d’urgence ; en premier lieu, les allocations d’activité partielle (+ 27,4 Md€), ainsi que les aides de solidarité aux ménages en situation de précarité et la revalorisation de la prime d’activité. Par ailleurs, les dispositifs de redistribution existants, notamment les allocations chômage et les indemnités journalières, ont également été sollicités, avec parfois des évolutions notables des règles.
Les entrepreneurs individuels ont bénéficié des subventions du fonds de solidarité (+ 9,1 Md€), ainsi que d’exonérations de cotisations permettant d’amortir la baisse de leur revenu. Ils ont aussi bénéficié de reports d’échéance visant à renforcer leur trésorerie, sans effet sur leurs revenus.
Les impôts directs ont baissé de 3,6 %, soit – 8,9 Md€, avec le recul des revenus d’activité, en particulier la CSG et l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La diminution de l’impôt sur le revenu qui s’est appliquée en 2020 et, dans une moindre mesure, la mise en œuvre de la troisième étape de suppression de la taxe d’habitation (pour 80 % des ménages) ont joué également à la baisse.
Au total, avec des prix peu allants (+ 0,6 % en 2020), le pouvoir d’achat des ménages a progressé de 0,4 %. Mesuré en unité de consommation pour tenir compte de l’évolution de la taille et de la structure des ménages, le pouvoir d’achat des ménages est stable (+ 0,0 % après + 1,6 % en 2019).
4/ Baisse de la consommation et hausse du taux d’épargne des ménages
En 2020, bien que leur revenu ait résisté, la consommation des ménages a diminué de 7,0 %, après une hausse de 2,6 % en 2019 et une croissance annuelle moyenne de 0,9 % depuis 2008. Cette baisse explique en grande partie celle du PIB.
L’année 2020 a été très particulière pour la consommation. Tout d’abord, les ménages ont modifié leurs façons de consommer depuis la mi-mars et de manière plus marquée pendant les périodes de confinement. Ils n’ont pas pu consommer certains biens ou services ou ont dû fortement les limiter (culture, restauration, tourisme, commerces non essentiels par exemple), la situation sanitaire ayant réduit l’offre. D’autres comportements de consommation, au contraire, se sont développés par nécessité (achats à distance) ou par substitution (livraison de repas à domicile).
Ensuite, du fait de la crise économique, les comportements d’épargne se sont modifiés. D’une part, certains ménages n’ont pas pu consommer autant qu’ils l’auraient souhaité, du fait des fermetures administratives et des confinements, ce qui a augmenté mécaniquement leur épargne. D’autre part, l’inquiétude liée à l’incertitude économique et sanitaire a aussi pu accroître leur épargne de précaution. Le confinement a beaucoup influé sur le taux d’épargne des ménages en 2020. Ce surcroît d’épargne confirme le caractère exceptionnel de l’année 2020. Entre fin 2019 et fin 2020, le taux d’épargne a augmenté d’environ 7 points.
Ici aussi, les comportements d’épargne varient en fonction du niveau de vie : la consommation des ménages les plus modestes a relativement peu diminué alors qu’au contraire, celle des cadres ou des ménages à hauts revenus aurait davantage baissé, le montant absolu de leur patrimoine augmentant en conséquence. Pendant les deux confinements de 2020, tous les groupes de ménages étudiés, quel que soit leur niveau de revenus, auraient réduit leur consommation et l’auraient recentrée sur les biens de première nécessité, notamment en avril. Les ménages qui consommaient le plus avant la crise, essentiellement des cadres ou des hauts revenus, auraient donc davantage restreint leur consommation. En 2020, par rapport à la tendance pré-crise, sur un champ restreint, la consommation a été inférieure de 3 % pour les 10 % de ménages aux revenus les plus bas et de 22 % pour les 10 % de ménages aux revenus les plus hauts.
La chute de la consommation a provoqué un surcroît d’épargne. Le patrimoine financier brut des ménages aurait fortement augmenté en 2020. Cette hausse est plus élevée en euros pour les ménages à hauts patrimoines financiers, qui ont pu épargner davantage en diminuant leur consommation. Les ménages à faibles patrimoines financiers ont également mis de l’argent de côté, notamment pendant le premier confinement ; cependant, les montants, quelques dizaines ou centaines d’euros en général, demeurent faibles, même s’ils représentent une part importante de leur patrimoine initial.
5/ Des échanges extérieurs en forte baisse
En 2020, les importations en volume ont diminué de 10,3 % pour les biens et de 8,8 % pour les services, sous l’effet de la baisse de la demande intérieure, en particulier de la consommation des ménages et de l’investissement des entreprises. Les exportations en volume ont diminué respectivement de 14,5 % et de 8,4 %. Au total, malgré une facture énergétique en repli, le solde extérieur s’est dégradé significativement, de 23,2 Md€, pour atteindre 46,5 Md€, en raison notamment de la réduction des excédents des autres matériels de transports, dont l’aéronautique (dégradation de 19,3 Md€ du solde), et du tourisme (dégradation de 8,1 Md€).
6/Les dépenses publiques soutiennent les revenus des agents privés
Avec la contraction inédite de l’activité économique en 2020, les risques de faillite pour les entreprises et de chômage pour les ménages se sont considérablement accrus, ce qui a conduit les administrations publiques à mettre en œuvre des dispositifs d’aide.
Tout d’abord, des mesures de soutien au revenu des ménages et des entreprises ont été prises, principalement l’activité partielle et les subventions versées par le fonds de solidarité aux petites et moyennes entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. La hausse des prestations en espèces entre 2019 et 2020 est ainsi de 46,6 Md€. Ces mesures ont eu un impact direct sur le solde public, auquel s’est ajoutée la baisse des recettes fiscales et sociales liée à la perte d’activité. En outre, la lutte contre la pandémie a induit des dépenses supplémentaires (achats de masques, respirateurs, tests, etc.). Au total, les dépenses des administrations publiques ont bondi (+ 73,5 Md€), tandis que les recettes chutaient (- 63,8 Md€). Le déficit public s’est ainsi creusé fortement par rapport à 2019 (+ 137,3 Md€) pour atteindre 212,0 Md€ en 2020, soit 9,2 % du PIB (graphique suivant).
Les dispositifs de soutien au revenu ont été complétés par des mesures de renforcement de la trésorerie des entreprises telles que les reports d’échéances fiscales et sociales ou les prêts garantis par l’État qui, sans jouer sur leurs revenus, ont permis aux entreprises de faire face à leurs charges récurrentes et ont ainsi évité des faillites. Au total, le creusement du déficit public a permis d’absorber la majeure partie de la perte de revenu national pour les agents privés en 2020.
Variation du déficit public entre 2019 et 2020, source: Insee, comptes nationaux
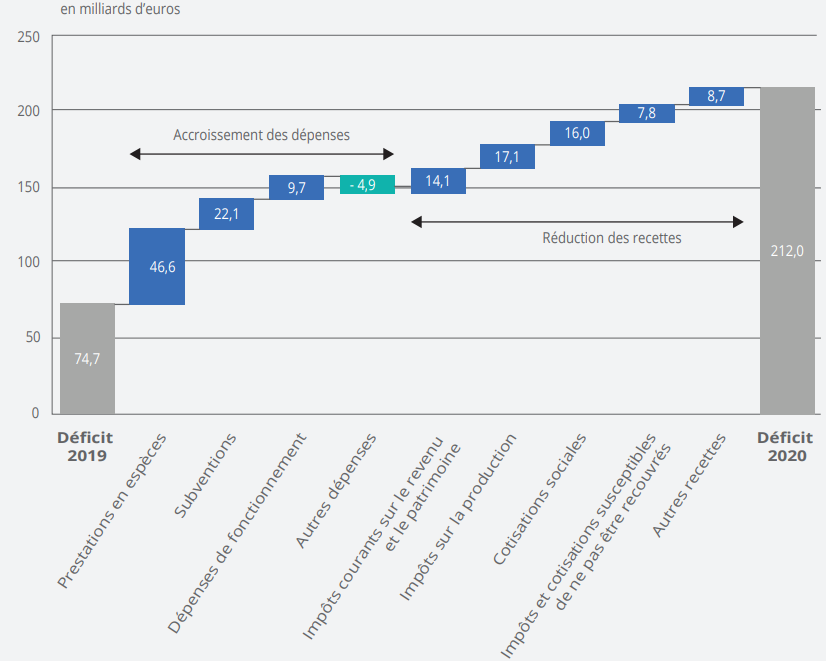
VIII – L’ADAPTATION DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE À LA CRISE DE 2020
Dans ses perspectives économiques décembre 2021, l’OCDE écrit : « L’économie mondiale continue de se redresser, tout comme les échanges, l’emploi et les revenus. Mais cette reprise est pleine de déséquilibres : entre les pays, entre les entreprises et entre les populations, confrontés à des réalités économiques très différentes. Les récentes améliorations masquent également des changements structurels, où certains secteurs, métiers, technologies et comportements ne seront plus jamais les mêmes qu’avant la pandémie. Dans cette situation extraordinaire, nos perspectives économiques sont prudemment optimistes. Elles mettent l’accent sur les politiques requises pour contrebalancer les incertitudes actuelles et l’apparition inhabituelle de tensions inflationnistes au tout premier stade de la reprise. La situation sanitaire, les contraintes d’offre, l’inflation et le risque de faux pas des acteurs de politiques publiques sont autant de sujets de préoccupation majeurs ».
C’est bien là un souci majeur. Autrefois, les prévisions étaient à peu près « stables ». Avec la crise économique actuelle et les confinements à répétition, il est devenu très difficile de prévoir le PIB dans les 3 mois suivants, faire de la conjoncture, établir des comptes trimestriels. Que peut-on encore calculer à court terme ? La crise de 2020 ne peut être mesurée en comptabilité nationale comme les crises précédentes, à la fois par son ampleur ou ses rechutes possibles en fonction notamment de la répétition des variants épidémiques.
En France, la crise sanitaire a obligé à des adaptations inédites pour l’ensemble des acteurs du suivi économique conjoncturel : l’Insee et l’ensemble du système statistique public, l’OFCE, Rexecode, la Banque de France, pour ne citer que les principaux d’entre eux … Les évaluations de l’ampleur du choc se sont accumulées et affinées au fil des semaines, chaque organisme y contribuant selon ses tropismes et ses avantages comparatifs, chacun tirant parti des travaux des autres et les nourrissant en retour.
Par ailleurs cette crise a mis en évidence des questions conceptuelles importantes et des problèmes de mesure en partie traités parfois suite à des directives d’Eurostat comme la mesure de la production non marchande ou la frontière de la production en passant par la mesure des indices de prix et surtout celle de la productivité du travail avec le développement du télé-travail, et donc des heures travaillées au dénominateur de ce ratio.
Aussi bien pour la période encore en cours que pour la sortie de crise qui sera peut-être longue, devrait venir le temps de l’analyse, des arbitrages, de l’observation de ce qui réussit plus ou moins bien en France et dans les autres pays. Les comparaisons entre pays vont être de plus en plus sur le devant de la scène, défi encore plus redoutable que tous les précédents.
Car dans beaucoup de domaines, la comparabilité des statistiques n’est pas acquise, et un seul institut national, fût-il animé des meilleures intentions, ne peut rendre parfaitement compte des possibilités et des limites des comparaisons internationales. La coordination statistique internationale intervient certes pour harmoniser au mieux les façons de mesurer, par exemple la recommandation d’Eurostat sur les prix (voir ci-dessous), mais ceci ne suffit pas à soi tout seul à garantir la comparabilité des chiffres, car une directive donnée peut être appliquée de manière très variable d’un pays à l’autre. Ce qui est déjà vrai en temps ordinaire dans l’application des concepts et méthodes des manuels internationaux l’a été plus encore dans un contexte de crise où chaque pays a dû faire avec ses moyens du bord.
Il faudra donc, à l’avenir, que les statisticiens publics des différents pays sachent répondre à cette attente croissante de comparabilité. Il faudra aussi que tous les observateurs prennent conscience de cette difficulté et adoptent un maximum de discernement et de prudence lorsqu’il s’agira de commenter des écarts entre pays.
On se réfère aux travaux déjà cités en bibliographie en rappelant les principaux aspects méthodologiques.
1/ La nécessaire adaptation des comptes trimestriels
Décrire comment le suivi par l’Insee de l’activité économique à court terme a dû s’adapter à la crise impose d’abord de rappeler en quoi il consiste d’ordinaire. En temps normal, l’Institut alimente le diagnostic à court terme sur l’économie française de deux manières :
- Son département de la conjoncture produit tous les trois mois une Note ou un point de conjoncture avec des premières estimations de l’évolution de l’économie française sur le trimestre qui s’achève ou vient de s’achever, et des prévisions courant sur le trimestre ou les deux trimestres suivants. Ces estimations combinent premières informations « en dur » sur les premiers mois du trimestre écoulé, telles que l’indice de la production industrielle, et éclairages plus qualitatifs fournis notamment par les réponses des entreprises aux enquêtes de conjoncture collectées et publiées par l’Insee à rythme mensuel. Ces dernières recueillent une information qualitative légère sur la façon dont les entreprises apprécient la tendance (stable, en hausse ou en baisse) d’un certain nombre de variables (activité passée et future, emploi, prix, …) qu’on synthétise sous forme d’indicateurs de climat des affaires ;
- Les comptes trimestriels publient ensuite leurs estimations de l’évolution effective de l’économie sur le trimestre écoulé : la première estimation est publiée un mois après la fin du trimestre, elle consiste en une fiche de PIB présentant l’évolution de ce dernier et de ses principales composantes (voir méthode dans page Le PIB). Des résultats plus détaillés sont publiés deux mois après la fin de ce trimestre incluant notamment ce qu’on qualifie de comptes d’agents : le revenu disponible brut des ménages, leur taux d’épargne, le taux de marge des entreprises, … L’approche de ces comptes trimestriels reste hybride entre l’observation et la prévision, comme pour la note de conjoncture : lors de leur première estimation, l’estimation du dernier mois du trimestre garde encore une part substantielle d’extrapolation. On note aussi que les comptes trimestriels ont pris de l’importance par rapport aux comptes annuels depuis plusieurs décennies, notamment en France. Les confinements à répétitions durant chaque hiver et leurs conséquences économiques amènent d’ailleurs à se demander si ils ont encore autant de sens ? Les comptes annuels deviennent presque plus robustes et donc de nouveau utiles.
Les comptes trimestriels du premier trimestre 2020, qui étaient attendus pour la fin avril, étaient directement concernés par la crise, son déclenchement ayant affecté les deux dernières semaines de ce premier trimestre : il fallait se préparer à rendre compte de cet impact.
Mais la production la plus immédiatement exposée était la Note de conjoncture dont la sortie avait été annoncée pour le 26 mars 2020. Son scénario avait constamment évolué au cours de sa phase d’élaboration, au fur et à mesure que la perspective d’une crise majeure se dessinait, mais pas au point d’anticiper l’ampleur de ce qui s’est brutalement concrétisé avec l’entrée en confinement. Tenter d’intégrer cette rupture dans la dernière ligne droite n’avait pas de sens, car il n’y avait aucune base solide pour construire un nouveau scénario un tant soit peu assuré. Nul ne savait quelle chute d’activité le confinement allait entraîner et encore moins quelle allait être sa durée, or il fallait connaître l’une et l’autre pour apprécier son effet sur la croissance du trimestre qui allait débuter. De ces deux sources d’incertitude, la durée du confinement pouvait au mieux être l’objet d’hypothèses et les conjoncturistes étaient encore moins bien équipés que les épidémiologistes pour formuler ces hypothèses. Le choix de l’Insee a ainsi été de ne pas rentrer dans cet exercice. Il a choisi de se concentrer sur la mesure de la chute instantanée d’activité, en temps aussi réel que possible (méthode du « newcasting ») , en substituant au dispositif usuel des Notes de conjoncture la publication de points réguliers, à un rythme qui a d’abord été de toutes les deux semaines, puis toutes les trois semaines, centrés sur seulement deux indicateurs : l’activité, au sens du PIB, et la consommation des ménages.
Dans les comptes trimestriels traditionnels, il y a deux publications par trimestre en temps normal, l’une (première estimation) à T+30, l’autre (résultats détaillés) à T+60. Dans la première publication, les chiffres d’affaires mensuels du dernier mois ne sont pas connu, le TES est publié en niveau A17 de la nomenclature NAF. Dans cette dernière tous les indicateurs sont disponibles. Les comptes de secteurs institutionnels sont publiés. En 2020, on a adapté les comptes trimestriels à la crise et fait les publications comme prévues.
La publication des premières estimations des comptes nationaux pour le premier trimestre à la fin avril avait ainsi mis en lumière certains résultats contre-intuitifs, comme une moindre chute du PIB en Italie (-4,7 %) qu’en France (-5,8 %) malgré l’apparition plus précoce de foyers épidémiques en Italie et une période plus longue de confinement au cours de ce premier trimestre. Cet écart rendait-il compte d’une différence effective d’évolution de l’activité ou pouvait-il tenir à des différences de méthodes dans l’élaboration de ces comptes trimestriels ?
Lorsque l’Insee a produit une estimation du premier trimestre à la fin avril 2020, le problème était qu’il ne disposait que de très peu d’informations quantitatives sur le dernier mois du trimestre. Ce qui n’est pas rédhibitoire en temps normal pose un sérieux problème lorsque ce dernier mois subit un choc majeur comme cela a été le cas pour mars dans toutes les économies européennes. Dès lors, les comptables nationaux de chaque pays ont dû innover, court-circuiter les extrapolations habituelles, exploiter des sources alternatives, prêter attention aux travaux des conjoncturistes. L’Insee a jugé que les exercices conjoncturels bimensuels déjà mentionnés étaient suffisamment robustes pour pouvoir être exploités, ils a pu bénéficier de l’information apportée par les transactions par cartes bancaires ; ils l’a d’ailleurs expliqué en toute transparence dans la note méthodologique qui a accompagné la publication des comptes le 30 avril 2020.
Les deuxièmes estimations du premier trimestre (T+60) ont, de fait, commencé à rectifier ces écarts peu intuitifs entre pays, mais ce n’est que progressivement qu’on est parvenu à totalement stabiliser l’image. Il est par ailleurs possible que les différences de mesures adoptées sur le marché du travail, ou les différences dans la sévérité du confinement, conduisent aussi à des perturbations dans la comparaison entre pays des indicateurs estimés par l’enquête Emploi, dont le taux de chômage. Il est possible que des choix différents en matière d’imputation des prix dans les secteurs du commerce et des services fermés puissent aussi affecter les écarts d’inflation.
Ainsi il a fallu s’adapter pour élaborer les comptes trimestriels publiés fin avril 2020 (T+30) sur le premier trimestre 2020 marqué par le premier confinement le 17 mars. Le département de la Conjoncture de l’Insee avait beaucoup raccourci son horizon temporel. Dans certains points de conjoncture, notamment à l’été et à l’automne 2020, leur publication ne portait que sur le mois ou le trimestre passé, et était publié un peu avant la première estimation des comptes trimestriels, lesquels rapprochaient beaucoup de leur champ d’étude. Les méthodes usuelles ne permettaient pas de rendre compte de la chute de l’activité. Le « nowcasting » est une adaptation majeure : il s’agit d’un « rapprochement temporel » entre la conjoncture et les comptes trimestriels avec une alimentation des comptes trimestriels pour les premières estimations (T+30). Il s’agit de mobiliser les informations des conjoncturistes. En prévision immédiate, ces données sont utilisées pour calculer des séquences d’estimations du PIB du trimestre en cours par rapport au flux en temps réel des publications de données.
Mais beaucoup d’adaptations ont été nécessaires : en particulier mobiliser de nouvelles données tout en maintenant les traitements sur l’année 2020 dans le temps. Par exemple, pour la construction, la méthode usuelle des « mises en chantier » et des « grilles délais » repose beaucoup sur la prolongation des tendances passées. On estime l’avancement de la construction d’un immeuble tous les mois,etc. Ces indicateurs étaient momentanément indisponibles. Il a été procédé à une estimation directe de la FBCF en construction à partir de l’estimation de l’activité par des informations des fédérations : heures travaillées, enquête sur la déclaration sociale nominative (DSN) de la DARES tout en sachant qu’on perdait de l’information par secteurs institutionnels.
Il semble d’ailleurs qu’on a beaucoup moins parlé dans les comparaisons internationales de la plus forte chute de l’activité dans la construction en France que dans les autres pays (on n’observe pas une telle baisse en Allemagne), par rapport aux discussions sur le non-marchand. Alors que le premier phénomène semble important : au T1 2020, la baisse de la construction explique un peu plus du quart de la chute de l’activité, soit un effet quatre fois plus fort que celui des services non marchands sur ce trimestre.
De même, dans certains secteurs (loisirs, culture non marchande, consommation de biens divers), on au du recourir à des informations de la conjoncture en remplacement de certains lissages. Enfin dans les services publics, on a distingué ceux où le télétravail était possible et ceux où il ne l’était pas vraiment (éducation, services à la clientèle). Comme les salaires continuaient d’être payés, la production en valeur évaluée par la somme des coûts, ne s’est pas réduite tandis que la production en volume baissait du fait de la baisse du nombre d’heures travaillées liées au chômage technique des agents publics. Il s’en est suivi une hausse assez importante des prix de production. Mais comment quantifier cette baisse des heures travaillées ?

Dans les comptes trimestriels, il y a une partie estimée et une partie lissée (voir ci-dessus). Mais est ce-que cette distinction est pertinente avec le confinement ? Il a fallu revoir les régressions traditionnelles d’étalonnage et de calage, et notamment revoir la constante de l’équation ci-dessus d’étalonnage et ajouter une « cale » sinon la baisse de l’activité aurait été trop faible. En temps normal, les équations traditionnels d’étalonnage-calage « amortissent » les variations des indicateurs endogènes ). Si tous ces indicateurs sont fortement orientés à la baisse, cet amortissement crée un biais à la hausse. D’où la nécessité d’ajouter une « cale » pour corriger ce biais.
En effet si tout est orienté à la baisse, cet amortissement crée un biais à la hausse. Or, vu la spécificité du choc du confinement, il a semblé plus logique de supposer que cette partie résiduelle évoluait pendant la crise comme la partie expliquée. La cale « spéciale COVID » qui a été ajoutée dans l’étalonnage vise justement à donner à cette partie résiduelle le profil de la partie expliquée, pour la période crise. Cela s’apparente à l’ajout d’une variable « dummy » (variable indicatrice) dans l’estimation de l’étalonnage annuel, auquel on donne un profil trimestriel particulier. C’est comme si on ajoutait une variable « covid » à la régression d’étalonnage ; qui « capture » ainsi l’effet spécifique à 2020 et 2021 non expliqué par l’indicateur. Cet effet ne se retrouve donc plus dans le résidu, ce qui rend ce dernier plus lisse.
En temps « normal », on fait aussi l’hypothèse que certaines séries sont peu affectées par les aléas conjoncturels (production non-marchande, coefficients techniques, services financiers, les loyers imputés, etc…). Mais il y a tout lieu de penser que ce n’était pas vrai pendant les confinements. Ils ont par exemple autant perturbé l’activité des services d’administration (comme l’Insee) que des services de bureaux marchands. Le choix de l’administration de ne pas appliquer le chômage partiel à ses agents et de maintenir leur rémunération ne devait pas conduire à traiter différemment du point de vue de la production de services ces deux cas.
S’agissant des coefficients techniques comment fallait -il les ajuster? Le choc sur les méthodes de production bouleverse les CT (Fermeture des restaurants d’entreprises). Loyers, coûts fixes identiques à production réduite . Il n’ a pas été possible d’ajuster les coefficients « à la main »…C’était trop complexe dans les conditions de l’époque avec des « effets indirects » sur la VA totale (voir page TES Symétrique). Ces coefficients ont été corrigés au compte provisoire (et suivants).
En conclusion, les confinements à répétition ont entraîné un changement de la méthode des comptes trimestriels. Qu’en sera-t-il à l’avenir? L’adaptation a permis de continuer à produire les mêmes comptes qu’en temps normal. L’enjeu n’est pas seulement de mesurer l’ampleur du choc mais d’inscrire les adaptations dans la chronologie. Il est probable qu’il faudra ré-estimer l’année 2020 dans la prochaine base des comptes nationaux.
De nouvelles sources ont été utilisées : Les données de cartes bancaires sont ainsi prometteuses pour estimer la consommation finale de services en première estimation. Il s’agit ainsi d’une adaptabilité des outils statistiques : enquête ACEMO-COVID, déclaration sociale nominative (DSN), etc…
2/ le partage volume-prix de services non marchands
La production est mesurée par la somme des coûts de production (les consommations intermédiaires, les salaires, etc.). Durant la période le confinement, les salaires des agents publics ont été intégralement versés, si bien que, en termes nominaux, la valeur ajoutée des administrations publiques n’a pas été affectée, étant donné son mode de calcul [9].
Mais on ne peut évidemment pas supposer que cette stabilité nominale s’est accompagnée de la même stabilité en volume, c’est-à-dire de la quantité de services rendus.
Pour mesurer les volumes d’activité non marchandes, les méthodes utilisées par les comptables nationaux diffèrent selon que le service est « collectif » ou « individuel ».
Les services dits collectifs sont ceux qui profitent à l’ensemble de la collectivité de façon indifférenciée : il s’agit de services tels que l’administration des affaires publiques, la défense, l’application de la loi, etc. Leur consommation ne peut pas être attribuée à des entreprises ou des ménages en particulier. Le volume de la production ne peut donc être appréhendé directement ; la convention qui est retenue est de considérer que la valeur ajoutée en volume évolue approximativement comme les heures travaillées par les agents publics participant à ces activités, corrigées d’un effet qualité liée à la structure de qualification (méthode « input ») (voire page Mesure des volumes et des prix).
À l’inverse, les services individuels sont produits par les administrations publiques pour répondre à des besoins particuliers, le plus souvent à destination des ménages. Il s’agit de la santé et de l’éducation principalement. Pour la plupart, ces services ne sont pas fournis gratuitement, les ménages qui les consomment prenant à leur charge une partie du coût, même résiduelle. Pour ces services, il est possible d’approcher directement le volume d’activité à partir de la consommation effective des ménages : nombre d’heures de cours par filière d’enseignement, nombre de séjours à l’hôpital par type de maladie et de prise en charge (méthode « output »).
Or, le confinement, contrairement aux crises passées, a introduit une hétérogénéité de situation pour les employés des administrations publiques. Pour ceux travaillant sur site ou en télétravail, leur production peut être considérée comme ayant été maintenue, voire en augmentation dans certains cas. Mais pour les employés des administrations publiques qui ne sont ni en situation de télétravail, ni sur site, de fait, leurs salaires ne correspondent plus à une production et leur situation peut s’assimiler au dispositif d’activité partielle du secteur privé.
La production et la valeur ajoutée des administrations publiques ont donc été réduites en volume pour prendre en compte cette dernière situation, en rupture par rapport à la méthodologie ci-dessus qui aurait conduit à décrire, à tort, une évolution tendancielle des services non marchands. Ce faisant, l’Insee s’est conformé aux préconisations d’Eurostat.
Toutefois, la part des agents publics qui ne sont ni en situation de télétravail ni sur site est difficile à estimer parce que les indicateurs d’activité dans le secteur non marchand font défaut. L’estimation conventionnelle retenue était qu’un quart des agents publics, hors services de santé, n’était pas en situation de travail pendant la durée du confinement. Cette première estimation a depuis été confortée par les exploitations de l’enquête Emploi. Néanmoins, ces données restent fragiles et il n’est pas dit que des données plus fiables que celles de l’enquête Emploi soient disponibles un jour pour les services non marchands hors santé, pour lesquels aucun dispositif administratif de mesure de l’activité n’était en place au moment du confinement. Au total, les comptables nationaux ont été davantage confrontés au manque de données qu’à un problème de méthode.
S’agissant des services de santé (hors soins de ville), ils ont été maintenus à leur niveau d’avant crise pour les premières estimations, faute de données pour déterminer si les surcoûts liés aux traitements de la Covid-19 étaient supérieurs ou non à la baisse des autres activités de soin. On a considéré qu’une partie de ces surcoûts avait contribué à améliorer la réponse des hôpitaux à la pandémie (heures supplémentaires, réorganisation des hôpitaux) et que les primes versés aux personnels soignants récompensaient l’intensité hors norme du travail accompli pour faire face à la pandémie ; l’ensemble des surcoûts ont donc été intégrés dans le volume des services produits et non dans le prix. Toutefois, au deuxième trimestre, l’activité des services de santé serait en recul par rapport au premier : la baisse des autres soins (déprogrammation des actes non essentiels, etc.) l’emporterait sur le surcroît d’activité de soins lié au Covid-19.
Au niveau international, une façon de détecter d’éventuelles divergences de traitement est de regarder, dans chaque pays, s’il y a eu parallélisme des évolutions du marchand et du non-marchand ou au contraire des divergences significatives. Il n’y a certes pas de raison pour que l’activité du marchand et celle du non marchand aient évolué exactement de la même manière à l’intérieur de chaque pays. Il est par exemple probable que le taux d’équipement relatif des administrations en ordinateurs portables n’était pas le même d’un pays à l’autre. Les mesures de confinement ont aussi pu avoir des effets différenciés sur le privé et le public dans les pays où elles n’ont pas eu la même durée et la même intensité dans tous les points du territoire, compte tenu de répartitions territoriales différenciées des deux catégories d’emplois.
Néanmoins, des évolutions comparables du marchand et du non marchand suggèrent qu‘un pays a bien tenté de quantifier une chute d’activité du non marchand, et des évolutions divergentes invitent à penser que tel n’a pas été le cas.Pour troispays (la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni) l’évolution de la valeur ajoutée des services principalement non marchands a été relativement proche de celle du PIB, ce qui laisse penser que, dans ces pays, les traitements statistiques auraient été plutôt cohérents. Pour l’Allemagne et la France on sait que les durées de confinement n’ont pas été les mêmes, 34 jours contre 55 jours, et un écart de même ampleur en découle aussi bien entre leurs secteurs marchands que non marchands. En revanche, pour l’Italie et de façon bien plus prononcée encore pour l’Espagne, les activités principalement non marchandes et le PIB ont des évolutions divergentes : l’activité non marchande est réputée n’avoir baissé que de 7,6 % en Italie et être restée stable en Espagne, alors que l’activité globale y a baissé de respectivement 18,0 % et 21,5 %, ce qui pose question. Les difficultés liées au traitement statistique des services non marchands durant les périodes de confinement auraient ainsi affecté la comparabilité des résultats entre pays. Même si les écarts restent dans des proportions qui ne remettent pas en cause les ordres de grandeur au niveau de l’économie prise dans son ensemble, la convergence des traitements statistiques au sein de l’Union européenne, et au-delà, est souhaitable.
Au final, la consommation des administrations publiques recule de 3,2 % en volume en 2020. En particulier, la consommation individualisable se replie de 4,9 % : dans la santé, les reports des actes médicaux et des consultations hors Covid-19 dépassent le surcroît de soins, notamment en réanimation, lié à la Covid ; dans l’éducation, l’enseignement reçu par les élèves a décru, du fait d’un plus grand nombre de décrocheurs et de certains cours n’ayant pu être assurés pendant le confinement et, dans le primaire, d’une plus grande part de l’éducation assurée par les parents, donc hors du champ de la comptabilité nationale. La consommation collective diminue de 0,1 %, du fait d’un moindre nombre d‘heures travaillées durant le premier confinement. Ces baisses en volume ne s’accompagnent pas d’une baisse en valeur, mesurée par la somme des coûts (salaires et consommations intermédiaires notamment) en progression de 3,0 %, de sorte que le déflateur de la consommation des administrations publiques augmente nettement (+ 6,4 %).
C’est dans le cas de l’éducation qu’on a débouché sur le résultat qui peut interroger le plus. Ce qui a existé pendant le confinement et à perduré jusqu’à la fin de l’année scolaire est une situation dans laquelle des enseignants télétravailleurs ont co-assuré à distance la formation des élèves avec le concours de parents d’élèves assurant à domicile le suivi des devoirs et des leçons. Dans les comptes, en l’état, ces situations de télétravail sont considérées comme ayant représenté le même volume d’enseignement que si le service avait été rendu en salle de classe. Or on se doute que tel n’a pas été le cas, non seulement en moyenne mais sans doute plus encore en dispersion, car l’école « à la maison » a certainement eu une efficacité très variable selon le milieu social.
3/ La question de frontière de la production
Mais pour certains économistes, il y a aussi le fait que dans le cas de l’éducation on contreviendrait sans le reconnaitre à un des principes de base de la comptabilité nationale, le fait de ne pas compter dans le PIB les services auto-produits par les ménages – services de logement exceptés : préparer soi-même un repas ne fait pas partie du PIB, pas davantage que ne l’est, en temps ordinaire, le fait de devoir encadrer à la maison les devoirs des enfants. Ainsi faire comme s’il y avait eu continuité totale de la production d’enseignement viendrait déroger à ce principe, puisque revenant à inclure implicitement dans le PIB non marchand ce surcroît de production domestique grâce auquel le service global est réputé avoir été maintenu. À l’opposé, le fait que du temps domestique ait été substitué à du travail de restaurateurs pour la préparation de nombreux repas est compté comme baisse de production, même si, au total, on s’est nourri de manière à peu près équivalente ».
Cette incohérence peut paraître secondaire, mais elle offre une nouvelle illustration des paradoxes que peut générer cette notion formelle de « frontière de la production », celle qui distingue la production donnant lieu à rémunération monétaire et les autres formes de production. Cette notion de frontière de la production est à la base du calcul du PIB et elle a été l’objet de nombreux débats ces dernières années, suscités par la multiplication des services numériques gratuits, donc eux-aussi réputés « non-produits » au sens de cette frontière. La crise donne de nouvelles illustrations du caractère parfois arbitraire de cette frontière.
Faut il en conclure qu’il ne peut pas y avoir de définition indiscutable de la valeur mais aussi du volume de la production ? Construire un agrégat de la production, c’est vouloir additionner des nombres de repas au restaurant, des nombres de voitures sortant des chaînes de montage et des nombres d’actes médicaux assurés à l’hôpital ou en ville, ou a minima trouver une façon d’agréger leurs taux de croissance. On sait dénombrer séparément les voitures et les actes médicaux, et il est important de le faire. Mais il y aurait déjà beaucoup de conventions dans le fait d’additionner entre elles des voitures de différents modèles et d’additionner entre eux des actes médicaux de différentes natures. Peut-on dire qu’il y aurait encore plus de conventions à ensuite additionner ces deux catégories de production, tant elles sont irréductibles l’une à l’autre ?
Pour certains économistes de l’Insee, ce que savent bien synthétiser les comptes, ce sont les revenus générés par ces activités ou les coûts qu’elles occasionnent car s’appuyant directement sur une observation aussi exhaustive que possible. Mieux vaudrait mettre l’accent sur le fait que c’est cela qu’on mesure bien, et ce serait bien cela qui, au final, intéresserait le plus le décideur et le citoyen en sortie de crise. Ce n’est pas de savoir combien de coupes de cheveux ou de plats du jour n’auront pas été « produits » en 2020 qui serait le vrai sujet de mesure, encore moins de bien additionner ce qu’ont été ces deux manques-à-produire. La vraie question pour les coiffeurs ou les restaurateurs serait celle des revenus qui leur ont ainsi échappé. On en reviendrait au fait que les chiffres de recul d’activité en 2020 aient finalement été reçus comme plutôt pertinents, à savoir sur les évolutions des revenus des entreprises comme ceux des ménages, et sur la réponse de l’État et des administrations publiques, en moindres recettes ou en surcroît de dépenses, pour compenser ces chutes. C’est ce que les comptables nationaux qualifient de comptes d’agents.
Il reste que ce point de vue ne peut ne pas être partagé par tout le monde. N’est-il pas important que la Chine ait vu son PIB croître en 2020 de 2,3%, que celui des États-Unis ait baissé de – 3,5% et que celui celui de la zone ait encore plus diminué ; – 6,6% dont – 7,9% en France ? Ou que la crise ait surtout affecté la consommation des ménages, en particulier en services ou que la baisse de l’activité économique soit principalement liée à la chute de la consommation privée, conséquence de la crise sanitaire et des mesures prises pour enrayer la progression de la pandémie ?
La France serait l’un des seuls pays au monde, sinon le seul, à estimer le PIB selon l’approche « revenu » (voir page Calcul du PIB dans plusieurs pays). Les revenus ne sont d’ailleurs jamais calculés en volume.
Tous les autres pays estiment le PIB selon les approches « production » et « demande ». Selon les recommandations d’Eurostat, de l’OCDE, et des manuels internationaux (SCN 2008, SEC 2010), ils en déduisent un PIB en volume en déflatant chacune des ses composantes par un indice de prix (méthode de la « double déflation » pour le PIB selon l’approche « production »). La France le fait aussi après calage des PIB de l’approche « production » et « demande » sur le PIB de l’approche « revenu ».
4/ La mesure des indices de prix
a) les soucis de mesure pendant les périodes de confinement
D’abord se pose le problème de collecte : certains prix n’ont plus été observables ou observés, soit parce qu’il s’est agi de biens ou de services qui ont temporairement cessé d’être fournis par le marché, soit parce que, comme on l’a déjà indiqué, même s’ils restaient fournis, le confinement empêchait les enquêteurs-prix d’aller les collecter sur les lieux de vente. Et ensuite un problème plus conceptuel de construction de l’indice : quel poids donner à ces biens dont la consommation a fortement chuté au temps du confinement ou est devenu totalement nulle ?
Les institutions qui sont en charge de la coordination statistique internationale ont répondu à ces interrogations par des directives précises d’Eurostat : (a) collecter tout ce qui peut l’être, en recourant quand on le pouvait à d’autres canaux que le recueil sur place ; (b) lorsque des prix n’étaient pas du tout observables, supposer qu’ils auraient évolué comme ceux des biens les plus comparables ; et (c) conserver les pondérations habituelles. Bien évidemment, on ne calcule pas non plus un indice de prix spécifique pour les dimanches au prétexte que beaucoup de magasins sont fermés ce jour-là et que les biens qu’ils vendent y sont donc temporairement inaccessibles, un tel calcul serait totalement dénué d’intérêt.
Ce qui resterait moins clair va être de savoir quel indice il convient de retenir pour le calcul de ce qu’a été le pouvoir d’achat du revenu de mi-mars à mi-mai. Mesurer le pouvoir d’achat en temps ordinaire c’est calculer comment se dégradent les possibilités d’achat de biens d’un revenu nominal donné sous le seul effet des variations de prix. Quel sens donner à ce concept lorsque les contraintes ne sont pas que de prix ? La question est parfois soulevée de savoir ce que veut dire « pouvoir d’achat » quand il y a des « obligations d’achat » et l’Insee y répond en partie avec les notions de revenu arbitrable et de dépenses pré-engagées. Mais que veut dire symétriquement « pouvoir d’achat » quand il y a des « impossibilités » d’achat ?
La meilleure solution en matière de mesure du niveau de vie serait plutôt le caractère temporaire de l’épisode du confinement. Pendant quelques semaines, les prix de ces biens les avaient rendus temporairement inabordables. Mais il s’agit en bonne partie de biens dont l’achat était reportable dans le temps, les sommes qui y auraient été consacrées en temps normal ont donc été épargnées. La vraie question est celle de la capacité d’achat de cette épargne en sortie de crise, pour des biens qui sont de nouveau disponibles avec des prix qui sont à nouveau mesurables et qui intègrent éventuellement des surcoûts durables induits par la crise que les indices de prix et la comptabilité nationale doivent tenter de cerner au mieux. Si des mesures de protection sanitaire doivent être maintenues plus longtemps et font croître les coûts de production d’une façon qui est in fine répercutée au consommateur, on identifie bien une baisse de pouvoir d’achat. Si la fragmentation mondiale des chaînes de valeur conduit à rapatrier certaines productions au prix d’un renchérissement de ces productions, on aura aussi une répercussion sur les prix au consommateur que les comptes viendront retracer.
b) La mesure de l’inflation pendant la pandémie et au-delà de 2019 à 2021
La crise liée au COVID-19 a compliqué la mesure de l’inflation. Cela tient notamment au fait que l’application, puis la levée des mesures de confinement et de distanciation sociale, a sensiblement modifié la structure de la consommation dans la plupart des économies. Or, l’indice des prix à la consommation (IPC) repose généralement sur des moyennes pondérées des prix de différents biens et services, dont les coefficients de pondération correspondent à leurs parts antérieures dans les dépenses. Si les habitudes de consommation changent de manière soudaine et marquée, ces coefficients de pondération ne sont plus représentatifs de la ventilation la plus récente de ces dépenses, et des écarts peuvent apparaître entre l’inflation calculée avec les pondérations officielles et celle obtenue avec des pondérations « en temps réel ». La probabilité d’écarts importants augmentera si la dispersion des évolutions de prix est forte entre les différentes catégories de biens et de services.
On peut obtenir une estimation indicative de l’ampleur potentielle de ces écarts de mesure pour les États-Unis, le Japon et la zone euro en comparant un IPC contrefactuel (« en temps réel »), calculé en appliquant rétrospectivement les coefficients de pondération connus à un moment ultérieur avec un IPC calculé à l’aide des pondérations officielles. Cet exercice est réalisé pour 2019 (l’année ayant précédé la pandémie), 2020 (où les mesures de confinement ont généralement été les plus strictes) et 2021 (où l’on observe dans une certaine mesure un retour à la normale dans la plupart des économies). En 2020, le poids des catégories de dépenses nécessitant des déplacements ou une proximité physique a nettement diminué alors que la part de l’alimentation et du logement dans le budget des ménages a généralement augmenté. Les pondérations en temps réel pour 2021 ne sont pas encore connues, mais on peut poser diverses hypothèses concernant le rythme auquel et la mesure dans laquelle la structure de la consommation revient à la normale d’avant la pandémie. Un scénario possible est un « retour à la normale » complet de cette structure, de sorte que les coefficients de pondération d’avant la pandémie sont de nouveau valables (tableau suivant). Il s’agit d’une hypothèse forte et simplificatrice, étant donné que la composition des dépenses de consommation en 2021 reste affectée par la pandémie, et qu’un retour complet à la structure observée avant la pandémie pourrait ne jamais avoir lieu.
Conformément à la méthodologie de l’OCDE , les contributions des douze principales catégories de dépenses codifiées à deux chiffres de la COICOP au taux annuel d’inflation globale ont été calculées avec leurs différentes pondérations (graphique suivant)
- Aux États-Unis, l’inflation « en temps réel » a été supérieure au taux d’inflation calculé avec les pondérations officielles ajustées à l’aide de la COICOP depuis le printemps 2020. La pondération des services de transport a reculé en 2020. L’inflation dans ces services ayant été inférieure à la moyenne en 2020, la pondération officielle plus élevée de cette composante s’est traduite par un effet à la baisse plus marqué sur l’inflation agrégée. Inversement, lorsque la hausse des prix des transports s’est accélérée au printemps 2021, la pondération plus élevée correspondant au « retour à la normale » s’est traduite par une contribution plus importante à l’inflation agrégée. La contribution des transports à la différence entre l’inflation contrefactuelle et l’inflation officielle a donc été constamment positive.
- Au Japon, l’inflation « en temps réel » a été systématiquement supérieure au taux d’inflation calculé avec les pondérations officielles ajustées à l’aide de la COICOP, principalement en raison des contributions des « Restaurants et hôtels » à partir de 2020 et des « Communications » à partir d’avril 2021. La pondération des « Restaurants et hôtels » a régressé en 2020 alors que les prix ont baissé en 2020 et se sont redressés au printemps 2021. Dans le cas des « Communications », le recul sensible des tarifs de téléphonie mobile observé en 2021 (dans une large mesure sans lien avec la pandémie) a exercé un effet à la baisse sur l’inflation agrégée qui est plus marqué lorsqu’elle est calculée avec la pondération officielle (qui se rapporte à 2020), plus élevée.
- Dans la zone euro, le taux d’inflation « en temps réel » a été fréquemment plus élevé que le taux d’inflation calculé avec les pondérations officielles, quoiqu’avec des fluctuations. Les pondérations des « Transports » et des « Restaurants et hôtels » ont toutes les deux été moins élevées en 2020. Néanmoins, contrairement à l’évolution observée au Japon, les hausses de prix dans la catégorie « Restaurants et hôtels » constatées en 2020 ont été généralement supérieures à la moyenne, ce qui s’est traduit par une contribution négative à la différence entre l’inflation contrefactuelle et l’inflation calculée à l’aide des pondérations officielles.
Hypothèses concernant les années de base et les pondérations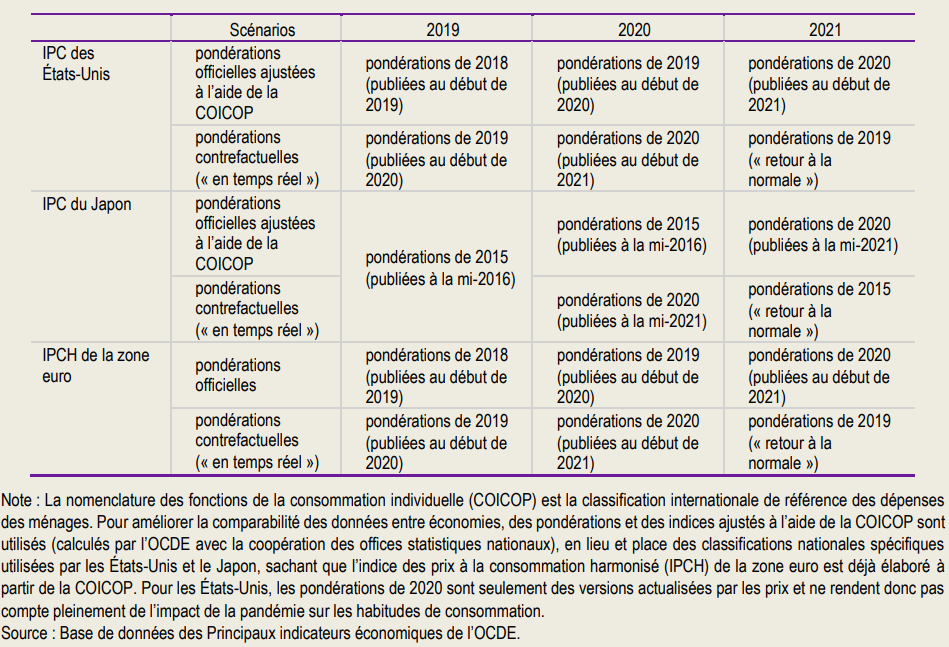
Différences entre les taux annuels d’inflation calculés avec les pondérations contrefactuelles et officielles
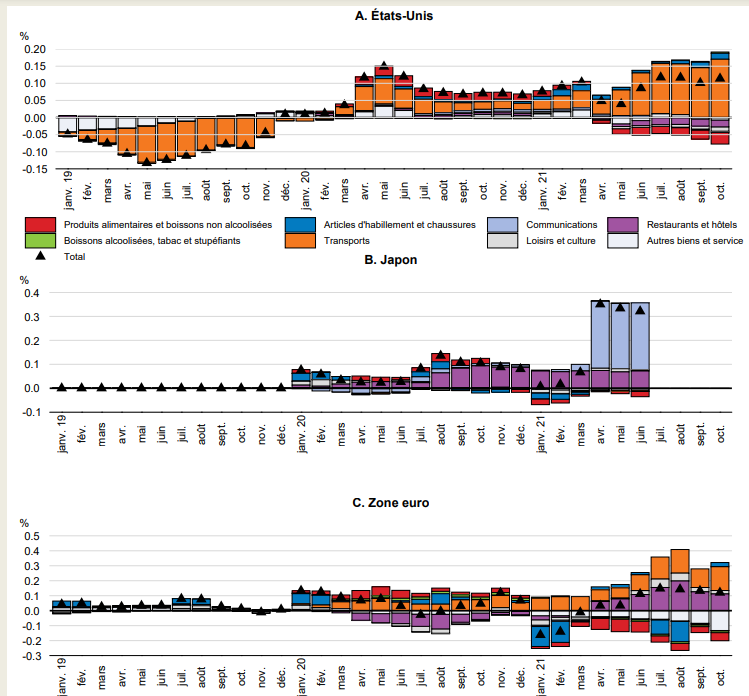
Note : Les barres représentent, pour chaque catégorie à deux chiffres de la nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP), la différence entre la contribution à l’inflation globale annuelle calculée avec les pondérations contrefactuelles et celle calculée avec les pondérations officielles. La catégorie « Autres biens et services » recouvre les composantes « Logement, eau, électricité, gaz, et autres combustibles », « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », « Santé », « Enseignement » et « Biens et services divers ». Les triangles représentent la différence entre les taux d’inflation globale obtenue en agrégeant les contributions de toutes les catégories.
Source : Base de données des Principaux indicateurs économiques de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE.
Globalement, cette analyse effectuée à titre indicatif laisse à penser que des changements marqués de comportement des consommateurs, dont rend compte l’importante évolution des pondérations de dépenses, pourraient se traduire actuellement par une certaine sous-estimation de l’inflation annuelle. Toutefois, l’impact des différentes pondérations de dépenses serait généralement modeste : la limite supérieure de la fourchette dans laquelle s’inscrivent ces effets, reste limitée à environ 0.15 point aux États-Unis, 0.35 point au Japon, et 0.2 point dans la zone euro. Les estimations plus élevées pour les États-Unis proviennent largement de l’utilisation de pondérations actualisées chaque mois au moyen des transactions en cartes de crédit et de débit. Cette méthode rend compte des évolutions exceptionnelles et temporaires des habitudes de consommation au plus fort de la pandémie, mais elle est moins exhaustive que les dépenses de consommation totales des ménages.
Afin d’évaluer la solidité des conclusions ci-dessus, une analyse connexe a été menée à bien à des niveaux plus désagrégés (catégories de dépenses de la COICOP à 3 et à 4 chiffres) pour la zone euro (les données de la COICOP à ce niveau ne sont pas disponibles pour les États-Unis et le Japon). Les différences entre les taux annuels d’inflation calculés « en temps réel » et les pondérations officielles se font considérablement plus volatiles, en partie en raison de la saisonnalité marquée des prix de certaines rubriques dont les pondérations sont très variables comme les forfaits touristiques et les services d’hébergement. Ces facteurs sont agrégés lorsque des pondérations à deux chiffres sont utilisées, ce qui réduit la volatilité globale. Toutefois, en moyenne pour chaque année, la sous-estimation de l’inflation n’est que marginalement plus importante (0.17 point au plus) que celle calculé au niveau à deux chiffres.
La mesure de l’inflation est surtout délicate depuis la mi-2021 et surtout depuis 2022 :+5% par an en mai 2022 en France, +8% en Allemagne. Certes le gaz pèse d’un poids plus important dans ce pays qu’en France tandis que l’offre industrielle, 2 fois plus importante en proportion du PIB, y est freinée par les ruptures des chaînes d’approvisionnement faisant monter les prix. Il reste que la hausse des prix n’est pas simple à mesurer aujourd’hui.
5/ La Balance des Paiements et la crise du Covid en 2020
L’année de la Covid-19 a connu la concomitance de deux perturbations majeures : d’une part une crise économique, avec une dégradation brutale des paiements courants, d’autre part une crise de production statistique, engendrée par la désorganisation des pratiques de travail dans le contexte des confinements et des mesures de protection sanitaire. Or, dans un cas comme dans l’autre, les statistiques de balance des paiements témoignent une fois de plus de leur résilience.
Crise économique, l’année a connu en effet un niveau historique de déficit courant en France (43,7 milliards d’euros, soit 1,9 % du PIB) qui s’explique notamment par la baisse brutale des exportations de deux secteurs phares de l’économie française, l’aéronautique et le tourisme international . Ces dégradations spectaculaires résultaient directement des mesures de confinement et le retour vers les niveaux d’avant-crise est amorcé dès 2021.
Crise de production statistique aussi, mais la Banque de France a assuré malgré tout la continuité de la production statistique et des séries. La dématérialisation des procédures, entamée dès avant la crise de la Covid-19, a constitué l’élément central de résilience lors des épisodes de confinement, tant du côté des statisticiens que des entreprises déclarantes elles-mêmes. Un cas d’adaptation du processus de mesure se distinguait toutefois, celui des statistiques de voyages (tourisme international) : face à l’impossibilité de mener des enquêtes de terrain auprès des voyageurs non-résidents, la Banque de France a approfondi l’usage des données jusqu’alors auxiliaires (cartes de paiement, données de téléphonie mobile…) pour les intégrer directement dans son processus de production .
La crise de 2020 a mis en même temps particulièrement en exergue des défis structurels liés à l’organisation économique contemporaine pour la mesure de la balance des paiements : morcellement des chaînes de valeur à l’échelle mondiale, accélération de la dématérialisation des échanges de services, transnationalisation des flux financiers… Alors même que la fermeture des frontières pour raisons sanitaires a rappelé l’existence de délimitations physiques, la permanence des flux extérieurs témoigne de leur enjambement, illustrant un marché mondial et interconnecté de production et de consommation.
Dans ce contexte ressort particulièrement la dichotomie entre l’armature conceptuelle de la « résidence » en statistiques de balance des paiements et l’affranchissement à un stade avancé des frontières par les entreprises, multinationales en tête, et les ménages. Les possibilités de « télé-consommer » par-delà les frontières via Internet comme de télé-travailler depuis l’étranger ont continué aussi de brouiller les lectures économiques et géographiques traditionnelles de la balance des paiements autant qu’elles posent des défis de mesure. Néanmoins, au-delà des travaux méthodologiques déjà largement entamés pour y remédier, comme face aux différentes formes prises progressivement par la mondialisation, la balance des paiements conservera hic et nunc sa vocation première tant que des devises différentes subsistent, en particulier celle de renseigner la politique monétaire.
IX – CRISES ÉCONOMIQUES ET (/OU) CRISES ÉCOLOGIQUES : QUELLES RÉPONSES ?
Depuis le début du siècle, il y a eu 3 crises économiques : celle de 2007-2009, la crise du Covid de 2020 et la crise énergétique de 2022. À partir de là deux courants de pensée économique coexistent sans vraiment trouver un terrain d’entente. Celui des économistes orthodoxes et celui qui prône aussi des solutions environnementales et humaines aux crises.
La loi sur la réduction de l’inflation de 2022 (Inflation Reduction Act) (IRA) est à la lisière des deux approches. C’est une loi des États-Unis qui vise à freiner l’inflation en réduisant le déficit, en abaissant les prix des médicaments sur ordonnance et en investissant dans la production d’énergie domestique tout en promouvant l’énergie propre. La loi devrait rapporter 737 milliards de $ et autorise 369 milliards de $ de dépenses en énergie pour contrer le changement climatique, 300 milliards de $ en réduction du déficit, trois ans de subventions de la loi sur les soins abordables (Obamacare), une réforme des médicaments sur ordonnance pour faire baisser les prix et une réforme fiscale. La loi représente le plus gros investissement dans la lutte contre le changement climatique dans l’histoire des États-Unis. Selon plusieurs analyses indépendantes, la loi devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 50 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030.
Sur le volet climatique, les ménages américains bénéficient d’un crédit d’impôt de 7.500 dollars pour l’achat de véhicules électriques neufs américains (4.000 dollars pour les véhicules d’occasions). Une aide à l’installation de panneaux solaires est aussi prévue, ainsi qu’un coup de pouce à la rénovation des logements. Du côté des entreprises, le plan prévoit des crédits d’impôts pour les investissements et la production dans les véhicules électriques, dans l’éolien, le solaire, la séquestration du carbone, l’hydrogène vert, les biocarburants, les batteries, etc.
Mais la loi de l’IRA n’oublie pas l’économie américaine par:
- la logique d’acheter américain qui sous-tend certaines des mesures de subventions ;
- les allègements fiscaux pour les entreprises produisant aux États-Unis ;
- les subventions à la production qui pourraient conduire à une course aux subventions.
1/ La solution est économique
Certains économistes orthodoxes pensent que la solution passe par les remèdes classiques ; relance du PIB pour éviter le chômage et faire baisser le ratio de la dette, contrôle des finances publiques (dette, déficit,..) pour rassurer les marchés financiers notamment en France (réforme des retraites,..), etc…
Les pouvoirs publics vont en partie dans ce sens : il faut produire de l’agriculture, de l’industrie, des transports, des services,… quitte à mettre beaucoup d’engrais pour les céréales, fournir l’énergie la moins chère possible aux ménages et aux entreprises, transporter les biens et les personnes, consommer,… . S’agissant des émissions de CO2 on les contrôle comme on peut et on ne faire guère payer les autres dommages environnementaux.
Dans l’urgence, les gouvernements mettent de coté les questions écologiques un peu comme dans le film « les temps modernes » où l’acteur C. Chaplin ne trouve pas le temps de se reposer face à la cadence infernale de la chaîne de montage. Mais on en revient à une question posée dans la page introductive : qu’est ce qui est prioritaire, la dette publique et le PIB ou bien le réchauffement climatique et les autres questions environnementales tels que la sécheresse, une production plus propre, etc… ?
Les lobbies ou même les ménages soutiennent en général ces politiques comme dans l’agriculture ou les transports (révolte des bonnets rouges contre l’écotaxe, limitation de la hausse des prix des carburants en 2022,…). Parfois même, des productions environnementales font des mécontents : Les particuliers ou les pêcheurs de Saint-Brieuc protestent contre l’installation d’éoliennes près de leurs habitations ou en mer.
On remarque toutefois que ces deux objectifs (relance du PIB et contrôle des finances publiques) sont en partie contradictoires, (en partie seulement car une forte hausse du PIB réduit nécessairement les ratios déficit (ou dette) public par rapport au PIB. On s’en rend compte au vue de la politique plutôt déflationniste en Europe après la crise des subprimes. Le déficit public en % du PIB n’a guère progressé jusqu’en 2019 contrairement aux États-Unis, qui disposent, il est vrai de la planche à billet.
Du coup, la croissance américaine est beaucoup plus forte que dans la zone Euro entre 2009 et 2015 comme déjà dit (graphique suivant). Dans cette dernière, le déficit public en % du PIB est très faible en 2007 comme en 2019 (-0,6%). Aux États-Unis, ces ratios sont respectivement de – 4% et – 6,7% (tableau suivant). Entre les deux, la croissance diverge après la crise de 2009 surtout jusqu’en 2013. Crise de la dette publique en Grèce en 2011, mais aussi récession économique de l’Irlande, et dans une moindre mesure de grands pays comme l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni voire la France, jalonnent la période 2009-2013. L’objectif prioritaire de la politique économique, sous la houlette de la Banque Centrale Européenne, est de respecter les équilibres financiers quitte à délaisser des services publics (fermeture de lits d’hôpitaux, désert médical français, etc….)
Niveau d’activité économique (PIB) volumes chaînés (2010), millions d’euros, base 100 en 2004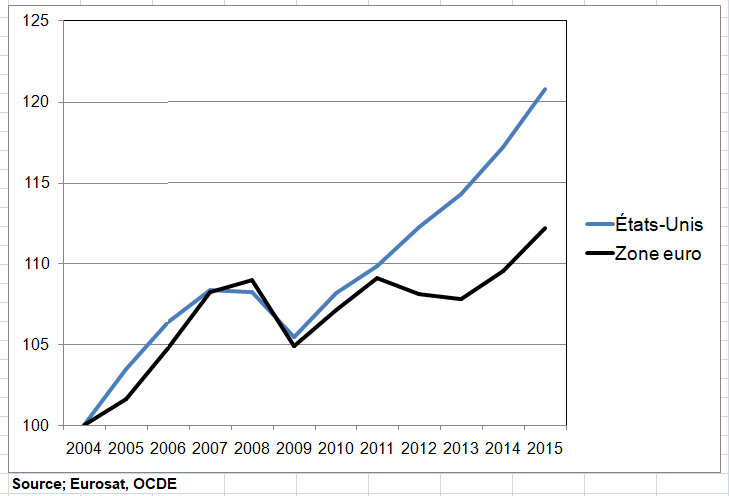
Capacité/besoin de financement des pays occidentaux des administrations publiques en % du PIB
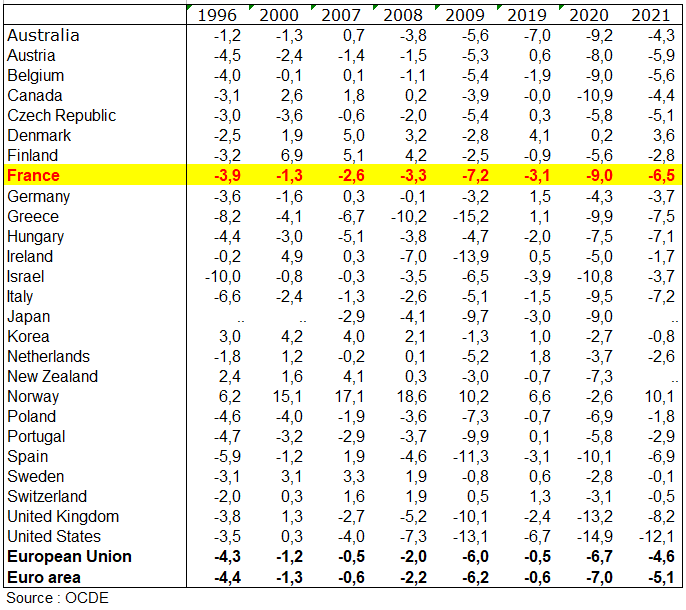
On donne ici quelques exemples de la priorité (force) accordée à ces questions économiques.
a) L’importance du pétrole en Europe
Malgré une production en baisse et une consommation fluctuante au fil des ans, le pétrole brut et ses produits dérivés jouent toujours un rôle majeur. Ces derniers temps, de nombreuses politiques de l’UE commencent à affecter ce vaste domaine du marché de l’énergie, un domaine qui en 2021 a enregistré une certaine normalisation après avoir été fortement choqué en 2020 par l’impact soudain des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine et les décisions politiques suivantes de l’UE seront reflétées dans les données de 2022.
La dépendance à l’importation sur le pétrole est calculé comme le rapport des importations nettes (importations moins exportations) à l’énergie disponible brute de pétrole brut et de produits pétroliers. Les valeurs positives indiquent une dépendance aux importations, tandis que les valeurs négatives indiquent un pays exportateur net. Si les valeurs positives sont supérieures à 100 %, cela signifie que les importations dépassent les besoins d’un pays et que, par conséquent, des stocks se constituent. La dépendance à l’égard des importations pour l’ensemble du pétrole brut et des produits pétroliers a atteint un niveau record en 2020 lorsque l’UE dépendait des importations nettes pour 96,96 % de sa disponibilité énergétique, mais est tombée à 91,67 % en 2021, marquant la valeur la plus faible en 22 ans. La dépendance vis-à-vis du pétrole étranger s’est accrue à partir des taux plus faibles observés au cours des décennies précédentes et d’un minimum observé en 1999 (91,66 %).
Le taux de dépendance à l’égard des importations de pétrole brut, un produit essentiel pour l’industrie pétrochimique et la production de carburants de transport, était toujours le plus élevé de tous les principaux produits énergétiques (fossiles et non fossiles), mais en 2021, il a encore diminué à 95,09 % par rapport à la valeur la plus élevée. jamais enregistré (96,76 %) en 2019.
Dépendance aux importations, pétrole brut et pétrole total, 1990-2021 (% des importations nettes par rapport à l’énergie brute disponible)
En 2021, la consommation finale de pétrole et de produits pétroliers à des fins énergétiques et non énergétiques dans les États membres de l’UE a augmenté de 4,4 % pour atteindre 400,6 Mtep, par rapport au niveau le plus bas jamais enregistré au cours de la série chronologique de 31 ans en 2020, qui était due au restrictions du Covid 19. La consommation avait déjà diminué du pic de 2001 (499 Mtep) à un point bas en 2014 (409 Mtep) mais, avant le choc des restrictions, elle repartait à la hausse. En 2021, la valeur a commencé à se normaliser globalement mais avec des changements dans des directions différentes dans les différents États membres. La consommation a augmenté de manière plus marquée en Italie (+14,6 pp), en Espagne (+11,6 pp) et en Tchéquie (+11,0 pp) tandis qu’elle a diminué de manière plus évidente en Finlande (-11,3 pp), en Allemagne (-3,9 pp) et en Estonie (-3,2 pp ). En 2021, l’Allemagne était en tête avec une part de 20,75 % de la consommation finale totale de l’UE, suivie de la France (15,8 %), de l’Italie (10,8 %) et de l’Espagne (10,3 %).
Consommation de pétrole et de produits pétroliers, 2021, (millions de tonnes d’équivalent pétrole)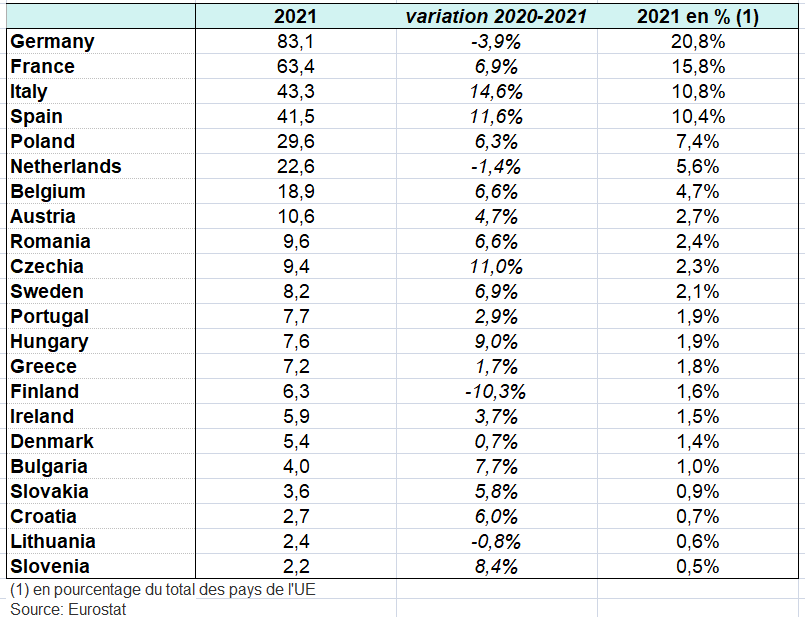
Dans l’UE, la consommation finale d’énergie de pétrole et de produits pétroliers (hors transport maritime international et aviation) s’est partiellement redressée en 2021 après la chute enregistrée en 2020 lorsque les combustibles fossiles de transport avaient clairement été touchés par les limitations des déplacements des personnes . Le gazole/diesel a augmenté depuis la valeur la plus basse du début de la série chronologique (193,0 Mtep) en 1990, jusqu’à son plus haut sommet en 2006 (254,4 Mtep). Récemment, elle regagnait du terrain après avoir chuté à 228,0 Mtep en 2014. En 2020, elle est cependant tombée à 217,8 Mtep, mais a augmenté de 4,7 % pour atteindre 227,9 Mtep en 2021. La consommation d’essence avait considérablement diminué par rapport au sommet de 1998 (115,5 Mtep) à sa valeur précédemment la plus basse en 2017 (66,0 Mtep) et a lentement augmenté ces dernières années. En 2021, elle a augmenté de 9,3 % pour atteindre 63. 6 Mtep, après avoir marqué un plus bas record en 2020 (58,2 Mtep). Le gaz/diesel et l’essence sont de loin les deux produits les plus importants sur l’ensemble de la période de 31 ans, mais d’autres produits ont montré des changements pertinents en 2021.
Consommation énergétique finale des produits pétroliers, UE, 1990-2021, (millions de tonnes d’équivalent pétrole)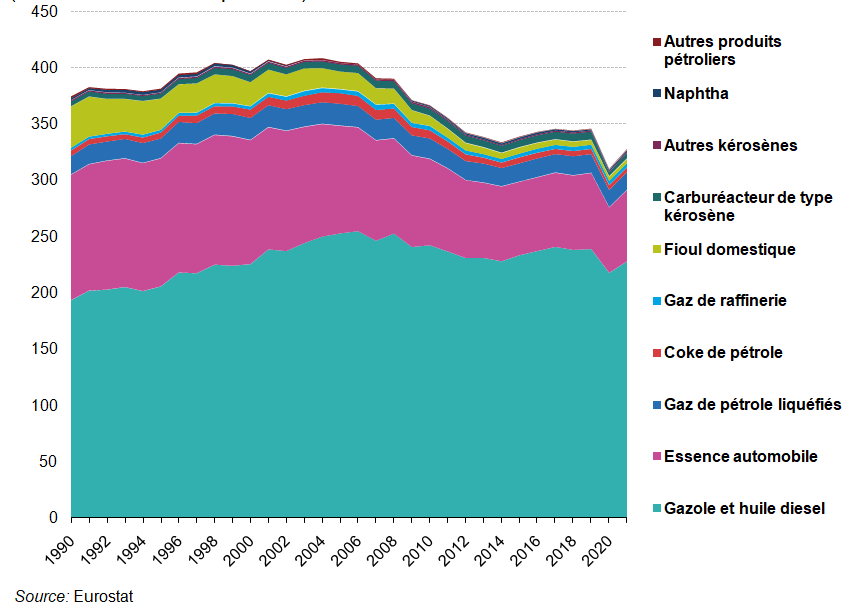
Le graphique suivant se passe presque de tout commentaire. Les transports intérieurs et internationaux étaient de loin les plus gros utilisateurs avec un total de 63,3 % de la consommation totale. Le transport routier était un consommateur clé avec 48,7 %, tandis que le transport aérien et maritime en utilisait 9. 1 % et 5,2 % respectivement. L’industrie était le deuxième secteur avec une part de 20,3 % qui comprend les consommations non énergétiques (15,5 %) telles que le bitume pour les revêtements routiers, l’utilisation de lubrifiants pour réduire les frottements ainsi que l’utilisation de produits pétroliers dans l’industrie pétrochimique pour leurs propriétés chimiques. plutôt que pour leur contenu énergétique. Dans ces cas, ils sont transformés en d’autres produits (comme les plastiques, les détergents et les pneus par exemple) plutôt que brûlés pour produire de l’énergie. Les ménages et le secteur de l’énergie avaient respectivement des parts de 5,1 % et 4,9 %. Les services, tant commerciaux que publics, ont utilisé environ 2,2 %, tandis que d’autres secteurs, dont l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ont consommé environ 3,8 % du total)
Consommation de pétrole par secteur, UE, 2021, (%)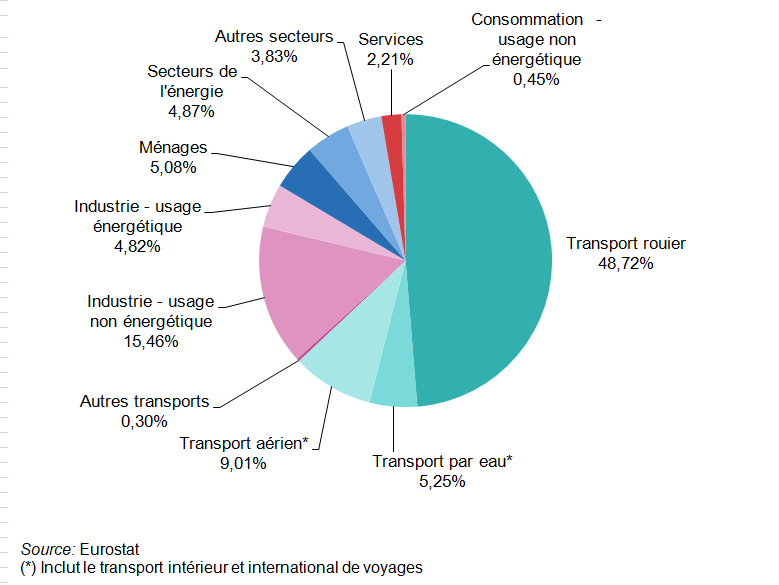
Au vue de ces chiffres, comment s’étonner du sérieux revers pour l’Union européenne en matière de transition énergétique. Premier mode de déplacement des Européens, l’automobile représente un peu moins de 15% des émissions de CO2 du continent (voir page Marges de transport). En raison de l’abstention de l’Allemagne, les États membres n’ont pas voté l’interdiction de la ventes des voitures à moteur thermique en 2035. L’Italie avait annoncé de longue date don opposition au texte. La Pologne voulait, elle aussi, se prononcer contre et la Bulgarie souhaitait s’abstenir. Ces pays, à eux trois, n’ont pas les moyens de bloquer la procédure. Mais avec l’Allemagne, la majorité qualifiée des Vingt-Sept qui est requise (vote favorable d’au moins 55% des États représentant au moins 65% de la population de l’UE) n’était plus atteinte.
Le texte d’octobre 2022 prévoyait pourtant de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035. Ce qui revient à l’arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans l’UE à cette date, ainsi que des hybrides (essence-électrique), au profit de véhicules 100% électriques. Il s’agissait du premier accord sur un texte du paquet climat européen (« Fit for 55 ») destiné à réduire d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Il entérinait l’objectif de réduction des émissions de CO2 pour 2030 de -55% pour les nouvelles voitures et -50% pour les nouvelles camionnettes, par rapport à 2021.
L’industrie automobile européenne s’était dite « prête à relever le défi » après cette « décision sans précédent » tout en réclamant à l’UE la mise en place des « conditions » nécessaires pour remplir cet objectif, notamment le développement d’un réseau suffisant de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les besoins étaient nombreux : « Une abondance d’énergies renouvelables, un réseau continu d’infrastructures de recharge privées et publiques, et l’accès aux matières premières ». Les constructeurs s’inquiétaient notamment de voir « le prix des batteries augmenter pour la première fois en plus d’une décennie » mais surtout du coût de ces véhicules électriques, à savoir en moyenne « près de 30.000 euros. ».
b) Le respect des grands équilibres financiers
À la fin mars, les INS des pays de la Zone Euro publient leurs premières estimations des comptes publics de l’année précédente. C’est un moment crucial et très attendu par la presse, presque bien plus important que le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique publié quelques jours plutôt.
Les finances publiques s’assainissent lentement mais sûrement. Selon les chiffres publiées par L’Insee, le mardi 28 mars 2023, la dette publique s’est résorbée à 111,6% du produit intérieur brut en 2022, ne dépassant pas le seuil de 3.000 milliards d’euros, et le déficit public s’est aussi contracté pour atteindre 4,7% du PIB après 6,5 % en 2021 et 9,0 % en 2020. . Il s’agit d’un résultat bien meilleur que celui fixé par le gouvernement qui tablait sur 5% de déficit.
Plus précisément, le déficit public pour 2022 s’établit à 124,9 Md€, Les recettes restent très dynamiques en 2022 et progressent en valeur de 95,7 Md€, soit +7,3 % après +8,4 % en 2021. En proportion du PIB, elles atteignent 53,4 %, après 52,6 % en 2021 et 52,4 % en 2020. Le taux de prélèvements obligatoires augmente, à 45,3 % après 44,3 % en 2021. Les dépenses progressent à un rythme similaire à celui de 2021 : +4,0 %, soit une augmentation de 58,6 Md€. En proportion du PIB, les dépenses continuent de reculer et représentent 58,1 % du PIB en 2022, après 59,1 % en 2021 et 61,3 % en 2020. Elles restent cependant très supérieures à leur niveau de 2019. La dette des administrations publiques au sens de Maastricht atteint 111,6 % du PIB fin 2022, après 112,9 % fin 2021.
Peu après la publication de ces chiffres, le ministre de l’Économie et des Finances a déclaré que « La résilience de notre économie nous permet de réduire le niveau de dette publique à 111,6% du PIB et de respecter notre objectif de finances publiques », avec un déficit à 4,7%, a déclaré le ministre en réaffirmant sa « détermination » à rétablir les comptes publics
La Cour des comptes avait sonné l’alarme début mars, s’inquiétant de la lenteur du gouvernement à rétablir les finances publiques. Elle avait estimé que le déficit se résorberait trop tardivement, ne passant sous la limite européenne des 3% du PIB qu’en 2027, tandis que la dette resterait peu ou prou à son niveau actuel, à 110,9%. La Cour des Comptes avait même pointé le risque que celle-ci se creuse.
Il est vrai que avec la remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne, passés de négatifs au printemps 2022 à une échelle entre 3 et 3,75% en mars 2023,le financement de la dette des Etats européens va coûter beaucoup plus cher à l’avenir. Les taux d’intérêt auxquels l’État emprunte sur les marchés sont fortement remontés avec l’inflation. Pour ne rien arranger, un dixième de la dette française est indexé sur l’inflation, ce qui alourdit d’autant son coût. La charge des emprunts publics s’est accrue de 13 milliards d’euros en un an, à plus de 51 milliards en 2022, alors que les taux des obligations françaises à 10 ans ont brutalement rebondi autour de 3% après des années de taux très bas voire négatifs.
« On assume qu’il faut rétablir nos finances publiques et on assume de ne pas le faire de manière brutale », avait rétorqué le ministre chargé des Comptes publics, ce qui donnerait « plus de chômage, plus d’impôts et plus de dette ». Pour ce faire, le gouvernement prévoit de présenter vers la mi-avril son nouveau programme de stabilité fixant la trajectoire des finances publiques pour les prochaines années. Il mise principalement sur une hausse du PIB plus rapide que celle des dépenses, qui feraient l’objet de « plusieurs milliards d’euros d’économies ». La croissance est anticipée par l’exécutif à 1% en 2023.
2/ La solution est économique mais aussi (surtout ?) écologique
Et puis il y a un a autre monde d’économistes bien différent du précédent. Nombre d’entre eux proposent des solutions qui ne passent pas que par l’économie car ces crises ont une dimension environnementale.
La pandémie se révèle intimement liée à la crise environnementale : la destruction des écosystèmes, la multiplication des élevages intensifs ou encore le trafic illégal d’espèces favorisent en effet l’apparition et la diffusion de tels virus. Résultat ? L’économie pâtit rudement du virus au même titre que la société toute entière.
La pandémie et ses conséquences sur nos modes de vie ont libéré la parole des penseurs critiques sur le capitalisme mondialisé. Ils ont considéré cette crise comme une mise en évidence des failles profondes inhérentes à une économie essentiellement fondée sur le référentiel du marché. Nous serions ainsi, entré dans une crise écologique et sociale sans précédent historique, pouvant aller jusqu’à un « effondrement » humain mondial. Mais la prise de conscience tarde, parce que les manifestations de cette crise restent limitées, surtout pour les catégories dominantes et dans les pays riches. Mais aussi parce que les solutions, qui existent, heurtent de front les intérêts privés à court terme. L’économie écologique en est à ses débuts, et elle est peu connue des économistes. Il est difficile de penser une économie écologique et sociale compte tenu de la nécessité de se projeter bien au-delà du « long terme » des économistes pour intégrer une prospective écologique et humaine sur un siècle au moins. Compte tenu aussi de la nécessité d’intégrer les apports de multiples disciplines jusqu’ici ignorées par la plupart des économistes : climatologie, agronomie, sciences de la nature et de la vie en général… à côté des autres sciences sociales.
Au lendemain de cette crise, ce serait probablement une erreur de repartir chacun dans son coin, notamment au niveau mondial, comme si rien ne s’était produit et de s’attacher uniquement à rafistoler le monde économique et financier. Loin des replis nationalistes et de la tentation autoritaire, la coopération s’est avérée vitale à l’échelle européenne. Travailler entre États pour combattre le coronavirus mais aussi pour lutter contre ses causes et ses conséquences assure plus d’efficacité, d’autant plus que les pandémies futures – tout comme les pollutions, le dérèglement climatique ou encore la crise de la biodiversité – ne connaissent pas les frontières. Mais préférer la coopération à la compétition, de l’échelle individuelle à l’échelle internationale, n’est pas facile à mettre en place.
Si les crises sanitaires, environnementales, sociales et économiques ont chacune leurs spécificités, elles sont souvent interdépendantes : mettre en cohérence les réponses qu’on y apporte serait l’assurance de les traiter durablement. C’est par exemple envisager une relance économique qui protège les conditions de travail et favorise le développement d’un tissu économique local, créant des emplois pérennes et respectueux des limites naturelles. C’est assortir la mise en place d’aides aux entreprises à des conditions et objectifs environnementaux et sociaux. C’est favoriser le développement de l’agroécologie, des énergies renouvelables, de la réduction des déchets, des PME et de l’artisanat pour permettre la résilience durable des territoires tout comme leurs transitions écologiques. Pour ce travail, il sera nécessaire de mettre en place une gouvernance efficace pour s’assurer pendant de nombreuses années de la bonne utilisation des flux financiers qui vont être débloqués.
a) Un changement de paradigme
1 – Les enjeux environnementaux ne cessent de remettre en cause notre manière d’évaluer nos pratiques
Dès qu’on s’intéresse à la manière dont une pratique donnée pourrait ou devrait changer, pour tenir compte des défis environnementaux, on se heurte pratiquement systématiquement au fait que la pratique existante est soutenue par tout un réseau de mesures et d’autres pratiques qui la légitiment. Voici quelques exemples :
- Utiliser une bicyclette pour aller quelque part est, presque toujours, moins rapide et moins pratique que de prendre sa voiture. Pour que cela redevienne facile d’usage il faut organiser toute une série de choses différemment (comment s’habiller, comment faire des courses, comment pédaler sans se fatiguer, comment enchaîner ses activités, etc.). Et la tension sur le temps qui conduit à prendre sa voiture fait partie du problème. Est-il intelligent d’aller à la salle de sport en descendant de sa voiture ?
- essayer d’utiliser moins souvent sa voiture conduit à s’organiser de manière complètement différente. Soit on organise un co-voiturage, soit on chaîne train et voiture de location, soit on fait un trajet différent. Cela revient souvent moins cher que d’utiliser sa propre voiture (ou d’être seul dedans), à condition que l’on ait une exacte représentation de ce que coûte une voiture. Beaucoup de personnes oublient le prix d’achat, d’entretien et d’assurance d’une voiture quand ils calculent le prix d’un déplacement. Seul le prix du carburant est visible. Par ailleurs, l’aménagement des périphéries urbaines a été conçu en partant de l’hypothèse que tout le monde utilisait une voiture individuelle. Dans un premier temps il est donc « plus compliqué » de penser et d’agir différemment.
2 – L’usage des pesticides, un cas d’école
Le débat sur les pesticides est tout à fait typique, à ce propos. Ceux qui en défendent l’usage disent qu’il n’y a pas d’autre alternative ou que c’est une source d’économie importante. En face, ceux qui veulent les interdire parlent des risques en terme de santé publique et d’épuisement progressif des sols. En fait, des alternatives à la plupart des pesticides existent. Mais tout dépend du référentiel que l’on utilise pour prendre ses décisions.
On est dans un domaine où, typiquement, les faits dissonants se multiplient. Mais ils n’ont pas encore conduit à un changement de paradigme.
Commentant brièvement l’échec des plans Écophyto (censés réduire l’usage des pesticides et qui n’ont pas réussi à enrayer l’augmentation de cet usage) la Cour des comptes a souligné, récemment, un état de fait qui montre bien ce qui se passe quand les faits dissonants prolifèrent « Le nombre et la diversité des acteurs impliqués, l’insuffisante articulation du planÉcophyto avec plus d’une dizaine d’autres instruments de programmation portant des mesures relatives aux pesticides, , la diversité des sources de financement et la généralisation des co-financements ou appels à projets ont conduit à développer une gestion administrative et financière si complexe qu’elle peut neutraliser les effets de l’impulsion nationale et, plus récemment, des initiatives régionales. Pour éviter les incohérences et la dispersion des initiatives et des moyens, et permettre à l’ensemble des acteurs de rendre pleinement compte de leurs actions, la Cour relève avec intérêt la nomination d’un coordinateur interministériel. Mais elle recommande également de mettre rapidement en place, comme l’État s’y est engagé, un tableau de bord exhaustif et public des actions et crédits nationaux et régionaux venant au soutien de cette politique. Elle invite aussi à développer un cadre pluriannuel de programmation des financements et à simplifier les processus annuels d’allocation des ressources afin que les acteurs disposent de davantage de visibilité. Enfin, elle recommande de rendre plus lisible, pour les exploitants et pour l’ensemble des citoyens, un dispositif de contrôle reposant, à ce jour, sur au moins sept services différents»
Ainsi, on essaye d’agir à droite et à gauche. La multiplication des appels à projets montre, par ailleurs, que les acteurs publics considèrent encore que l’on se situe dans le cadre de projets expérimentaux : une agriculture économe en pesticides n’est pas la politique centrale mise en œuvre : cela reste l’affaire d’acteurs motivés qui vont à contre-courant. Pour l’instant, l’agriculture normale continue à s’adosser à ses outils de mesure standards. Et une multitude d’acteurs raisonnent avec ces outils-là, aussi bien dans le public que dans le privé.
b) L’économie verte : un changement de paradigme technico-économique
Le développement d’une économie verte passe par l’émergence d’un nouveau paradigme technico-économique. Ce type de paradigme peut être défini comme un environnement relativement stable qui favorise le déploiement d’une technologie à grande échelle, menant à une période de croissance.
Pour qu’un changement de paradigme s’impose, une révolution technologique est une condition nécessaire, mais pas suffisante : l’exemple des pesticides montre qu’il faut un cadre institutionnel favorable à la diffusion des nouvelles technologies. Cela passe par des changements qui amènent les entreprises à modifier leurs paramètres de décision pour que ceux-ci soient davantage en adéquation avec le nouveau paradigme.
Un changement de paradigme n’est pas simple, puisqu’il implique des changements institutionnels profonds qui passent, notamment, par l’adoption de mesures qui favorisent certaines technologies au détriment des autres. Du même coup, on modifie la valorisation des compétences en favorisant les connaissances et les compétences rattachées au nouveau paradigme. On pourrait donc valoriser, par exemple, les compétences rattachées à la filière des batteries électriques, au détriment de celles rattachées à l’extraction du pétrole.
Considérant que ces changements risquent d’entraîner de la résistance de la part des entreprises, voire des employés ou de la société civile en raison de ses effets destructeurs pour certains secteurs d’activité, des conditions favorables à l’adoption des nouvelles mesures sont nécessaires pour espérer un changement durable. C’est ce qu’on appelle une fenêtre d’opportunité.
c) Une crise peut créer des opportunités
Les crises économiques représentent une bonne fenêtre d’opportunité, puisqu’elles amènent de l’incertitude. Et cette incertitude ouvre la porte à différentes interprétations sur les actions à entreprendre afin de renouveler avec la croissance. Ces circonstances, bien que temporaires, sont favorables au changement.
Lors d’une crise économique, deux effets sont possibles.
- D’une part, une crise peut avoir un effet positif, où elle sert de catalyseur à la transition.
- D’autre part, la crise peut affaiblir l’attention du public, de la classe politique et du milieu des affaires aux problèmes environnementaux.
L’effet positif de la crise vient du fait qu’elle ouvre la porte au développement de solutions conjointes, permettant de résoudre à la fois des problèmes liés à la crise économique et des problèmes liés à la crise environnementale. La façon dont on tente de sortir de la crise peut soit amplifier les risques environnementaux, soit les réduire.
Bien qu’une crise crée un contexte favorable à une transition, toutes les crises ne mènent pas à un changement de paradigme. Alors que la crise financière de 2009 a été initialement favorable au développement d’une économie verte, la fenêtre d’opportunité s’est rapidement refermée lorsque l’attention du public s’est détournée des changements climatiques pour se concentrer sur des préoccupations davantage économiques.
d) Des préoccupations environnementales
Le contexte actuel est nouveau. Premièrement, les conséquences de la crise environnementale sont de plus en plus alarmantes et les appels à l’action sont de plus en plus nombreux et diversifiés. On observe donc un fort appui pour des mesures favorisant l’adoption de technologies davantage soucieuses de l’environnement.
Deuxièmement, en faisant la promotion de technologies vertes qui diminuent la consommation d’énergies fossiles, on vient à la fois répondre à la crise inflationniste et la crise environnementale. La crise actuelle de 2022 étant en partie causée par l’augmentation des prix du pétrole et du gaz causée par le conflit ukrainien, une transition énergétique s’appuyant sur l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables permettrait de diminuer à la fois la consommation et la dépendance aux énergies fossiles, en plus de favoriser des filières en développement, telles que celle des véhicules électriques.
Avec le nombre grandissant de pays et d’entreprises ayant des cibles de zéro émission nette, on transite actuellement vers un nouveau paradigme à l’échelle mondiale.. Une transition précoce offre à la fois des bénéfices environnementaux et économiques, qui échapperont aux nations qui s’enferment dans des technologies conventionnelles.
La crise inflationniste actuelle offre une opportunité d’accélérer la transition. Pour que le changement s’opère avec succès, il faudrait un régime d’éco-fiscalité efficace, autant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, afin que les paramètres d’investissements favorisent davantage les technologies vertes. Cela passe par des subventions, mais également par le retrait de subventions à des industries polluantes, et l’élaboration d’un régime fiscal favorisant le déploiement de technologies vertes à grande échelle.
X – COMMENT INTÉGRER L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE À LA COMPTABILITÉ NATIONALE ?
Pour nombre d ‘économistes (parmi les lesquels J. Stiglitz,D. Blanchet, J. Gadrey, …. ), les défis posés par les crises de 2009, 2020 et 2022 ne sont pas seulement économiques mais ont une dimension humaine et environnementale [10].
La comptabilité actuelle est le résultat d’une histoire et elle s’inscrit dans un contexte donné qui façonne considérablement les choix qui la sous-tendent parmi lesquels on peut citer : la vision de la richesse d’une nation correspondant à ce qui est produit et donc à un flux, sans prise en compte de ce qui est détérioré ou détruit pour le produire ; l’enregistrement des opérations sous la seule forme d’une valeur monétaire ce qui implique de monétiser ce que l’on veut valoriser (pas le travail domestique notamment). Ces conventions circonscrivent à ce titre ce que nous mettons sous les notions de valeur (ajoutée), de richesse, de performances d’une nation.
On a vu auparavant les limites de ce système et les impasses du mode de calcul du PIB pour mesurer la richesse d’un pays. L’adoption de la loi Sas en 2015 visait justement à mieux mesurer et rendre compte de la trajectoire de croissance de la France, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale via un tableau de bord de dix « nouveaux indicateurs de richesse » (NIR) qui devaient également intervenir en amont de la définition des politiques publiques. Force est de constater que ces indicateurs restent des « à-côté », sans effet notable sur la manière de piloter et d’élaborer des politiques publiques et que le PIB reste le seul étalon de mesure comptable de notre activité et de notre richesse.
Mais on a vu aussi que la le rapport de la Commission Stiglitz-Zen-Firoussi s’est efforcé de proposer des indicateurs synthétiques de bien-être plus appropriés que le PIB, ainsi que des tableaux de bord visant à appréhender performance économique et qualité de la vie à travers leurs différentes facettes. Tout en précisant que d’autres d’autres indicateurs monétaires issus de la comptabilité nationale que le PIB peuvent lui être préférés pour mesurer le bien-être, en particulier les comptes des ménages par catégories de revenus, le rapport ne prend pas vraiment position sur l’introduction des dommages environnementaux et sociaux au cadre central. De nombreux aspects du bien-être restent difficiles ou impossibles à mesurer en unités monétaires et une place importante doit être faite à des indicateurs plus qualitatifs. Parmi ces indicateurs non monétaires, certains restent de type objectif – par exemple l’espérance de vie –, mais le rapport préconisait aussi qu’une place soit faite à des indicateurs subjectifs, c’est à dire la qualité de la vie ressentie par les agents.
La crise du coronavirus renouvelle et réinterroge la manière de compter ce qui compte : la valorisation des services marchands et non marchands perçus dans la crise comme essentiels et dont l’utilité sociale est apparue comme largement déconnectée de leur rémunération. Comment évaluer autrement que par des coûts la valeur ajoutée de ces services ? Comment faire évoluer notre conception de ce qui a de la valeur et de ce qui contribue à notre bien-être ?
Les externalités environnementales deviennent le cœur de l’économie écologique, alors que, comme leur nom l’indique, elles étaient à la périphérie de l’économie a-écologique, de fait anti-écologique. Il faudrait internaliser les externalités non seulement dans l’évaluation des performances et des coûts, mais aussi en allant jusqu’à les considérer théoriquement comme associées à des biens communs aussi vitaux que les « internalités » que sont les produits et services de type final dont elles dérivent. Quand les dommages collatéraux à terme peuvent devenir plus importants que les bénéfices (en bien-être à court terme) retirés des productions, l’analyse des premiers compte autant que celle des secondes.
1/ le calcul socio-économique, pour évaluer tous les grands projets d’investissements publics
L’évaluation socioéconomique est fondée sur un bilan exprimé en euros qui mobilise les résultats des autres formes d’évaluation (prévisions de trafic ou de fréquentation, impact environnemental…) et valorise les effets du projet en termes de coûts et d’avantages monétarisés pour la collectivité. Cette approche en termes de coût-bénéfice permet donc de mettre en lumière des effets indirects et multidimensionnels d’un projet d’investissement et elle doit permettre à ce titre aux décideurs publics de faire des arbitrages éclairés. Les questions méthodologiques sont ici d’une grande complexité, tant pour circonscrire les effets à évaluer, notamment dans le temps, que pour être capable de les anticiper, les mesurer et les traduire en euros.
Quelles dimensions des soutenabilités sont aujourd’hui intégrées dans le calcul socioéconomique et sur quels critères/indicateurs sont-elles évaluées ? Est-ce qu’il y a aujourd’hui des dimensions que l’on ne sait pas intégrer ? Comment sont effectués les arbitrages entre différents effets d’un investissement qui peuvent être positifs sur certaines dimensions et négatifs sur d’autres ? Dans quelle mesure le calcul socio-économique permet-il de fonder la décision publique, alors même que certains objectifs (sauver la vie humaine, réduire les émissions de CO2) apparaissent aujourd’hui absolus, « quoi qu’il en coûte » ? Comment intégrer le principe de précaution dans ces évaluations socioéconomiques ?
2/ Comment la comptabilité d’une entreprise peut-elle intégrer dans le bilan et le compte de résultats la dégradation des ressources naturelles et humaines induite par ses activités ?
Le modèle CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology), initié par J. Richard propose une vision systémique de la comptabilité d’entreprise intégrant, à côté du capital financier, tous les capitaux extra-financiers que les enjeux de durabilité obligent à maintenir. Cette comptabilité qualifiée de multi-capitaux repose sur 3 principes :
- une prise en compte des questions sociales et environnementales dans le bilan et le compte de résultat (principe d’intégration comptable) ;
- une extension des principes de protection du capital financier aux « capitaux » naturels et sociaux (symétrie de traitement des enjeux financiers et extra-financiers) ;
- une extension de la solvabilité financière à la « solvabilité environnementale » et à la « solvabilité sociale » (respect d’obligations de préservations financières et extra-financières).
Dans ce contexte, les questions sociales et environnementales :
- sont traitées par la conservation (le maintien) des « entités » « capitales » à préserver (climat, biodiversité, sols, êtres humains employés, etc.). Chacune de ces entités est un « capital » (naturel ou social) spécifique (une entité « capitale » à préserver) ;
- se traduisent dans le bilan et le compte de résultat par la reconnaissance de passifs sociaux et environnementaux (dettes).
En conséquence, les capitaux naturels et sociaux, conçus comme des passifs, sont évalués à leurs coûts de préservation (coûts de prévention ou de restauration – et non de compensation).
En résumé, le modèle CARE a pour objectif de traduire une sorte de dette envers les écosystèmes et les individus, que l’entreprise va piloter dans le temps afin de s’assurer d’une performance globale durable, et de définir un profit « durable« , qui n’est pas obtenu au détriment des écosystèmes et des individus (c’est-à-dire qui ne repose sur un accroissement permanent de dettes sociales et naturelles ignorées) (voir page Compte Environnement). .
3/ Mais surtout comment intégrer les enjeux de soutenabilité à la comptabilité nationale ?
La crise de 2020 incite à mieux prendre en compte les interactions entre l’humanité et la nature pour limiter, anticiper et gérer les risques sanitaires. Comment faire évoluer les outils comptables pour mieux « ré-encastrer l’économie » dans son environnement ? Comment intégrer dans la mesure de notre performance notre dépendance à l’égard de ressources finies ou non renouvelables, qu’elles soient environnementales ou humaines ?
Intégrer dans la comptabilité nationale le « capital naturel » et le bien être humain ouvre de redoutables questions méthodologiques et éthiques, tant sur leur mesure que sur leur valorisation et leur agrégation. Comment définir les éléments du capital naturel qui importent, le capital naturel critique, qui sera transmis aux générations futures ? Comment reconnaître la valeur de tout ce qui contribue à dégrader notre bien-être ? Comment intégrer dans la comptabilité la finitude de certaines ressources pour évaluer la capacité de notre modèle de développement à se maintenir dans le temps ?
Les épineuses questions méthodologiques sur le ‘comment mesurer les (in)soutenabilités ne doivent pas occulter l’enjeu de leur mobilisation et de leur utilité. Ces mesures resteront imparfaites. Tout en continuant à chercher à les améliorer, il faut s’interroger sur la manière dont elles peuvent contribuer à transformer notre référentiel de politiques publiques. Comment intégrer dans la comptabilité nationale la soutenabilité forte i.e. sans substituabilité entre les différentes dimensions (naturelle, économique, humaine) ?
Et d’abord faut-il les intégrer ou bien faire des comptes à part en sachant que la comptabilité nationale n’est pas la bonne manière de mesurer la soutenabilité humaine et environnementale ? La réponse est probablement dans les deux approches : plus grande intégration certes, comme on l’espère, pour l’élaboration du futur système de comptabilité nationale (SCN) de l’ONU en 2025 mais aussi développement de comptabilités autonomes et d’indicateurs de synthèse, en particulier par le « transfert » d’une partie des comptables nationaux vers les comptes de l’environnement et de revenus des ménages.
4/ Donner un coût aux émissions de CO2 et trouver où l’intégrer dans les comptes nationaux
Le problème serait double selon D. Blanchet. Pour rentrer dans le cadre de la comptabilité nationale, il faut arriver à donner une valeur ou un coût à ce qui n’en n’a pas spontanément :
- attribuer un coût aux tonnes de CO2 qui sont émises et donner une valeur à leur évitement.
- une fois qu’on l’a fait, il faut trouver auquel des agrégats de la comptabilité nationale il est le plus parlant d’ajouter ou de soustraire ces évaluations, ou bien en inventer de nouveaux.
a) Comment estimer un coût aux tonnes de CO2 qui sont émises et donner une valeur à leur évitement.
La valorisation complexe des tonnes de CO2 qu’on émet ou qu’on retient doivent se faire en chiffrant les dommages qu’elles génèrent ou évitent. C’est de cette manière que se valorise un investissement au sens traditionnel du terme : la valeur d’une unité de capital investie, c’est le flux net de revenus futurs qu’on en attend ; la perte que représente la destruction d’une unité de capital, c’est donc le flux de revenus futurs dont elle nous prive. La valeur de marché du capital reflète en général ces gains ou pertes futurs attendus; or il n’y a évidemment rien de tel pour le capital naturel. On se retrouve dans un cas où le comptable national est tenu de faire des hypothèses, en tentant d’évaluer directement ces gains ou ces pertes attendus.
Mais ces évaluations multiformes ne donnent pas « le » chiffre du coût social de la tonne émise de CO2 qu’on pourrait directement brancher sur les agrégats de la comptabilité nationale.
Elles peuvent d’autant moins le faire que c’est en termes de distribution des coûts qu’il faut raisonner plutôt qu’en termes de chiffre unique. Le réchauffement, ce sont des coûts quasi certains même en scénario optimiste, et c’est le risque de coûts extrêmes en cas d’enchainement cumulatif et catastrophique de conséquences négatives, avec une probabilité significative mais impossible à chiffrer. Des valeurs du carbone n’en circulent pas moins et font même l’objet en France d’affichages très volontaristes : on parle de valeurs tutélaires du carbone exprimées en euros par tonne de CO2, qui devraient servir de référence climatique pour les choix d’investissement de tous les acteurs économiques. Comment sont-elles établies ? Ces valeurs tutélaires sont -elles bien des substituts acceptables aux valorisations des dommages ?
b) PIB vert, épargne ajustée, dette écologique : quel serait le meilleur indicateur ?
La piste qui a longtemps été privilégiée est celle de la construction d’un PIB vert (voir page Compte Environnement). Les comptables nationaux calculent déjà un produit intérieur net, (PIB moins dépréciation du capital économique). Le PIB vert serait ce produit intérieur net également diminué de la dépréciation du capital environnemental (épuisement des actifs naturels et pollutions). Mais un PIB ainsi recalculé ne le rendrait pas très révélateur pour autant de l’importance de l’enjeu climatique. Il reste que selon des indicateurs existants de « PIB verts », la « croissance corrigée » aurait été nulle depuis 1970 aux États-Unis, et les fantastiques taux de croissance de l’économie chinoise pourraient être divisés par deux ou plus.
La vraie question de la soutenabilité, c’est plutôt de savoir si nous faisons ce qu’il faut pour préserver les conditions de vie futures : suffisamment d’investissements nets au sens économique du terme, et suffisamment d’efforts de préservation du capital naturel (par exemple les écosystèmes).
C’est l’évolution quantitative ou qualitative des actifs correspondants qu’il faut suivre et c’est à ce niveau là qu’on peut faire intervenir la valorisation du capital naturel.
Disposer d’un prix du carbone qui le rend commensurable aux autres formes d’investissement ouvre la voie à un indicateur inclusif de soutenabilité, le taux d’épargne net « généralisé », comptant positivement tout ce qui est mis de côté pour contribuer au niveau futur, et en négatif, valorisé à due hauteur, ce qui est détruit et ne sera plus disponible pour ces générations futures. Cette piste a longtemps été décriée comme donnant trop peu de poids aux facteurs environnementaux. Mais c’était l’époque où les valorisations des émissions de CO2 n’étaient pas bien estimées. Le sujet mériterait d’être rouvert à la lumière de ces nouvelles valorisations.
Une fois calculé, le coût du respect des engagements climatiques à l’horizon 2050 peut se traduire dans les termes d’une « dette écologique » à honorer. Combien d’années de PIB à venir est-il nécessaire de préempter pour le respect de cette cible ? La dette écologique est d’une autre nature que la fameuse dette publique : dès lors qu’on juge impératif de respecter les objectifs d’émissions de CO2 à 2050, il s’agit d’une dette qu’il faudra honorer « quoi qu’il en coûte ».
On entend souvent parler de cette notion selon trois visions des choses :
- La dette écologique que nous aurions envers les générations futures pour les dégâts environnementaux que nous leur laissons ;
- La dette écologique que nous aurions envers la planète, souvent représentée par une date dans l’année à partir de laquelle nous vivons « à crédit » car la terre a épuisé sa capacité à absorber notre empreinte écologique ;
- La dette écologique est la dette contractée par les pays industrialisés envers les autres pays à cause des spoliations passées et présentes de leurs ressources naturelles, auxquelles s’ajoutent la délocalisation des dégradations et la libre disposition de la planète afin d’y déposer les déchets de l’industrialisation.
la dette écologique revêt ainsi plusieurs formes sous lesquelles elle continue de s’accroître, à savoir la dette carbone, le passif environnemental, la dette alimentaire,… .
Mais de même que le PIB n’est pas à lui tout seul responsable de tout ce qui ne va pas dans la marche du monde, ce ne sont pas des indicateurs de dette ou de non-soutenabilité environnementale qui seront à eux seuls capables de remettre la planète sur un chemin plus vertueux, si bien conçus qu’ils soient.
c) La mesure de la productivité du travail dans l’agriculture
S’agissant de la mesure de la productivité du travail, J. Gadrey réfléchit, sous l’angle de l’offre, à l’hypothèse suivante [10] : « de nombreuses transformations nécessaires de la production (de biens ou de services) s’accompagneront d’une réduction de la productivité du travail, telle qu’on la mesure actuellement. D’éventuelles mesures alternatives ne sont pas à exclure, mais elles n’existent pas encore. Et bien que tous les secteurs soient concernés, l’agriculture, l’énergie, le bâtiment et une fraction de l’industrie seront aux premières lignes. Cela viendra renforcer la tendance à ce que leur poids dans l’emploi cesse de régresser, d’autant qu’une partie des besoins correspondants sont fondamentaux, de sorte que la demande restera forte. Ce poids devrait même progresser nettement dans certaines branches de la « production matérielle » (voir page Diversité tertiaire).
L’explication résumée est la suivante : les produits durables, « propres » ou « verts » (biologiques, recyclables, de plus longue durée de vie, impliquant moins de transport et d’énergie, etc.) exigent et exigeront plus de travail par unité produite que les produits pollués ou polluants issus des procédés productivistes. Ne plus surexploiter la nature et gérer ses « services » avec précaution est bon pour l’emploi (au moins dans certaines branches où la demande ne devrait pas faiblir) mais mauvais pour la productivité du travail « brute », celle qui n’enregistre pas les gains ou les pertes de qualité écologique des produits.
Dans le passé, la principale façon de faire croître la quantité de production économique (telle qu’on la mesure actuellement) a été la réalisation de gains de productivité du travail, qui se résument par la formule : produire plus des mêmes choses avec la même quantité de travail. J. Fourastié avait montré par exemple que s’il fallait autour de 200 heures de travail pour produire un quintal de blé de l’an 1000 jusqu’au 18ème siècle, avec de fortes variations selon les années, il n’en fallait plus que 30 vers 1950. On en est aujourd’hui à 2,5 heures avec les techniques les plus « productives », en comptant le temps de travail nécessaire à la production des machines et des « intrants » de la production. Dans les pays « riches », 2 % à 3 % d’actifs suffisent à nourrir tous les habitants.
Mais le blé moderne est issu d’une agriculture de plus en plus intensive qui produit, en même temps que le blé, des externalités négatives. Elle utilise massivement des intrants chimiques, pesticides et autres, dont on commence à évaluer les impacts négatifs sur la santé, sur la mise à mal des écosystèmes, et sur la disparition d’insectes pollinisateurs pourtant essentiels pour bien d’autres productions. Elle contribue (avec d’autres) à épuiser et polluer les nappes phréatiques et à accentuer la désertification, ce qui réduit les deux principales ressources de la production agricole : les terres arables disponibles et l’eau. Elle a remplacé l’énergie humaine par de l’énergie « machinique » à base de pétrole : c’est cette substitution du capital (et du pétrole) au travail qui explique la plus grande partie de ses gains de productivité. Les plus gros tracteurs ou moissonneuses batteuses ont une puissance de 500 chevaux et des moteurs d’une cylindrée de 10 à 12 litres. Tout cela s’accompagne d’émissions de CO2, et le pétrole est en voie de raréfaction. Enfin, comme la distance s’accroît entre les lieux de la production agricole à grande échelle et les lieux de transformation et de consommation, le blé ou la farine modernes exigent du transport, lui-même gros pollueur.
Donc le blé intensif « incorpore » toute une série de caractéristiques négatives au regard de la durabilité. Les mesures de la productivité et de la croissance les ignorent. Pour en tenir compte, il faudrait déduire de la valeur de ce blé « pollueur » la valeur estimée des nombreux dommages collatéraux que sa production et son transport entraînent, et tenir compte de la « valeur d’option » (valeur attribuée aux usages dans le futur) des ressources non renouvelables utilisées (le pétrole surtout). Qu’obtiendrait-on ? En s’inspirant des différences de prix entre l’agriculture intensive et l’agriculture biologique, on peut grossièrement estimer que la productivité ainsi « corrigée » de l’agriculture intensive serait divisée par deux par rapport à sa valeur brute, en fonction du mode d’évaluation des dégâts écologiques et de la déplétion du pétrole. Ses « véritables » gains de productivité dans la période récente, celle où elle a le plus malmené la nature, seraient ainsi faibles ou nuls.
L’agriculture industrielle serait convertie par étapes en un système durable. Il s’agirait d’une « modernisation » exigeant des innovations, mais il faudrait envisager un retournement inattendu : l’emploi dans l’agriculture, qui n’a cessé de décroître depuis la révolution industrielle (3 % de l’emploi total en France, contre 27 % en 1954), devrait augmenter pour satisfaire une demande durable, avec des « prix durables » (plus élevés) incorporant les exigences nouvelles. Il en irait de même de la valeur ajoutée de ce secteur : son poids dans le PIB progresserait nettement. Cette hypothèse concernant la production repose implicitement sur une seconde hypothèse relative à la demande : les ménages augmenteraient leur « coefficient budgétaire » pour ces produits alimentaires devenus à la fois plus chers et durables, ce qui suppose de réfléchir à une notion de « pouvoir d’achat durable » et de réduire les inégalités de revenu pour que ces produits durables restent accessibles à tous.
On aurait alors une forte baisse de la productivité, mesurée selon les méthodes actuelles, mais l’emploi progresserait, à production donnée en quantités brutes (par exemple les quintaux de céréales). Croissance zéro (dans ce secteur), emploi en hausse ? Cela semble difficile à croire. C’est pourtant possible si l’on tient compte des nécessaires gains de qualité et de durabilité, nouveaux grands gisements d’emplois du « développement durable ». En réalité, si l’on était capable d’intégrer les gains de qualité et de durabilité dans les mesures des variations de prix et de productivité, il est probable que l’on assisterait non pas à une baisse de la productivité, mais plutôt à des gains ».
Il reste que l’inflation des produits alimentaires en 2022-2023 a entraîné une baisse de l’achat des produits « bio », surtout par les personnes les plus modestes. Autant dire que comme pour les carburants, il n’est pas simple de concilier les objectifs économiques et environnementaux.
Michel Braibant
BIBLIOGRAPHIE
[1] Mesurer l’activité durant la crise sanitaire, Premiers éléments de bilan; D. Blanchet, J.L. Tavernier, OFCE, https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2020-2-page-23.htm
[2] Peut-on comparer les grandes crises de 1873, 1929 et 2008 ? P. Plihon, https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-4-page-12.htm
[3] Établir la balance des paiements : une mission statistique à la Banque de France depuis 1945, F. Le Gallo, Banque de France, décembre 2021, file:///E:/solde%20commercial/bulletin-banque-de-france_238-5_balance_des_paiements.pdf; Voir aussi De la résilience de la Balance des Paiements face aux crises méthodologique, F. Le Gallos https://variances.eu/?p=6410
[4] Comparaisons des relances françaises de 1975 et 1981*1982, A. Fonteneau, A. Gubian, https://www.persee.fr/docAsPDF/ofce_0751-6614_1985_num_12_1_1033.pdf
[5] https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2016/01/08/2007-2015-une-si-longue-recession/
[6] L’économie française en 2020 : une année de bouleversements, https://www.insee.fr/fr/statistiques/5389038
[7] Vertus, limites et perspectives de la comptabilité nationale : une introduction , A. Vanoli, https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4191118/imet134-b.pdf, voir aussi A. Sauvy, Historique de la comptabilité nationale, Insee, https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1970_num_14_1_1964#estat_0336-1454_1970_num_14_1_T1_0026_0000, voir aussi J.K. Galbraith, la crise économique de 1929, édition Payot.
[8] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000427.pdf, voir aussi https://www.insee.fr/fr/statistiques/1372481?sommaire=1372485, voir aussi https://blog.insee.fr/wp-content/uploads/2023/09/blogInsee_23_09_Regarder_la_croissance_fig3.png
[10] D. Blanchet : Comment verdir la comptabilité nationale ? https://www.societal.fr/didier-blanchet-comment-verdir-la-comptabilite-nationale voir aussi Quelle comptabilité pour un « après » soutenable ou comment mesurer ce qui compte vraiment ? » https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/seminaire_soutenabilite_v3.pdf; voir aussi J. Gadrey, la crise écologique exige une révolution de l’économie des services https://journals.openedition.org/developpementdurable/17472#tocto1n5